Cette photographie, donnée pour une exécution militaire à Verdun 1917, daterait selon le modèle des uniformes de 1914 ou 1915 : il s'agirait sans doute de l'exécution d'un espion et non d'un soldat.
Janvier
Ernest François
Beaulieu, né le 14 octobre 1887 à Paris 14è, élève
des Hospices de la Seine, bûcheron itinérant, condamné par le CG
de la IVè armée à 10 ans de réclusion pour désertion en présence
de l’ennemi.
Albert Thomas, 2è
classe : « Quand ma Cie est montée en première ligne
devant Verdun, le 6 novembre, Beaulieu n’a pas suivi et je ne l’ai
plus revu. Il m’avait déclaré « qu’il ne voulait pas
monter, qu’il avait envie de foutre le camp à Verdun. Ça lui
coûterait peut-être douze balles, mais qu’il s’en fichait.
Beaulieu : - Je
n’ai pas dit cela. J’ai dit : « C’est
dégoûtant de remonter. Si ça ne coûtait pas si cher, je ficherai
le camp ».
Pierre Hubert, 2è
classe : « Le 7 novembre vers huit heures du matin, j’ai
vu arriver le soldat Beaulieu à la citadelle de Verdun. Il m’a dit
qu’il avait été commotionné et que son commandant de Cie et le
Médecin-major, lui avaient dit de revenir à Verdun pour se reposer.
Il a passé la journée auprès de moi et est parti vers 17 heures en
me disant qu’il allait voir un camarade. Il n’est pas revenu et
je ne l’ai revu que plusieurs jours après.
« J’arrivai
à Bar-le-Duc le 8 novembre vers 19h et me rendis à la gare où,
immédiatement et sans prendre de billet je sautais dans le train de
19h22 en partance pour Paris. Arrivé à Paris, j’y ai passé les
journées des 9 et 10 novembre à visiter la ville. Le 10 au soir je
partais pédestrement pour Villeneuve Saint-Georges où j’ai
travaillé avant la guerre. J’ai rencontré des camarades qui se
trouvent dans le même cas que moi et dont je ne donnerai jamais les
noms. Ils sont comme moi des victimes et je préférerais qu’on me
fasse tout plutôt que de les dénoncer. J’ai été arrêté le 11
novembre à 22 heures par les gendarmes de Villeneuve. »
De fait, Beaulieu ne
revint au 104è R.I. que le 16 novembre, encadré de deux gendarmes
qui l’avaient arrêté le 12 à Villeneuve-Saint-Georges : il
avait agi ainsi « par désespoir de voir cette tuerie ».
Le commandant du bataillon écrit alors « Son attitude à sa
rentrée au Corps a été déplorable, il n’a pas manifesté le
moindre sentiment de regret. » En effet tout soldat de base
sait qu’il faut obligatoirement se repentir dès les premiers
interrogatoires.
Recours en grâce
signé par 1 juge sur 5
Henri Alfred
Pujat, né le 17 décembre 1891 à Paris 20è ,
jointoyeur au Pré-St-Gervais, puis ciseleur,
tous deux 2è classe
au 104è R.I. : en ce qui concerne Pujat, aucun témoin ne peut
se présenter à l’audience, le sergent Leprince, en formation de
chef de section, le caporal Bordeux, grièvement blessé, le soldat
Croisé, tué la veille en se rendant à Verdun, le caporal Gricourt
absent sans motif. L’audience se résume à la lecture des pièces
auxquelles Pujat n’objecte rien, renouvelle ses aveux, et exprime
son repentir.
Le 20 septembre
1916, la 6è Cie passe du boyau La cadex à la Redoute des quatre
cheminées où sont distribuées les munitions ; au lieu-dit Le
Maroc, le sergent Bordeux constate que Pujat est manquant à l’appel.
Il rejoint sa Cie au fort de Verdun dans la nuit du 23 au 24
septembre, quant elle redescend des lignes. Par suite d’erreur oudu
désordre, il n’est pas emprisonné et suit sa Cie à l’arrière
à la Ferme des Merchines. Pujat l’abandonne dans la nuit du 27 au
28 septembre et gagne Paris où il se présente volontairement au
Bureau de la Place le 30 à 20h. Ramené à son régiment qui,
toujours au repos, s’est transporté à Neuville sur Orne, il est
cette fois enfermé. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, il s’évade
et regagne Paris, où il est arrêté, le 21 octobre, et ramené à
la prison de la Prévôté le 31. Pendant l’instruction, Pujat fait
tourner en bourrique les autorités, tâchant de gagner du temps en
se prétendant atteint de troubles mentaux. Les enquêtes engagées
révèlent seulement qu’il fréquentait -connu alternativement sous
les noms d’Henri Duchemin, Lucien Spouler, Louis Jacquet et
« Riton »-les souteneurs et les filles du quartier de
Belleville (sa maîtresse étant poursuivie pour « vole à
l’entôlage »), et qu’il a été condamné cinq fois par
des juridictions militaires (dont deux fois insoumission, trois fois
pour désertion). Incarcéré entre 1909 et sa majorité à la maison
correctionnelle des Douaires, Pujat donne de fausses adresses et de
ses parents et d’employeurs que les enquêteurs recherchent en
vain, supposant qu’il vivait essentiellement de la « prostitution
d’autrui ».
« J’ai le
plus profond repentir de ma faute, mais je n’ai pas à me reprocher
d’avoir entraîné le soldat Gondard avec moi. Il a agi de son
plein gré en restant avec moi aux « quatre cheminées ».
De même il est parti volontairement avec moi pour Paris, lorsque
nous étions à la ferme des Merchines. »
Condamnés par le CG
de la 7è DI,(audience du 27 novembre 1916) ; pourvoi en
révision rejeté le 14 décembre 1916, recours en grâce
présidentielle de Pujat signé par le défenseur, les juges ayant
refusé de s’y associer, rejeté. L’ordre d’exécution produit
en urgence le 10 janvier (sa version manuscrite ne fixe même pas
l’heure) montre que les exécutions ont été simultanées, même
s’il n’en est pas explicitement fait état : « Deux
poteaux seront solidement plantés au lieu fixé pour l’exécution
par le commandant du 2è Btn, chargé des détails de l’exécution. »
Beaulieu et Pujat
sont fusillés à Azerailles (54) le 11 janvier 1917, 7h
Frédéric Gosch, né
le 12 janvier 1889 à Haussman (Allemagne) condamné» en 1915 à 5
ans de TP pour refus d’obéissance, était déjà sous la
surveillance étroite des gradés ; on a vu combien ceux-ci se
méfiaient des allemands, souvent enrôlés « malgré eux ».
Ce n’était pourtant pas le cas de Gosh, engagé librement à Lille
avanr-guerre, ayant fui l’Allemagne, puis liège, pour échapper
aux poursuites visant un abus de confiance commis envers son ancien
patron boulanger.
Henri Hebel, né le
4 décembre 1891 à Coblentz, forgeron, également du 1er
R.M. du 1er R.E., était aussi engagé volontaire, s’étant errôlé
à Valencienne en 1913, poursuivi pour un vol de 4250 francs(?) à
Coblenz.
Le 16 octobre 1916,
vers 18h15 le légionnaire allemand Hebel demande à son supérieur
l’autorisation d’aller rechercher sa gamelle qu’il dit avoir
oubliée dans les fils barbelés. Celui-ci lui fait déposer son
fusil : la perquisition de son paquetage montrera ultérieurement
qu’il avait pris soin de se munir de 120 cartouches. Il s’enfuit,
la nuit empêchant qu’on se lance à sa poursuite, l’empêche
aussi de retrouver Axt et Mader en compagnie de qui il avait prévu
de déserter. Hebel connaissait Mader depuis août 1916, où ils
avaient déjà formé des projets de fuite à Sidi-bel-Abbes (Hebel
fraîchement sorti du pénitencier après avoir purgé une peine d’un
an pour dissipation d’effets militaires alors que Mader vient des
Travaux Publics). Axt, gardant un poste proche est chargé de faire
passer son propore fusil et celui de Mader, déposé dans les
cabinets.
Le 22 octobre 1916,
profitant du relâchement de surveillance du dimanche, Gosch quitte
le camp de Zouahar (confins Riata) et se cache en attendant le soir.
La nuit venue, il se rend chez les Riatas dans un village à 2 heures
du camp, où son Lebel 1886 et les 120 cartouches qu’il emmène
sont accueillies avec enthousiasme. Là, il retrouve H ebel,
Axt et Mader. Slimann, ancien tirailleur, agent d’Abd-el-Malek est
chargé de les emmener chez le Caïd, ce qu’il fait de nuit, à
marche forcée. Mais, quoi que leur guide ait promis de couper la
tête à ceux qui ne suivraient pas, Gosch et Hebel, épuisés se
couchent dans un ravin, où un goummier les surprend à 7h30 le
lendemain, 27 octobre, et les emmène à Taza. Axt et Mader
n’auraient pas été retrouvés.
Gosch, 18 décembre
1916 : « J’ai toujours eu l’intention de déserter,
mais simplement pour obtenir ma liberté et non pour passer aux
marocains pour faire le coup de feu contre les Français. Je croyais
pouvoir gagner la zone espagnole. »
Lettre de Gosh à
son frère Henri : « J’ai déserté actuellement du camp
des français qui est à 20km de Taza. Quand la guerre sera terminée
vous pourrez m’attendre. Maintenant je me trouve chez les Marocains
qui sont ennemis des français. Le colonel est un turc et le
commandant un allemand nommé Hermann. Où je vais aller maintenant,
il y a beaucoup d’allemands du bataillon dont je faisais partie, je
suis actuellement le quatrième déserteur. Je suis habillé comme un
marocain. Je reçois un fusil allemand ainsi que des cartouches. En
outre, je reçois ma solde, il n’y a que la différence que je ne
suis pas habillé comme un soldat. »
1er CG de l’Almalat
d’Oujda (audience du 9 janvier 1917): si les délais sont
important c’est que sans doute le commandement français soupçonne
l’existence d’une filière organisée de désertion, (voire d’une
« agence » et pense que les déserteurs communiquent, par
signaux avec le camp du 1er étranger, recrutant des
soldats pour la compagnie Hermann, regroupée dans le Riff.
L’exécution est au contraire rapide aussitôt le recours en
révision rejeté (le 13 janvier 1917) sur décision du Résident
Général Lyautey, lequel a obtenu, su sa demande de faire office de
recours ultime en zone de guerre marocaine, sans avoir à en référer
à la présidence. Gosh et Hebel sont donc fusillés à Oujda (Maroc)
le 16 janvier 1917.
Il y a eu au mois de
janvier 1917 53 condamnations à mort, 29 été commuées et, si
quelques unes ont été exécutées de le mois suivant, il est plus
que probable que les deux double exécutions de janvier ne représente
que la partie émergée de l’iceberg.
Février
Pierre Marie
Hesry, né le 23 juillet 1889 à Plessala (22),
cultivateur, 2è classe au 31è R.I., 6è Cie
Déclaration de
Pierre Hesry : « C’était le 12 janvier 1917 vers six
heures du matin. J’atis de faction à la tranchée de première
ligne. Mon camarade Doucet, qui montait la garde avec moi est parti…
A un moment donné, alors que j’étais tourné à l’oblique dans
la tranchée, 4 boches sont arrivés à moi sans que je les ai vus
venir. Trois ont sauté dans la tranchée et m’ont mis en joue. Le
quatrième est resté sur le parapet et a pris le fusil mitrailleur
de mon camarade dont j’avais la garde. Ils m’ont parlé mais je
n’ai rien compris. J’ai seulement compris leur geste qui me
montrait la direction de leur tranchée. ..Comprenant qu’il n’y
avait rien à faire je les ai suivis jusqu’au milieu de notre
réseau de fil de fer. Là je suis tombé dans le fil de fer ;
ça a amené du baroufle, les sentinelles Françaises ont tiré. Les
boches se sont mis à quatre pattes et sont partis dans la direction
de leur tranchée. Moi, j’ai tout lâché ce que j’avais
d’équipement et le fusil et je suis revenu dans notre tranchée
[Hesry est rentré dans la tranchée voisine de la 9è Cie] J’ai
rejoint ma place, On m’a renvoyé chercher le fusil mais je ne l’ai
pas retrouvé. J’ai une citation à l’ordre du régiment. »
(« Blessé le
26 mai 1916 au ravin de la Mort, cote 304, contusions par éboulement,
dyspepsie. Soldat brave et courageux, enseveli par un obus ennemi, a
avant d’être lui-même dégagé, aidé à porter secours à son
chef de section, également enseveli par un violent bombardement ».
Croix de guerre. »)
Les gradés
entretiennent déjà de vifs soupçons sur cette version des faits,
relancés par le fait que Hesry, qui avait l’habitude de prendre la
garde en sabots avait ce matin-là chaussé ses brodequins, et qu’ils
ne voyaient que les traces d’un seul homme dans la neige
fraîchement tombée, quand la balance de service, le camarade Doucet
crache le morceau :
« Vers 6h03,
lorsque je revins, je ne trouvai plus Hesry ni son fusil-mitrailleur.
Je prévins aussitôt le caporal Ruel… de sorte que vers 6h10,
toutes les sentinelles de la section étaient sur le qui-vive. C’est
à ce moment que le soldat Aubert et le caporal Malescot, apercevant
une ombre dans le réseau, tirèrent quelques coups de fusil.
Quelques instants avant son départ, Hesry parlant de l’offensive
de printemps me disait qu’ayant fait la Champagne et Verdun, il en
avait assez, qu’il voulait faire comme son camarade Dolo. Il essaya
même de m’entraîner dans sa désertion, me proposant de faire une
mise en scène destinée à faire croire à son enlèvement, en me
tirant une balle dans la cuisse et en jetant quelques grenades. Il me
dit que je n’avais rien à craindre, que personne ne découvrirait
la vérité : de plus il ajouta qu’il espérait retrouver Dolo
de l’autre côté et qu’il regrettait de ne pas avoir été avec
lui au moment de sa désertion. Je refusai énergiquement et après
avoir tenté de le ramener à de meilleurs sentiments, je lui dis :
« Ne fais pas cela devant moi ou je te tue comme un lapin ».
Je ne pensais pas qu’il mettrait tout de suite son projet à
exécution. C’est sans doute ma détermination qui lui fit attendre
le moment où, m’éloignant comme sentienelle mobile pour assurer
la liaison avec la sentinelle voisine, il se trouva seul pour mettre
à exécution so forfait ». A la fouille sont trouvés dans les
poches d’Hesry, trois paquets de pansements, cinq paires de
chausettes, un rasoir, un blaireau, une glace, une serviette, une
trousse à aiguilles, un morceau de savon, une bouteille d’eau
boriquée et des enveloppes-ce qui fournit l’argument de
préméditation.
CG de la 10è DI (16
janvier). Recours en révision rejeté le 29 janvier 1917
Déclarations que le
soldat Hesry a confiées à son avocat avant de mourir (écrit par le
Lt Thomas pour Hesry qui ne sait pas écrire – ce qui fait
évidemment craindre que ce témoignage soit en partie au moins,
apocryphe) :
« Pour
l’autorité militaire : Je ne sais rien sur mon camarade Dolo.
Je l’affirme, car je ne voudrais pas qu’il fût accusé plus tard
de désertion, sur une parole sans importance prononcée par moi à
son sujet.
Pour ses camarades :
Mes chers amis, si
je n’ai pas toujours donné le bon exemple, je vous en demande
pardon ; je vais expier bien durement tout à l’heure, je le
ferai courageusement. Bien le bonjour à vous tous. Bonne chance. Je
meurs en chrétien et en Français. Au revoir. Vive la France. »
Hesry est fusillé à
Coenny route de Lhéry (à cinq cent mètre du village) le 1er
février 1917 à 9h
« Six plaies
pénétrantes au thorax par six balles ayant atteint la région
précordiale, une plaie pénétrante par balle sur le bord droit du
sternum. Deux autres balles ont atteint la région du flanc gauche
[trois ont donc raté la cible]. Le coup de grâce a été appliqué
dans la région temporale gauche, normalement à sa surface, et
intéressant le cerveau dans toute sa largeur. »
Marcel Bidault,
né le 21 mai 1893 à Bourges (Cher), manœuvre, puis vannier sans
domicile fixe à Paris, 2è classe au 46è R.I., 6è Cie, 1,61m,
cheveux noirs, yeux bleu clair, front fuyant, nez cave, tatouages aux
deux bras, blessé le 17 février 1915 à la cote 263 d’une balle
au bras droit, le 13 juin 1915 au plateau de Bolante d’une balle au
bras gauche. Sait lire et écrire.
Condamné au civil
pour vol en avril 1908, remis à ses parents, en juillet 1908, placé
en maison de correction jusqu’à ses 20 ans, 22 octobre 1913,
outrage public à la pudeur, novembre vol, décembre coups, juillet
19614, outrage à citoyen chargé d’une mission de service public,
septembre 1916, vol. Punitions militaires : 11 novembre 19615
« a fait des propositions obcènes et contre nature à
plusieurs de ses camarades (7j de prison+8jours de cellule) 20 avril
1916 : « s’étant enivré a causé du scandale dans les
rues du cantonnement, nécessitant l’intervention du poste de
police (idem), 15 mai, se met volontairement en retard pour une
corvée, puis disparaît une deuxième fois dans la nuit.
Interrogatoire de
Bidault le 29 septembre :
D : - Vous avez
une première fois déserté le 3 juin 1916, au moment où votre Cie
qui était cantonnée à Rarécourt devait remonter en ligne à
Vanquois.
R : - :
C’est exact. J’ai déserté parce qu’on devait me donner une
permission. J’avais demandé trois fois à aller au rapport du
Colonel et on me l’a refusé.
D : - Vous avez
été arrêté à La Font-Vinée par les gendarmes le 2 septembre
1916 ?
R : - oui,
j’étais en civul et j’ai travaillé à l’abattoir de Moulins…
Mes effets militaires sont restés chez mon frère.
Maurice Guyot,
sergent : « Le 28 (septembre) au matin, alors que nous
étions relevés, je suis allé chercher mon sac à La Brioche. Je
fus très étonné d’y voir Bidault… il me raconta qu’il avait
été retourné le 25 septembre par un obus, qu’il s’était
présenté à la visite du Major Mariangeas qui l’avait autorisé à
aller se reposer à La Brioche où d’ailleurs se trouvait le poste
de secours… Je l’emmenai avec moi à la Cie et fis part de ma
découverte au lieutenant Piot. Arrivé à Suzanne, cet officier a
interrogé Bidault devant moi… il a fini, étant pressé de
questions par avouer qu’il avait voulu éviter les attaques des
25,26 et 27 septembre parce qu’il avait peur. Bidault est tout ce
qu’il y a de plus lâche. Il n’est courageux qu’au repos où
alors il devient fanfaron. Il ne parlait rien moins, avant l’attaque
de Bouchavesnes que de monter à l’assaut en sonnant la charge et
il cherchait un clairon pour cela. Mais dès qu’on était sous le
feu de l’ennemi, un obus venait-il à tomber à 200m, qu’il
s’aplatissait comme une crêpe. »Médecin Major rené
Mariangeas : « je l’ai examiné. Il n’y avait aucun
signe extérieur de nature à faire admettre le récit de Bidault…
il n’avait rien qui puisse nécessiter son départ des lignes.
Aussi je lui ai donné l’ordre formel de rejoindre sa compagnie. »
D : - Le 3
octobre 1916, vous étiez enfermé au poste de police de Cérisy et
vous avez déserté à nouveau. Vous avez été arrêté par la
police à Paris le 29 novembre ?.. Enfin, le 9 décembre
dernier, étant enfermé au poste de police du camp de Ste Tanche,
près de Lhuitre, vous avez encore déserté et vous avez été
arrêté ?
R : - Oui.
J’avais le cafard.
D : - Lorsqu’on
vous a arrêté, vous éttiez porteur d’un certificat d’exemption
au nom de Manoury Abel Joseph ?
R : - J’avais
fait la connaissance de Manoury lors de ma première désertion à
Bourges. Je le rencontrais lorsqu’il sortait de la fonderie. Il
était tourneur sur métaux. J’ai su qu’il avait été travailler
à Joinville, en tout cas je l’ai rencontré à Paris à la gare de
Lyon. Il m’a dit qu’il avait été ajourné parce qu’il était
tourneur, je lui dis de mon côté que j’étais déserteur et que
son certificat d’exemption me serait très utile pour continuer à
rester dans cet état. Je lui demandai et il ne fit aucune difficulté
pour me le donner.
CG de la 10è DI (29
janvier 1917), recours en révision rejeté le 3 février 1917.
Fusillé àLhéry (51) le 5 février 1917 à 16 h.
Henri Le Garrères exécuté le 5 février 1917 à Les Éparges (Meuse)
né le 28 mars 1895 à Saint-Ouen. Soldat au 36e Régiment d'Infanterie - Tué d'un coup de revolver au cours d'une rébellion à main armé contre ses chefs.
Le forum
1418 découvre le fait que Le Garrères avait été versé dans une section disciplinaire -interrégimentaire, en subsistance au 36è-: or, le même jour, au même lieu est « décédé au cours d’une rixe (section disciplinaire) » le soldat Désiré Justin Couasnon du 74è RI -6 avril 1889, Veuzy, Haute-Savoie). Cette curieuse coïncidence pourrait incliner à penser qu’un mouvement de révolte s’est manifesté au 36è RI, une semaine avant que cette unité soit «mise au vert ».
André Duflos,
né le 3 avril 1893 à Versailles, ajusteur mécanicien au Havre, 2è
classe au 20è BCP, antérieurement condamné en septembre et
novembre 1915 (13èDI) pour abandon de poste sur territoire en état
de guerre et désertion à l’intérieur.
Minutes du CG de la
13è DI (3 janvier 1917) : Duflos est à l’unanimité jugé
coupable d’avoir déserté le 16 septembre 1916 aux tranchées du
secteur d’Estrées-Deniécourt en présence de l’ennemi, d’avoir
abandonné son poste dans une corvée de travaux en première ligne
aux tranchées du secteur de deniécourt-Ablaincourt le 2 octobre
1916, puis d’avoir déserté, quittant son corps sans autorisation
en présence de l’ennemi. Il est donc condamné à mort. Pas de
recours en révision. Frais 62,80 francs.
Montreux-Chateau
(68) le 5 février 1917 , 7h
Joseph André
Delphin ,222ème RI né le 5 décembre 1886, à Voreppe. Tisseur
domicilié à Saint Jean de Moirans.
Déjà condamné
à 5 ans de détention,le 8 novembre 1916, par le même CG, pour "
désertion en temps de guerre ", ... peine suspendue le jour
même par le Général commandant la 74ème Division.
Du dossier très
incomplet (révision uniquement) on peut déduire que Delphin
disparut le 24 octobre 1916, au moment où était donné l’ordre de
sortir de la tranchée pour se porter à l’attaque. Il réapparut
le 29 après la relève, mais fut aperçu entre temps les 25 et 26
octobre « blotti dans un trou de renard de la tranchée
Bourguignon », refusant au sergent Terrasse qui conduisait une
corvée de remonter avec lui. Delphin prétend pour sa défense qu’un
obus l’aurait fortement commotionné dans la soirée du 23.
Plusieurs témoins le contredisent dontle médecin-major qui ne l a
pas vu à la visite.
Condamné à mort
le 11 décembre 1916, par le CG de la 74ème Division, pour "abandon
de poste et désertion en présence de l'ennemi ", pourvoi
rejeté le 27 décembre 1916 (dispositions de la contrainte par corps
seules annulées) fusillé le 7 février 1917, à Verdun (Meuse).
Jules Charles
Victor Alexandre Allard, né le 22 août 1892 à Nantes
(44), manœuvre à Proville-les-Cambrai ; 2è classe au 64è
R.I.,
CG de la 21è DI 7
janvier 1917), jugé pour abandon de poste en présence de l’ennemi,
évasion par bris de prison, port illégal d’insignes et vol,
désertion à l’intérieur (co-accusé Victor Alphonse Aschauer
-évasion, port illégal d’insignes et vol- condamné à 5 ans de
prison)
Rapport en
révision : Les faits qui ont motivé la condamnation sont les
suivants : le 18 août 1916, le soldat Allard qui venait de
bénéficier d’une suspension de peine à la suite d’une
condamnation à trois ans de travaux publics prononcée le 4 août
précédent par le CG de la Xiè région, était reconduit au front,
au 64è R.I. pour lui permettre de se réhabiliter et arrivait au
Dépôt divisionnaire ; aux Monthairons. Il fut aussitôt confié
à un gradé qui devait le conduire quelques heures après au P.C. du
colonel, puis à la position occupée en ligne par sa Cie. Trompant
la surveillance du sergent Denechau, le sldat Allard… prenait la
fuite dans la matinée du 19 août et gagnai Paris par un train de
permissionnaire. Le 26 août la police municipale de Nantes arrêtait
à La Chauvinière le soldat Allard : il était porteur d’une
permission périmée depuis peu au nom du soldat Bosquain Louis du
24è territorial. Allard, pendant plusieurs jours, ne voulut point
déclarer sa véritable identité… finalement, après avoir donné
lieu à toutes sortes de recherches, il fut obligé de reconnaître
sa véritable situation militaire. Ramené par la prévôté le 12
septembre, il fut affecté à la 5è Cie.
Le 16 septembre, le
64è recevait l’ordre d’aller occuper un secteur particulièrement
périlleux et difficile, le secteur de la Laufée ; à 20h30,
Allard quittait avec sa Cie le Camp des Sénégalais… En cours de
route, Allard s’enfuyait entre Eix et Noulainville, à deux km de
la ligne de feu. Le 23 septembre, [il] se constituait prisonnier au
dépôt du 65è R.I. à Nantes…
Dans la nuit du 14
au 15 octobre, vers 23h, Allard s’évadait avec un de ses
co-détenus, le soldat Auscher Victor, du 64è, condamné le 9
octobre 1916 à la peine de mort par le CG de la 1è DI, pour abandon
de poste, désertion en présence de l’ennemi, vol, fabrication de
faux-passeports. [les conditions de cette évasion sont assez
rocambolesques : il faudrait évoquer la présence dans cette
salle de police d’autres détenus qui sans avoir activement
facilité l’évasion, l’ont au moins encouragée par leur silence
ou leurs conseils, Auscher ne paraissait pas très décidé au début,
car son avocat lui avait donné bon espoir que sa peine serait
commuée, ce qui arriva effectivement. Détenus avec eux se
trouvaient un certain Bareil qu’Allard avait projeté d’emmener,
un vieux territorial nommé Munier qui couvrit le bruit du départ,
et deux frères nommés Plourdeau, qui, évadés aussi, seront
arrêtés au moment où ils allaient réussir à partir pour
l’Espagne. Auscher qui travaillait à l’extérieur sur des
péniches rapporte une veste de caporal-fourrier trouvée dans les
bateaux, tandis qu’Allard découvre, dans les écuries de la
prévôté, une cisaille d’infanterie. Auscher, considéré comme
dangereux, était enchaîné la nuit avec une autre condamné à mort
du nom de Soulard. Allard le délivre, cisaillant la chaîne et le
cadenas, puis ils coupent les fils de fer de la fenêtre, pendant
qu’Allard pour couvrir le bruit se rend aux toilettes. Auscher est
arrêté à Paris le 10 novembre à la sortie d’un cinéma, et
Allard dans cette même ville, le 30.] Ces deux hommes avaient mis à
exécution un projet mûrement concerté, essayant d’entraîner
avec eux d’autres détenus… le cambriolage de l’Hôpital
Militaire de Montluçon.. Quels mois auparavant, Allard y avait été
soigné et en connaissant parfaitement les dispositions intérieures,
il avait l’intention de s’emparer de la somme, assez forte,
croyait-il, qui se trouvait dans le coffre-fort de l’établissement
et de se fabriquer pour lui et Auscher, avec les imprimés et les
cachets trouvés dans le bureau du Médecin-Chef, des papiers
d’identité et certificats qui devaient leur permettre de gagner
l’Espagne, grâce à la complicité de camarades du soldat Allard.
[Ce projet échoua, Auscher ne s’étant pas rendu au rendez-vous
fixé pour prendre le train de Paris à Montluçon, ce qui causa leur
séparation. Ils avaient vécu auparavant à l’Hôtel Delpierre,
dont Allard connaissait les propriétaires pour y avoir visité son
frère Gabriel. Allard se faisait passer pour un sous-lieutenant du
6è génie dont il portait les galons, la médaille militaire, la
Croix de guerre, la médaille commémorative de l’expédition de
Chine, et Auscher pour un sergent du même régiment. Sans que
l’enquête ait pu en déterminer la provenance, il semble que les
hommes aient manipulé de grosses sommes d’argent, Allard
dédommageant même lors de son départ l’hôtelier pour un blouson
de cuir emporté par Auscher. Allard s’en alla alors vivre chez sa
maîtresse, Berthe Rombaud, de neuf ans son aînée, vivant dan un
hôtel rue des Volontaires. C’est là qu’il fut arrêté, encore
porteur d’une somme de 1337, 95 francs.]
Allard n’avait pas
de casier judiciaire, ayant bénéficié d’un non lieu pour des
vols qu’il aurait commis au préjudice de sa belle-sœur, et
quasiment aucune punition avant ses quatre désertions: la
condamnation à mort ne fut prononcé qu’à quatre voix contre une.
C’est sur ces faits que se base le défenseur dans sa demande de
grâce présidentielle, tentant de démontrer qu’Allard aurait
subitement basculé dans la criminalité sous l’influence d’une
personne qu’il est incapable de désigner. Il fait état au surplus
d’une jeunesse particulièrement difficile, Allard étant né de
parents alcooliques, abandonné avec son frère par son père, après
le décès de sa mère à l’hospice en 1903, recueilli par
l’Assistance Publique, illettré, mais bon soldat avant son
dévoiement, quatre fois blessé au front. Ces considérations sont
évidemment de peu de poids au regard du machiavélisme dont il
semble avoir fait preuve durant son équipée finale, et des mystères
demeurées irrésolus de la provenance des fonds qu’il manipula.
Inscrite aux minutes
du jugement, une réduction de peine de 5 ans est prononcée en
faveur d’Aschauer en août 1921.
Allard est fusillé
à Verdun Caserne de Jardin Fontaine (55) le 13 février 1917 6h30
Georges Mallach,
né le 16 avril 1880 à Freudenfier (Allemagne), 2è classe au 1er
R.M. Du 1er R.E.
« Tué par une
patrouille étant déserteur rejoint » à Boudenib (Maoc) le 13
février 1917
Chaïb El Feguig
Kilani
ben Mohamed,
né en 1889 à Kourba
(caïdat
de Cap Bon, Tunisie),
cultivateur, sergent
au 8è R.M.T., 7è Cie
Le sergent Kilani
est suspecté de s’être mis à l’abri lors de l’attaque du 15
décembre 1916. Il dit avoir perdu sa section, avoir passé quelques
jours avec la 5è Cie (qui n’était en première ligne qu’à 200m
de la sienne, avant de s’être présenté le 18 à la visite au
poste de secours, arguant qu’il avait les pieds gelés. Le
médecin-major l’a envoyé attendre à Verdun la relève de sa Cie,
lui confiant deux soldats de la 5è Cie arrivés avec lui, mais
atteste qu’il ne s’est présenté ensuite que les 29 et 30 au
poste médical du cantonnement, présentant un léger œdème aux
pieds. Déjà suspecté d’avoir échappé à une attaque le 24
octobre, mais non puni faute de preuves, Kilani est condamné sur le
seul témoignage du tirailleur Ali ben Mohamed, qui rapporte ne pas
l’avoir vu à la tête de la section qu’il aurait du conduire à
l’attaque au moment de sortir de la tranchée. Mais ce témoin
déclare également : « Il y a eu beaucoup de tués et de
blessé dans ma section et presque tous ceux qui restent sont
évacués ». De fait, les témoins appelés par la défense
sont soit morts soit introuvables, le commandement faute de matricule
précis convoquant de façon plus ou moins hasardeuse des Brahim et
des Ali qui déclarent ne pas connaître l’accusé.
La lecture du
dossier laisse l’impression pénible qu’il a été instruit
essentiellement à charge et qu’on ne s’est pas donné grand mal
pour mener l’enquête : ce sujet indigène a été traité
avec un mépris que n’aurait sans doute pas eu à subir en pareil
cas un sous-officier français.
Simon Krief, né en 1895 à Tunis, boucher, tirailleur au 8è
R.M.T.
Le 20 septembre 1916, Krief part pour uen permission de 48h à Paris.
Supposé rentrer le 23 septembre, il est arrêté le 26 octobre,
ayant usé de faux nom et de certificats empruntés à un ami de
passage, et abandonnant ses effets militaires dans un hôtel
parisien. Son excuse est qu’il aurait perdu la tête après s’être
vu refuser la naturalisation française. Le Commissaire-Rapporteur,
qui la trouve d’autant plus « inadmissible » qu’il a
manqué l’attaque du 24 octobre, en profite pour rappeler que Krief
était en état de récidive, ayant été condamné par le CG de
Tunis le 21 juillet 1916 pour désertion et outrage à un supérieur.
Krief est rendu à son corps le CG de la division n’ayant pu se
réunir à cause de l’attaque du 15 décembre. Lors de cette
attaque, le 7 Cie était divisée en 2 pelotons (Kilani appartenait à
l’autre, chargé de garder la parallèle de départ). A l’arrivée
du 1er peloton à son objectif, à 12h, Krief et un jeune
soldat, Rabah ben Belkacem ben Fazaoui, manquants, furent portés
disparus. Mais dans la soirée, ce même 15 décembre, l’un et
l’autre furent rencontrés par le sergent major Lestavel à Verdun,
lequel sergent, connaissant Krief le fit conduire chez les gendarmes
où Rabah le suivit de son propre chef. Ramenés au P.C. du colonel
le 16 décembre, ils furent commandés de remonter à leur Cie avec
des coureurs (agents de liaison), mais ni l’un ni l’autre ne
rejoignirent, Rabah retrouvant sa section le 19 décembre au moment
où elle redescendait à Verdun, tandis que Krief était évacué le
17 pour gelures des pieds. Pendant son interrogatoire, Krief raconta
qu’il aurait vu des allemands rentrer dans un abri qu’il aurait
cerné avec Rabah, (les autres hommes du peloton étant restés
cachés dans des trous d’obus) et qu’ils auraient à eux d’eux,
avec quelques grenades, fait 111 prisonniers. Ils les auraient
conduits à Verdun immédiatement. Et en effet, Krief présente un
reçu d’un officier d’État-Major accusant réception de
prisonniers allemands conduits par lui le 15 décembre (qu’il
aurait sans doute trouvés affluant vers l’arrière), commandant
Rabah, qui venant au front pour la première fois, ignorait le
règlement, de les escorter avec lui. Le hic, outre le nombre
invoqué, est que des ordres formels avaient été donnés avant
l’attaque de ne quitter les lignes sous aucun prétexte, et en
particulier de ne conduire aucun prisonnier vers l’arrière.
Krief et Kilani sont
condamnés à mort par le CG de la 38è DI (29 janvier 1917), Rabah
est acquitté, les pourvois en révision sont rejetés le 7 février
1917. Kilani et Krief sont exécutés conjointement à Pavant (02) le
14 février 1917 à 9h30.
Gabriel Marie
Petit, né le 24 août 1882 à Vandeuvre-sur-Barse (Aube),
garçon de culture à Charanges, 2è classe au 226è R.I., 1,68m,
blond, yeux gris
Condamné
antérieurement poar le CG de la 70è DI le 5 mai 1916 pour abandon
de poste sur territoire en état de guerre (5 ans).
Le dossier de
procédure n’est composé que des minutes du jugement de révision,
à l’appui duquel on ne trouve qu’un très court rapport, à
l’évidence très défavorablement orienté : « Le 11
octobre 1916, le soldat Petit, au moment du départ de sa Cie pour
les tranchées, se prétendit malade et refusa de marcher. En
réalité, il n’était nullement malade, mais seulement en état
d’ivresse. Sur les injonctions formelles de son sous-Lt, le soldat
Petit fit mine de suivre la Cie ; mais au bout d’un km, il
avait perdu toute liaison avec son unité. On le vit rôder autour
des cuisines roulantes les 12 et 13 octobre. On lui intima l’ordre
de rejoindre la première ligne ; mais il s’y refusa,
alléguant que ce n’était pas la peine, et ce n’est que lorsque
sa Cie revint au cantonnement, dans la nuit du 20 au 21octobre qu’il
rejoignit son unité. Le 16 novembre 1916, la Cie reçut l’ordre de
se préparer à quitter le cantonnement. Petit, qui était en prison,
fut ramené à sa Cie. Le 17 novembre, au moment du départ il
disparut. Ce n’est que le 28 novembre qu’il fut arrêté par la
gendarmerie de Chavanges (Aube). Il a déclaré qu’il avait quitté
sa Cie parce qu’il avait le cafard. »
CG de la 70è DI.
Recours en révision rejeté le 8 janvier 1917, recours en grâce
rejeté le 18 février
Cabriel Petit est
fusillé à mi-chemin entre Berneuil et Attichy, près du dépôt de
munitions (Oise) le 20 février à 6h30. Bien qu’il n’y ait ni
musique ni défilé prévu, l’ordre d’exécution montre à
travers la convocation des troupes une volonté de frapper les
esprits : en présence d’« un bataillon du 229è R.I.,
une Cie du 44è Btn de Chasseurs, une Cie du 279è R.I., une Cie du
360è R.I., une section à pied de l’artillerie divisionnaire, une
section du Génie divisionnaire ». C’est assez étonnant,
puisque
Un bulletin portant
avis de décisions du conseil de révision de la 1ère armée,
constate le rejet à la même date d’un pourvoi présenté par le
soldat Emmanuel Michard, du 226è R.I., lui aussi condamné à mort
par le Cg de la 70è DI en son audience du 18 décembre 1916 pour
triple abandon de poste en présence de l’ennemi. On ne s’explique
pas ce qu’il est advenu de lui.
Émile Meynié,
né le 25 avril 1894 à Saint-Angel (Corrèze), soldat au 105è R.I.
« Déserteur
tué par les gardes de la section » à Ricquebourg (Oise) le 20
février 1917
Célestin Thomas,
né le 18 novembre 1885 à Pierrepont (Meurthe et Moselle),
briquetier à Longwy-bas, 2è classe au 303è R.I.
27 décembre 1905 :
coups et rébellion (1 mois de prison)
7 septembre 1906 :
port d’armes prohibées
19 juin 1912 :
rébellion et ivresse (1 mois)
30 avril 1913 :
Vol (deux mois)
18 août 1916 :
Cg de la 132è DI, abandon de poste (2 mois, peine suspendue)
CG de la 132è DI
(11 janvier 1917), pas de dossier de procédure, pourvoi en révision
(rapport administratif ne rappelant pas les faits) rejeté le 16
janvier 1917.
Motifs : -pour
avoir, le 24 août 1916 dans la matinée, étant avec sa Cie dans les
tranchées de 2è ligne de la carrière Paridon, abandonné son poste
- déserté en
présence de l’ennemi pour s’être dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, absenté illégalement dès le matin, jusque
dans la soirée du même jour, moment de son arrestation à seize
heures à Rosières [qualification peu claire, les délais de
désertion n’étant pas constatés]
- abandonné son
poste pour avoir, le 3 septembre 1916, veille des attaques sur
Vermandovillers, alors qu’il se trouvait dans les tranchées en
présence directe de l’ennemi (secteur de Vauvillers) abandonné
son poste [qualification illégale et confuse, la circonstance
aggravante « en pr ésence de l’ennemi devant faire
l’objet d’une question séparée qui a été posée mais
présupposée dans la précédente.]
- déserté en
présence de l’ennemi pour s’être absenté illégalement du 3
septembre au 8 du même mois, jour de son arrestation à Caix.
- abandonné son
poste le 8 septembre dans les tranchées de l’Eclipse qui venaient
d’être prises à l’ennemi.
- déserté, pour
s’être absenté illégalement, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu , du 8 septembre au 24 du même mois, jour de
son arrestation à Harbonnières.
- abandonné son
poste, le 7 octobre 1916 dans le secteur de 2è ligne à Wanvillers,
en présence de l’ennemi [question qui n’est résolue qu’à la
majorité de 4 voix]
- déserté du 7
octobre au 12 décembre suivant, jour de sa nouvelle arrestation à
Harbonnières.
La condamnation à
mort n’est donc obtenue que par 4 voix contre une. (frais 124,80
francs résultant des primes de capture des déserteurs). Thomas est
fusillé à Combles (Meuse) le 21 février 1917, à 7h30.
Maurice Marcel
Lecoq, né le 2 novembre 1895 à Paris 14è, fouleur en
peau à Gentilly, célibataire, 2è classe au 226è R.I., sait lire
et écrire
13 octobre 1913,
condamné à 8 jours de prison pour vol, 8 août 1916 CG de la 70è
DI. désertion du 6 juillet 6 mois (sursis)
Le sergent de ville
Pinguet accompagné de son collègue Aumeunier, rapporte au
commissaire de police être – à l’angle du bd Jean Jaurès à
Gentilly- « intervenu dans un groupe d’une dizaine
d’individus dans le but de connaître la situation militaire d’un
soldat qui se trouvait dans ce groupe et qui m’avait été signalé
comme déserteur. Au moment d’intervenir le soldat a pris la fuite,
nous avons pu le rejoindre et l’apprhender ; invité à nous
suivre au commissariat il s’y est refusé et a opposé une vive
résistance en se roulant sur le sol ; plusieurs des jeunes gens
qui l’accompagnaient se sont opposés à son arrestation, sans
toutefois se livrer sur nous à des voies de fait. Le commissariat
informé, quatre collègues sont venus à notre aide, nous avons pu
conduire le soldat au Commissariat et trois des jeunes gens ont été
amené par nos collègues. Le soldat qui est fortement pris [je ne
lis pas « épris » comme Prisme 1418] refuse de faire
connaître sa situation militaire. »
Les trois autre
jeunes délinquants sont Jean Escaut 17 ans, fumiste à Gentilly, et
Pierre Gonthier, 15 ans, tanneur à Gentilly, et André Modé, 16
ans, pâtissier au Kremlin-Bicêtre, lequel se serait opposé avec le
plus de vigueur à l’arrestation. « Quant à nous, suite à
la tombée de la nuit, nous n’avons reconnu aucun des jeunes gens
sus-nommés. Mon collègue Aumeunier a été frappé par le soldat et
ressent une vive douleur au poignet droit, quant à moi j’ai perdu
mon chapeau dans la lutte et j’ai eu ma jaquette déchirée. »
Les trois jeunes gens qui disent n’avoir rencontré Lecoq que le
matin-même (et ignorer sa situation réelle), sont rapidement remis
en liberté.
Premier
interrogatoire de Lecoq le 7 novembre : « J’ai quitté
mon régiment à Froissy (Somme) dans la nuit du 1er au 2
novembre dernier. J’ai pris le train à Amiens et suis arrivé à
la gare du Nord, le 2 novembre vers 8h. Depuis ce jour, je me suis
promené dans Paris, couchant chez des copains qui me croyaient
permissionnaire. Je tiens à ne pas dévoiler leur nom car ils
étaient tout à fait de bonne foi. Hier soir, j’avais trop bu ;
c’est pourquoi j’ai refusé de suivre l’agent au Commissariat.
J’ai d’ailleurs fait en sorte de ne pas les frapper : je me
suis simplement débattu pour ne pas me laisser emmener. Les autres,
me voyant me débattre ont cru qu’on me faisait du mal ; mais
ils n’ont rien fait aux agents. »
Lecoq est reconduit
à son corps par les gendarmes, le jour de la relève (matinée du 12
novembre), près du château de Cappy. Interrogatoire du 14
novembre :
D : -
Reconnaissez-vous avoir quitté votre Cie le 1er novembre
vers 15 heures ?
R : - Oui.
D : - Vous
saviez que le bataillon était alerté et devait monter le soir-même
au point 512. C’est sans doute pour cela que vous avez déserté.
R : -
Parfaitement.
D : - Vous êtes
un coutumier du fait, c’est la 4è fois que vous désertez depuis
votre arrivée au Corps. Quelle sont les raisons qui vous font agir
ainsi ?
R : - L’ennui.
Je ne me plais pas au régiment ; j’ai déjà demandé à
changer de Corps pour passer au 360è R.I. mais ma demande n’a pas
été prise en considération. (…)
D : - Pourtant
l’année dernière vous étiez un bon sujet ; vous avez même
été nommé Caporal. Pourquoi avez-vous changé si subitement ?
R : - Par dépit
d’avoir été versé au 279è R.I. après dissolution de mon ancien
régiment, le 237è.
Lecoq : « Je
reconnais les trois désertions. Je m’ennuyais, je ne recevais ni
nouvelles ni lettre. Je suis au front depuis le 10 avril 1915. J’ai
fait l’Artois, Verdun, mais je n’ai pas fait la Somme. »
Il faut remarquer
que lors de sa première disparition, (13 septembre 1916) Lecoq s’est
constitué prisonnier à la gendarmerie à Paris le 26 septembre,
mais, d’humeur versatile, « Le jour-même de son retour s’est
échappé à nouveau et a été ramené par la gendarmerie, sa Cie
étant de nouveau dans les tranchées de la Maisonnette… A profité
de la difficulté de la surveillance pour s’échapper une troisième
fois dans la nuit qui suivit son retour. »
Rapports du Lt
Chabrolle : « Au moment où il abandonna la Cie, Lecoq
était en prévention de conseil de guerre pour 3 désertions
successives, s’évadant chaque fois avant l’arrivée de l’ordre
d’écrou. »
Un artiste, donc, en
proie au spleen, qui donne pour motif à ses précédentes échappées,
« nostalgie » ou « coup de tête ». Son
insolence et son incurie sont évidemment des preuves certaines de
lâcheté pour ses supérieurs : « Ses désertions
continues donnent le plus mauvais exemple aux autre soldats de la
Cie, qui le voient se dérober aux pénibles devoirs auxquels ils
sont astreints. » Mieux qu’un artiste, un insoumis, un
rebelle, un dangereux aigle parmi les moutons…
« Il professe
ouvertement sa lâcheté, causant ainsi parmi les autres soldats de
la Cie, dont beaucoup sont de jeunes classes et par là même enclin
à accepter comme exacte toute théorie exposée de façon quelques
peu verbeuse, une très fâcheuse impression de pessimisme et d’oubli
du devoir, et rendant très difficile pour l’Officier
l’accomplissement de son rôle d’éducation morale du soldat ».
Tout est dit !
Un révolutionnaire, condamné moins pour ses crimes que pour la
faculté de les répandre.
A force de faire des
martyrs, dans les même unités, on finit par leur donner une
crédibilité plus nuisible pour l’ordre établi que n’eut été
l’indifférence.
Pourvoi en révision
rejeté le 18 janvier 1917, Recours en grâce rejeté
Lecoq est fusillé,
comme Gabriel petit, à mi-chemin entre Berneuil et Attichy, près du
dépôt de munitions (Oise) le 22 février, 6h30.
Joseph Livourne, né le 5 juillet 1877, à Vienne, passementier, célibataire , chasseur de 2è classe au 1er Bataillon de Marche d’Infanterie Légère d’Afrique
14 condamnations au
civil (pour un total d’environ 15 ans de prison), dont vols, cups
et blessures, rébellion envers la force armée plus désertionsen
temps de guerre (18 décembre 1914 et 12 août 1916). Condamné à
mort pour abandon de poste et refus d'obéissance en présence de
l’ennemi, dissipation d’armes, de munition et d’effets
d’équipement par le CG de la 45ème DI (audience du 8 janvier
1917). Notes d’audience :
François Pluchard,
charcutier-caporal : « le 11 décembre, comme je revenais
avec d’autres gradés de Nieuport où j’avais fait la
reconnaissance du secteur, j’ai rencontré Livourne entre
Bost-Dunkerque et le camp Gallimard. Quelqu’un a alors fait cette
réflexion : « Mais nous allons aux tranchées ! »
J’ai remis livourne dans sa section au sergent de jour. Or, 20
minutes après, on est venu me rendre compte que Livourne était
parti. Le 13 décembre, Livourne est arrivé à 11h du matin à la
cuisine [portant une chéchia sur la tête]. Je lui ai donné son
équipement, 120 cartouches 5ce que conteste Livourne déclarant
qu’on ne lui avait remis, ni fusil ni baïonnette], et je l’ai
mis entre les mains de Le Guiff en lui disant de monter aux
tranchées. Il a profité de ce que Le Guiff allait chercher le café
du capitaine pour partir… Livourne avoue cyniquement qu’il
n’était pas allé à Nieuport pour rejoindre sa Cie aux tranchées,
mais seulement pour prendre ses papiers et repartir en absence
illégale. »
Livourne est arrêté
le lendemain 14 décembre à 19h30 à la gare d’Adinkerke au moment
où il se préparait à monter dans dans le train des
permissionnaires. Interrogé sur les motifs de son acte, Livourne
déclare qu’il ne fera de déclaration que devant le Conseil de
Guerre.
Aux gendarmes lors
de son arrestation : « J’ai déserté parce que ke ne me
plaisais pas au Bataillon et que je n’avais pu obtenir de
permission ».
Pourvoi en révision
rejeté le 16 janvier 1917, recours en grâce rejeté le 18 février.
Passé par les
armes le 22 février 1917, à Wariville (Oise) terrain en bordure de
la route Litz-Wariville, à 150m au nord du passage à niveau, à
6h30, avec parade.
André Petit
né le 20 décembre 1895 à Escamps, boulanger à Paris, célibataire,
soldat de 2e classe au 60e Régiment d'Infanterie.
Ne subsiste que le
dossier de procédure en révision. Pas d’ antécédent judiciaire.
- Condamné le 12
février 1917 par le CG de la 14è DI à la peine de mort, pour
double abandon de poste en présence de l'ennemi et double désertion
à l'intérieur en temps de guerre (quatre voix de majorité pour le
principal et trois voix contre deux pour les circonstances
aggravantes).
1- abandon de
poste en présence de l’ennemi commis le 6 août 1916 au bivouac de
Suzanne (Somme)
2 – désertion
à l’intérieur en temps de guerre à Etinehem du 11 au 14 août
1916, s’étant échappé de la prison prévôtale (arrêté à
Paris par les gardiens de la paix)
3 – abandon de
poste en présence de l’ennemi le 4 septembre 1916, entre Suzanne
et les tranchées de première ligne
4 – désertion
à l’intérieur en temps de guerre à Maffrécourt, échappé de la
prison de la 14è DI du 25 octobre 1916 au 12 novembre où il est
arrêté à Héricourt.
Recours en grâce
rejeté le 26 février 1917. Exécuté le 28 février 1917 à Gueux
(Marne). (pas de PV d’exécution).
Mars
Eugène Antoine
Mayet, né le 1er lai 1885 à
Saint-Julien-en-Jarez (Loire), chauffeur à St-Etienne, célibataire,
zouave de 2è classe au 2è RMZ
Condaùné au civil
pour vol (1903) vol et complicité (1906) outrages à agents (1913)
31 mai 1907 :
punition « étant au pas de charge au commandement d’ »En
avant » pour l’assaut, acrié « au jus ! » 9
décembre « a frappé brutalement à la tête un de ses
camarades qui ne lui cédait pas sa place à proximité du 8è
région ; 1 an pour vol au préjudice d’un militaire (4,50
francs)
CG de Lyon : 1
an pour port illégal d’insigne de grade et de décorations et
escroquerie (peine suspendue)
CG de la37è DI (22
février 1917) : Aperçu dans la soirée du 14 décembre, Mayet
ne répparaît que le 18 après l’attaque. Selon ses dires, sorti
des parallèles de départ avec ses camarades, il aurait été enlisé
dans un trou d’obus après cinq cent mètres d’avancée. Rejoint
par des tirailleurs il aurait combattu pendant trois heures à leurs
côtés, avant de retrouver sa Cie qui battait en retraite, fait qui
n’eut pas lieu selon les supérieurs. Il aurait été présent
lorsque l’adjudant Marceau fut fait prisonnier ; mais il situe
ce fait le 15 au soir, alors qu’il eut lieu le 16 au matin et que
seuls trois soldats parfaitement identifiés purent s’échapper.
Dans la nuit du 15 au 16 il serait resté sur place « car des
tirailleurs et des soldats du 136è R.I. étaient chargés de
surveiller l’arrière du champ de bataille avec ordre de faire feu
sur le fuyards (même si Mayet ment, on voit au travers de ses
déclarations que ce dispositif était commun et habituel, ce qui
explique la baisse des cas d’abandon de poste passés en CG, des
mesures de rétorsions ne pouvant être prises qu’envers les
survivants qui eussent été assez « sournois » pour
échapper au jeu de massacre concocté par leurs propres chefs). Le
17 décembre, Mayet serait revenu aux Trois Cheminées, où un
médecin-major lui aurait donnée l’autorisation -verbale- de se
reposer, en conséquence de quoi il serait remonté le lendemain de
sa propre autorité à Verdun.
Mayet, le jour du
conseil : « J’avais des chaussures trop courtes et je ne
pouvais pas marcher. Je n’avais jamais fait d’attaque, je sortais
de l’artillerie, on m’a versé dans l’infanterie. Je n’avais
fait aucun entraînement, je suis resté trois semaines sans
chaussures. Je faisais les étapes en voiture. Je n’ai pas combattu
avec les tirailleurs, je suis resté avec eux parce que je ne pouvais
pas marcher. Si j’avais de bonnes chaussures, je pourrais marcher
en avant. J’ai mis deux jours pour revenir en arrière. Je ne
connais pas le régiment de tirailleurs avec lequel je me suis
trouvé. Je ne pouvais pas me faire comprendre. Je ne connais pas le
médecin qui qui m’a autorisé à me reposer. Je n’étais pas
présent lorsque l’adjudant Marceau a été fait prisonnier,
j’étais dans le ravin, ce sont les camarades qui me l’ont fit à
Verdun. »
Recours en révision
rejeté le 26 février 1917, recours en grâce rejeté ; Mayet
est fusillé à Bezannes (51) le 2 mars 1917 à 8h avec tambours,
clairons et défilé.
Abdelkader Ould
Miloud Mehenni, né en 1886 à Hadjez (Oran), soldat au 2è
RMTA. Aucune trace de procédure, sa fiche de décès porte la
mention « passé par les armes » à Sillery (51) le 5
mars 1917.
Kamel Ben Saad
Salah Ben Mohamed, né en 1896
à Rouiha (canton de Maktar) (Tunisie), 15è section des commis et
ouvriers d’administration, soldat, décédé à l’hôpital
temporaire n°1 de Zeitenlik (sSlonique) Grèce, le 12 mars « tué
par une sentinelle au moment où il tentait de s’évader ».
Alphonse
Ferdinand Jules Lemoine, né le 1er août 1876
à Athis, emplyé de fromagerie à Touregéville (Calvados), 2è
classe au 52è R.I.Territoriale. Déjà condmné le 10 mai 1915 pour
outrages envers un supérieur et ivresse publique et manifeste.
Le 5 mars 1917, le
CG de la VIIIè armée condamne à mort à l’unanimité le soldat
Lemoine pour avoir le 7 octobre 1916, en forêt de Facq, au poste de
1ère ligne de l’allée du cheminot, étant de garde, abandonné
son poste avant d’exercer des voies de fait sur son supérieur le
sergent Sirop, sur lequel il a, sans l’atteindre fait feu presque à
bout portant.
Recours en révision
rejeté le 8 mars 1917
Selon sa fiche de
décès, (pas de PV) Lemoine a été fusillé à Tantonville, 10 mars
1917.
Louis René
Marcel Moreau, né le 4 février 1884 à Damville (Eure),
journalier au Hâvre, chasseur de 2è classe au 3è BMILA
Condamné au civil
quatre fois pour vol et filouterie d’aliments
Relevé de punition
: 216 jours de prison et 55 de cellule
Condamnations par
les conseils de guerre d’occupation du Maghreb, pour sommeil en
faction, désertion en présence de l’ennemi, et à Rouen à 3 ans
de prison pour désertion à l’intérieur en temps de guerre.
Venant d’une
section métropolitaine d’exclus, Moreau arrive à la 4è Cie le 22
septembre 1916. Il la quitte dans la nuit du 4 au 5 octobre 1916,
alors qu’elle est cantonnée à Zuydcoote. Moreau est arrêté le 6
octobre, près de Calais, dans un train à destination de Paris. Il
présente un titre de permission falsifié, à lui délivré par le
maire de Pacy sur Eure le 2 août 1914 pour rejoindre le 159è RI et
dont il a surchargé la date au crayon.
Ramené sous escorte à son
régiment, il le quitte à nouveau au camp Gallimard, le 1er
novembre, veille de la montée en ligne (ce qu’il niera par la
suite avoir su). Il gagne le Havre (« Je voulais revoir ma
famille ») et se présente volontairement au major de la
garnison disant avoir perdu son titre de permission. Autorisé à
prendre le train le lendemain, il se rend à Paris où il se
présente, le 10 novembre au commissaire militaire de la Gare
Saint-Lazare. Ramené à son Corps le 25 novembre, il le quitte à
nouveau le 1er décembre au camp Juniac. Il est arrêté
le 18 décembre en gare d’Avignon, à l’arrivée d’un train
venant de Marseille d’où il avait été signalé comme voyageant
sans billet. Il déclare aux gendarmes qu’il a égaré son titre de
permission, et passé celle-ci chez ses cousins.
CG de la 45è DI,
recours en révision rejeté le 5 février 1917, en grâce rejeté le
10 mars ; Mayet est fusillé à Bus (Somme) [aujourd’hui
Bus-la-Mésière] le 14 mars 1917.
François Louis Ulliac, né le 1er mars 1887 à Lanvenegen où il réside. Affecté au 1er régiment de marche du 1er Etranger, il
est tué à Taza au Maroc par une sentinelle le 19 mars 1917 au moment où
il tentait de déserter. Il avait 30 ans. Son nom est pourtant gravé sur
le monument au mort.
Mostifa Ben
Mokhtar Keskes, né en 1898 à Guidjel (ex
Chasseloup-Laubat, dept de Constantine), du 3è RMT
« Tué
en voulant se rendre à l’ennemi » à Sillery (51) le 26 mars
1917.
Avril
Michel Llinarès,
né le 21 mars 1894 à Oran, soldat au 3è RMTA. « Genre de
mort : « Désertion ».
Sillery (Marne) le 3
avril 1917. On s’enfuyait décidément beaucoup à Sillery ou bien
les papiers des régiments africains étaient-ils tenus un peu plus
consciencieusement qu’ailleurs ?
Alfred Sinn,
né le 22 avril 1893 à Mathiaux (Aube), sans profession, résidant à
Lamotte-Beuveron,2è classe au 1er BMILA
CG de la 45è DI :
condamné à l’unanimité pour double désertion à l’intérieur
en temps de guerre, abandon de poste en présence de l’ennemi,
désertion en présence de l’ennemi. Aucune mention de condamnation
antérieure, pas de PV d’exécution annexé aux minutes.
Extrait du rapport
en révision :
« le 6
novembre 1916, le chasseur Sinn,alors que sa compagnie était
cantonnée au camp Juniac, partait en absence illégale. Le 13
novembre suivant, il était arrêté par la gendarmerie à Villeneuve
(Ain). Ramné sous escorte à son corps, au Camp Jean Bart, le 18
novembre 1916, Sinn s’enfuyait le même jour. Il était arrêté
par la police, à Marseille, le 25 novembre à 14h. Ramené à
nouveau à son bataillon, le 10 décembre, et placé à la section
spéciale du G.B.A., Sinn, tandis qu’il faisait partie d’une
corvée de travail, chargée de porter des hérissons du Grand redan
aux tranchées de premières lignes, le 15 décembre 1916,
abandonnait la corvée et réussissait à s’enfuir. Il était
arrêté à Marseille le 24 décembre, à 23h, par le Service de la
Sûreté. Ramené sous escorte et écroué à la prison militaire de
la 45è division, le 10 janvier 1917, il s’évadait dès le
lendemain et partait pour Paris. Il était arrêté à Pantin, le 13
janvier, par la Gendarmerie… Il a été obligé de reconnaître
qu’il avait abandonné la corvée, alors qu’il se trouvait à
environ 250m des lignes ennemies ».
Pourvoi en révision
rejeté le 5 février 1917, en grâce rejeté le 5 avril.
Sinn est fusillé à
Mourmelon-Le-Petit (Marne) le 9 avril 1917.
Ben Djillali Ben
Aïssa, né en 1896 à Douar Oulad Macar (Maroc), tribu, des Beni
Hassen, soldat au 2è escadron de spahis marocains, « exécuté »
décédé à Agadir (Maroc) le 11 avril 1917
Le 20 avril 1917
paraît la circulaire interdisant l’exécution de tout condamné à
mort par un Conseil de Guerre sans autorisation du pouvoir
politique.
« Lorsqu’un jugement prononçant la peine de mort sera devenu définitif, du fait que le condamné n’aura pas formé de recours en révision, ou que ce recours et le cas échéant le pourvoi en cassation auront été rejetés, le dossier de la procédure devra toujours m’être transmis, avec l’avis des autorités hiérarchiques et le vôtre sur l’opportunité de laisser ou non la Justice suivre son cours.»
Cette circulaire Painlevé abroge celle de son prédécesseur Millerand du 1er septembre 1914.
« Lorsqu’un jugement prononçant la peine de mort sera devenu définitif, du fait que le condamné n’aura pas formé de recours en révision, ou que ce recours et le cas échéant le pourvoi en cassation auront été rejetés, le dossier de la procédure devra toujours m’être transmis, avec l’avis des autorités hiérarchiques et le vôtre sur l’opportunité de laisser ou non la Justice suivre son cours.»
Cette circulaire Painlevé abroge celle de son prédécesseur Millerand du 1er septembre 1914.
Léon Ernest
Petitjean, né le 5 mai 1892 à Bar-le-Duc (Meuse),
célibataire, ferblantier-zingueur à Epernay, soldat, atelier des
Travaux publics n°2, chatain, yeux bruns, 1,63m, tatouages, 1 pensée
à l’avant-bras gauche, 5 points main gauche.
CG du QG de la IIè
armée (14 avril 1917) : (le greffier note en abrégé, tous
les intervenants ont donc l’air de parler un français douteux ).
Pour ce qu’on peut en décrypter, cette scène d’horreur
quotidienne est probablement représentative de tous les passage à
tabac, voire commencement d’exécution sommaire qu’eurent à
subir les soldats indésirables de la part de supérieurs réunis en
bande. La scène eut lieu le 11 mars 1917 à Brocourt (Meuse) :
« Le 10 mars
rentrant du travail, j’ai été informé par le Lieutenant que je
serai enfermé pour affaire pédérastie. Le lendemain j’entendis
pousser cri par détenu. Delhommeau qu’il est frappé tour de bras
par sergent Desumeur-Chiroussel.(?) ceux-ci étaient armés ...(?) et
caoutchouc ; Delhommeau était en chemise sur pied (?)
Lorsqu’ils furent arrivés en face porte cellule, indigné, je
m’écriai « vous n’êtes pas honteux de frapper ainsi un
homme ». Desumeur me dit : « attends, tu vas
voir ce que tu vas recevoir. » Desumeur passa revolver à
Chiroussel qui me tint en joue. Desumeur me dit Sors ! Je
répondis je ne sors pas, car je savais ce qui m’attendais.
Desumeur ramasse grosse pr...y et m’en jette environ 10. Je ne
répondis pas. Chiroussel me tira une balle. Alors Baignon intervint
et dit à Chiroussel « ne tirez pas en avez pas le droit ».
Chiroussel me tira la balle avant que les autres hommes sortent.
Desumeur fit entrer Delhomeau en cellule, puis il dit en parlant de
moi « allons (..?) nous l’aurons tout à l’heure ».
les sous officiers Baignon, Desumeur, Chiroussel et Rousse partirent.
3/4 d’heure après revinrent accompagné Lt Suchaud qui dit à
Chiroussel ouvrir cellule. Lieut donne ordre sortir. Lieut dit à mes
camarades de se coucher car il ne répondait pas des balles perdues.
Lt me dit « rends-toi » Je réponds non : alors il
envoya Chiroussel qui tenait son revolver sans me dire une parole me
tira les 5 balles revolver qui restaient. Une sur le (…?) à la
cuisse. C’est alors que voyant que j’allais être tué
j’improvisai un système de défense ; je jetai des cailloux,
le plus que j’ai jeté c’est 4. Je les ai jetés dans la
direction de la porte mais non dans l’intention de tuer. Je n’ai
lancé des cailloux que lorsque j’ai été blessé. Je n’en ai
pas jeté avant. Si j’ai jeté cailloux c’est que j’ai cru
pouvoir ainsi éloigner Chiroussel ; je ne les ai pas jetés
dans un but mais dans la direction de la porte juste(?) que l’on
vienne pas me tirer dessus. Chiroussel est remonté ensanglanté, je
ne l’ai pas vu. Lieut dit à Baignon d’aller chercher couvercles
marmite pour se protéger ; il me le faut mort ou vif. Il dit
d’aller chercher 3 bottes paille pour m’enfumer. Mais j’avais
mon masque. Lieut fit venir gardes et leur dire de tenir leurs fusils
prêts. Il envoya Jezequel et Blinio pour me sortir. Jezequel dit je
suis détenu comme Petitjean, ce n’est pas à moi à le chercher :
Jezequel me dit de sortir, une 2è fois il revint sur l’ordre du
Lieut me répéter le même ordre. Je sortis et alors le Lieut dit
aux s/of de me tenir en joue. On me donna ordre de me coucher. Je fus
mis une ficelle et puis frappé par bâton du Sergt Roux et Desumeur
me donna coups caoutchouc à travers les reins. Je suis resté
attaché 2 heures. Desumeur vint ensuite m’attacher avec une chaîne
et j’y restai du 11 mars à 8h soir au 13 mars 1 heure
après-midi. »
Témoin Chiroussel :
« Je conduisais Delhomeau lorsque arrivé à la cellule de
Petitjean, celui-ci m’invectiva en disant : « buveur de
sang, vaches » les pierres nous tombaient dessus. J’arrivai à
faire sauter cadenas pour faire sortir détenu. A ce moment je reçus
cailloux, tirai 3 ou 4 coups revolver. Le sang coulait à mon visage.
M’éloignai ensuite. Delhommeau n’a pas été battu. Je n’ai
tiré que lorsque j’ai été blessé et lorsque je reçus cailloux.
Sergent Baignon n’était pas là au moment où je tirai, c’est
Désumeur. C’est Baignon qui a blessé Petitjean.
Sur demande
défenseur : Delhommeau était attaché avec ficelles. Est resté
3/4 d’heures attaché.
- J’ai entendu
dire que Delhomeau allait en cellule pour retrouver Petitjean. Quand
on dit attaché au poteau c’est un mot car les inculpés sont
attachés par terre.
Petitjean : -
Chiroussel frappait Delhommeau avec une dragonne attachée avec un
fil de laiton.
Chiroussel : -
Je ne frappais pas.
Témoin Baignon :
Informé par Chiroussel que Petitjean refusait sortir et qu’il
venait lancer des pierres. Je me suis rendu et avons attendu Lieut
qui vint à 17h1/2. A l’arrivée Lieut je lui rendis compte et nous
nous sommes rendus à la cellule. Lieut dit donnez ordre aux détenus
sortir de cellule. Ils sont sortis se sont couchés. Petitjean resta.
Lorsqu’il a été seul Chiroussel se présenta et à ce moment
pierres tombaient. Chiroussel touché tira 4 coups de revolver –
porte était restée entrouverte après sortie détenus – lorsqu’il
a tiré Chiroussel voyait rien – après avoir tiré 4 coups est
revenu. J’ai ensuite tiré coup sur Petitjean qui a déclaré être
touché. Quand Petitjean est sorti Desumeur et Roux ont ligoté
Petitjean. Je ne me souviens plus de ce que Lt a dit à Jezequel ;
je ne sais plus si il lui a dit qu’il le sortirait d’un mauvais
pas.
S.d. défenseur :
Je n’ai pas dit lorsqu’on a amené Delhommeau : ne tirez
pas malheureux vous n’en avez pas le droit. Je n’étais pas là.
Petitjean :-
Baignon est intervenu au coup de revolver et a dit : « ne
tirez pas malheureux, vous n’en avez pas le droit ».
Baignon : -
C’est faux je suis venu quand Chiroussel m’a prévenu. Je n’ai
pas entendu ce coup de revolver. Je n’ai pas prononcé les paroles
ci-dessus.
Témoin Désumeur :
- Je mettais Delhommeau en cellule. On a été insulté par
Petitjean. j’ai ouvert cellule. Petitjean m’a jeté pierres. Je
n’ai pas été atteint. Ai dit à Chiroussel, prenez un revolver et
tirez » Il me saute dessus. Pas myen d’approcher. Petitjean
me jetait pierres. J’ai refermé porte et ai été prévenir Lieut.
Celui-ci revint au bout 1/2 heure il donna ordre d’ouvrir.
Chiroussel se présenta fit sortir les détenus ; il voulut
faire sortir Petitjean qui jeta pierres. A ce moment Chirousel tira
il était aveuglé par le sang. Il nous jetait pierres. On commença
à tirer dessus. Lieut dit aller chercher paille pour l’enfumer. Il
avait déjà été touché à ce moment par Baignon. On appela 2
hommes Jezequel et Blinio pour faire sortir Petitjean. Nous ne
battions pas Delhommeau quand nous l’emmenions. A ce moment
Chiroussel n’a pas tiré, il n’a tiré que quand il a été
touché. Baignon n’est intervenu qu’avec le Lieutenant. Lorsqu’on
a fait coucher les détenus personne n’a dit couchez vous je ne
réponds pas des balles.
S.d. défenseur :
J’étais à côté de Chiroussel quand il a été blessé. Si je
n’ai pas de toucher(?) ce n’est par la faute de Petitjean
parcequ’il m’a lancé au moins 15 pierres.
Petitjean : -
Il était impossible à Desumeur de voir si Chiroussel tirait en haut
ou en bas.
S.d ;
défensuer : -Chiroussel n’a pas tiré avant d’être touché.
Petitjean a jeté des pierres avant d’être touché. J’ai dit à
Chiroussel tenez vous bien car s’il me saute dessus vous n’aurez
pas le temps de tirer- ne tournez pas la tête-
Jezequel : - Je
n’ai pas vu Petitjean jeter des pierres. J’ai reçu or d’aller
chercher Petitjean en cellule ; le Lieut m’a donné 5 minutes
pour réfléchir. Il ne m’a pas dit « je te tirerai d’un
mauvais pas ou tu es » J’ai exécuté ordre. Quand j’ai été
le chercher il était blessé à la cuisse et il le disait
d’ailleurs.
S.d. défenseur :
lorsuq’on a voulu mettre Delhommeau en cellule une balle a été
tirée mais n’a atteint personne. J’étais à ce moment dans le
fond de la cellule.
Petitjean :
Quand Delhommeau était emmené prison je l’ai entendu dire « ne
frappez pas -punissez-moi, ne frappez pas ».
Sans opposition
défense, lecture dépositions témoins Rousse, Blinio, Lieut
Suchaud : empêchés malade=
« Le médecin
aide-major de 1ère classe Guibal, certifie que Monsieur le S-Lieut
Suchaud commandant le détachement des travaux publics, atelier n°2
est actuellement atteint de poussée aiguë de sa bronchite
chronique. Le 12 avril 17 » [i.e. même pas foutu
d’assumer ses responsabilités]
Lettre de Petitjean,
précédent la mise en accusation :
Bar Le Duc, le 15
mars 1917
Mon Général,
Excusé moi si je prends la liberté de vous écrire C’est à seule
fin de vous mettre au courant des faits qui se passe,t à l’atelier
de Travaux Publics N°2 Secteur 215 où j’étais détenu. Dimanche
Dernier le 11 mars vers 4 heure de l’après midi j’étais en
Cellule lorsque j’entendis pousser des cris plaintifs par un autre
détenu qui était attaché aux poignets et aux pieds par des cordes
qui lui coupaient les membres alors me portant à la porte de la
Cellule je vis trois officier qui sont le serjent Déshumeur armé
d’un Caoutchouc et les serjents Chéroussel et Roux armés chacun
d’un bâton qui frappaeint à tour de Bras sur cet homme attaché
et sans défense. Après l’avoir torturé ils l’ont laissé 2
heures attaché au bout de ce temps après l’avoir détaché ils
l’accompagnèrent jusqu’aux Cellule en le frappant à coups
redoublé, de l’endroit ou il était attaché jusqua la cellule il
y a une distance de 50 mètres en arrivant aux cellules le détenu
Delhommeau s’affaissa contre la Guéritte de la sentinelle c’est
alors qu’indigné par les procédés employé par ces brutes je
m’écriais vous n’êtes pas honteux vous n’avez pas le droit de
frapper un homme comme ça Alors le serje,t Deshuneur me répondit
attend attends ça va être ton tour tout à l’heure puis il passa
son revolver au serjent Chéroussel en lui disant met le en joue
qu’il ne bouge pas et il ouvrit la porte de la cellule quand la
porte fut ouverte il me donna l’ordre de sortir tandis que
Chéroussel me tenait en joue avec le revolver du serjent Deshuneur.
Sachant fort bien ce qu’il mattendait je refusait de sortir de la
cellule alors le serjent Deshumeur me jetta plusieur pierre sans
m’atteindre tandis que Chéroussel me tira une balle de revolver
qui me passa entre les jambes. Alors Deshumeur me donna ivre 2ème
fois l’ordre de sortir voyant ma vie en danger je refusait de plus
belle Deshumeur dit à Chéroussel c’est pas la peine d’insister
nous l’auront tout à l’heure il referma la porte de la cellule
et partirent Trois quart d’heure après Tous les sous officiers
accompagné du Lieutenant chef de Détachement vinrent à la porte de
la Cellule. C’est Alors que le Lieutenant donna l’ordre au
sergent Chéroussel d’ouvrir la porte ceci fait il donna l’ordre
à toutle monde de sortir nous étions au nombre de 21 tout le monde
sortit sauf moi quand tout le monde fut sortit Le Lieutenant donna
l’ordre aux 20 détenus de se coucher à plat ventre derriere la
butte de terre qui recouvrait la cellule car il leur dit je ne répond
pas des balles perdues alors il donna l’ordre à tous les sous
officiers de sortir leur revolver et me donna ensuite l’ordre de
sortir je compris que j’allais être tué je refusais de sortir.
Alors le Lieutenant donna l’ordre au serjent Chéroussel d’aller
me chercher mais celui ci ne me dit aucune parole il s’avança à
la porte de la cellule et me tira à bout portant les cinq balles qui
restaient dans son revolver dont une vint me frapper à la cuisse
droite me voyant blessé et rendu fou par la douleur et l’odeur de
la poudre je ramassais de cailloux et j’en lançais un qui frappa
Chéroussel dans la figure celui çi se sauva et le lieutenant
commanda feu aux autres sous officier qui me tirère encore 12 balles
mais sans m’atteindre
Suite
Voyant que
j’insistait à ne pas sortir Le Lieutenant envoya le sergent
Baignont Chercher trois couvercle de marmitte en fonte en lui disant
avecça vous vous ferez un bouclier et vous rentrerai le chercher il
me le faut mort ou vivant le sergent Beignont lui répondit que s’il
avait les 2 mains embarassées il ne pourrait pas se défendre et il
n’est pas descendu c’est alors que le lieutenant envoya chercher
trois bottes de paille et commanda de m’enfumer dans la cellule
mais il s’apperçu que j’avais mon masque contre les gaz et
abandonna son projet. Alors il y envoya chercher la Garde soit une
quarantaine d’hommes et leurs fit charger les fusils et leur dit
tenez vous prêt. Mais il réfléchit quelques instant et envoya
chercher les détenus Jéséquel et Blino leur donna l’ordre de
venir me chercher dans la cellule. Ceux ci dirent au Lieutenant
qu’ils étaient Détenu comme moi alors le Lieutenant dit à
Jéséquel Tu sais de quel pas je te tire alors Jéséquel s’apprèta
à rentrer dans la cellule ne rentre pas tu n’est pas ici pour
fiare le travail des Chaouchs tu est détenu comme moi alors il
retourna sur ses pas et dit vous voyez mon Lieutenant il ne veut pas
sortir Le Lieutenant lui répondit c’est un ordre que je te donne
et tu as 2 minutes à réfléchir comme je te l’ai dis je te
sortirai du mauvais pas ou tu est. C’est alors que Jéséquel
accompagné de Blino revinrent à la porte de la cellule et me dirent
rend toi tout est fini alors je réfléchi et je sortit accompagné
de Blino et Jéséquel aussitôt sortit le Lieutenant aux sous
officier de me tenir en joue et de tirer au premier mouvement. Le
Lieutenant me dit alors de me coucher au pied de la guéritte du
factionnaire à côtéd’un arbre et dit au sergent Deshumeur
d’aller chercher une chaîne et il me fit attacher au pied de cet
arbre ou restais du 11 Mars à 6H1/2 du soir jusqu’au 13 à une
heure à pré midi moment ou les Gendarmes sont venu me chercher pour
m’emmener à Bar-Le-Duc.
Mon Général je
vous ai fait cette lettre un peu longue mais c’est pour bien vous
expliquer l’affaire comme elle est arrivée à seule fin que vous
fassiez une enquête au sujet des inquisitions qui se passaient à
Brocourt car si j’ai eu un mouvement de Révolte en voyant frapper
un homme comme ça c’est que ce n’est pas la première fois que
cela se passe beaucoup de détenus ont déjà été brutalisés par
l’ordre du Lieutenant à ses sous officiers. Maintenant mon Général
j’ai bien réfléchi je regrette sincèrement le malheur qui est
arrivé mais j’espère que vous ferez une enquête et que vous vous
rendrez compte par vous même que je ne suis pas le plus coupable
dans cette affaire. »
Lettre de Delhommeau
à Monsieur Deibler Exécuteur des Hautes Oeuvres Préfecture de
Police de Paris (prière de faire suivre :
Bar-le-Duc, le 31
mars 1917,
Mon vieux Deibler,
Tu nous excuseras un petit chouaille nous sommes ici cinq numéros
qui comptent bien un jour faire connaissance avec ta machine à
raccourcir c’est pourquoi mon poteau nous t’écrivons cette
lettre à seul fin de pouvoir te filer un coup de pompe d’une Tune
car pour la somme que tu vas toucher pour nos cinq tronches tu peu
bien te lâcher d’une bougie. Maintenant mon vieux poteau sait
certain qu’ont recommandera ton meuble à tous les amminches qui
sont digne de mourir en brâve. Tu vois, l’amminche, nous pensons
tous à toi, les bôches voudrais bien notre tronches mais nous
préférons te la donner à toi car tu sais que lorsque nous avons un
amis comme toi nous le laissons pas tomber comme cela. Je te fais
s’avoir que nous avons pas de marainne de Guerre sest pour cela que
nous t’écrivons à seul fin de t ‘apprendre que nous
t’avons nommé notre parrain. Maintenant je vais te citer le nom de
tes filleuls reconnaissants d’avance :
Delhommeau dit
Touneuf, Jean B. Mézières dit Bouboule de Belleville encore mieux
Fort-Coup-de-Boule du Ménilmompelpoche, Dupècher dit Lapêche,
Pavetavitjavean [Jean Pavit?] dit Lachique, Chabas dit
Bindi-Souairt. »
Il est évidemment
inutile de citer le rapport officiel que chacun pourra consulter :
il défend mordicus la bande d’enflure à galons. Toutefois
quelques éléments de contexte restent à en retirer, que la cellule
en question était « une sorte d’abri souterrain entouré
d’une enceinte barbelée, à laquelle on accède par un boyau de
quelques mètres. De nombreux détenus y étaient incarcérés (17
environ) », que l’armée se préoccupait grandement de ce que
ses larbins faisaient de leur cul (probable ferment d’indiscipline)
puisque Delhommeau est désigné comme « ami plus qu’intime
de Petitjean », lui-même enfermé, on l’a vu pour une
« enquête sur une affaire de pédérastie », que selon
Petitjean, le sergent Chiroussel était ivre (élément probable de
l’expédition punitive homophobe) :
« Le détenu
Petitjean a la réputation d’un individu excessivement dangereux,
d’une mentalité déplorable. Il se glorifie de son attitude. Il a
plusieurs condamnations civiles et a passé plusieurs fois en conseil
de guerre ».
Les interrogatoires
d’instruction sont évidemment menés sous l’autorité du
sous-Lieutenant Suchaud :
Désumeur désiré,
30 ans, marié, domicilié à Orléansville : « Le 11 mars
vers 17 heures, avec le sergent Chiroussel, je conduisais le détenu
Delhommeau en cellule. Il avait été puni par moi de deux jours de
cellule à raison de son attitude injurieuse à mon égard ; en
réalité il l’avait fait exprès voulant aller rejoindre en
cellule son camarade Petitjean. Il avait passé une demi-heure au
poteau et je le reconduisais à la cellule avec Chiroussel…
Delhommeau dans la nuit, de la porte, a crié à Petitjean :
« Quand tu seras oà Bar-Le-Duc, tu diras bien au conseil comme
je t’ai dit. C’est le factionnaire Legay, du 248, qui m’a
rapporté ce propos. Delhommeau au surplus passe pour être « la
femme » de Petitjean. J’ajoute que j’ai entendu dire qu’il
me fallait, ainsi que Beignon, prendre des précautions, ces gens là
en voulant à notre vie, ils doivent même nous poignarder en pleine
séance. »
Baignon Eugène
Louis, 36 ans, marié, un enfant : « Chéroussel s’était
plaint notamment que Petitjean l’aurait menacé et lui aurait dit :
« Si tu entres dans la cellule je te ferai la peau… Le
lieutenant a dit alors à Jézéquel « sors-le » en
l’invitant à donner un bon exemple. Ils l’ont aussitôt sorti.
Petitjean injuriait tout le monde, criant : « Bande de
canailles, de vaches, vous n’avez qu’à me finir, au moins je
serai débarrassé. » Il s’adressait aussi bien au Lieutenant
qu’aux sous-officiers. On l’a attaché au dehors sous une tôle
ondulée. »
Petitjean :
« Sachant ce qui m’attendait, c’est-à-dire être mis aux
ficelles et passé à tabac, j’ai refusé de sortir… D’après
moi, j’étais en cas de légitime défense. Je n’ai jamais vu
canarder un détenu de dix-huit coups de revolver. Dans le fin fond
de l’Afrique il ne se passe pas le dixième de ce qui se passe
ici. »
12 mars 1917,
rapport du lieutenant Suchaud : « Le détenu
petijean était en cellule depuis la veille, ayant reçu de Monsieur
le Rapporteur auprès du conseil de giuerre de Bar-le-Duc, la mission
de faire une enquête au sujet d’une affaire de pédérastie, dans
laquelle Petitjean était impliqué (affaire Genevois). Je suis tout
à fait convaincu que se voyant perdu, il a tenté de se faire tuer
pour éviter une condamnation qui pouvait le mener aux travaux
forcés… Je demande en outre à ce que ce détenu soit condamné
avec la dernière rigueur ; il faut que mes sous-officiers
soient enfin surs de pouvoir faire leur service, sans avoir la
crainte d’être à chaque instant assassiné traîtreusement par de
tels individus… Le détenu Delhommeau est très lié avec
Petitjean, il y a tout lieu de croire, par leur allure et leur façon
d’être vis à vis l’un de l’autre, que l’un est pédéraste
actif et l’autre passif, ce qu’il y a de certain c’est que le
matin même, Delhommeau s’est mis sans un cas de conseil de guerre,
pour pouvoir aller en cellule retrouver son ami ; Petitjean et
Delhommeau étaient à l’atelier n°4 à Evres, ils ont passé au
conseil de guerre à Bar-le-Duc ensemble, et furent affectés et
arrivèrent le même jour à l’atelier de Travaux publics n°2. »
Recours en révision
rejeté le 18 avril 1917 (cassation de la disposition de contrainte
par corps uniquement). Aucun recours en grâce présidentielle n’a
été présenté. Le jour même où paraît la circulaire Painlevé,
20 avril 1917, Petitjean est exécuté à Rampont à 18h30 :« une
balle a perforé le cœur et la poitrine était traversée de part en
part de huit autres balles, dont 3 dans la région précordiale et
cinq dans le reste de la cage thoracique. Le coup de grâce a été
donné dans la tempe gauche. ».
Il n’est pas
étonnant que cette affaire demeure pratiquement inconnue, ni que les
rares chercheurs qui s’y aventurent accordent plus de crédit à la
parole des tortionnaires qu’à celle des victimes. Pourtant, tout
est là, sous leurs yeux. Quelle que soit la réalité des faits,
Petitjean a réussi à laisser à l’histoire un témoignage de
première main sur le comportement des matons dans cette société
faisandée qu’est la France du début du 20è siècle. 100 ans plus
tard, nous en sommes au même point, le doute ne profite qu’aux
puissants et à leurs chiens de garde « à chaque instant
assassinés traîtreusement » !
Un jour viendra...
Mai
Marcel Georges
Daubignard, né le 3 janvier 1886 à Paris 18è, carreleur à
Saint-Ouen, soldat au 82è R.I.
Condamné une
fois au civil pour vol, par le 3è CG de Paris le 16 janvier 1915
pour désertion à l’intérieur, le 8 mars 1915 pour abandon de
poste
CC de la 9è DI.
Déclaration
Daubignard : J’ai quitté mon Corps à Muney le 13 octobre
1916 pour aller voir mes parents que je n’avais pas vus depuis le
début de la campagne. Je suis resté absent illégal jusqu’au 31
du même mois, date où j’ai été arrêté. J’ai abandonné à
nouveau mon régiment le 16 novembre 1916 aux casernes Bévaux près
de Verdun. Mais je n’ai pas commis d’abandon de poste en présence
de l’ennemi. On m’a fait sortir des locaux disciplinaires, il est
vrai, mais je croyais que c’était pour prendre une couverture et
je me suis sauvé. Je ne savais pas que le régiment devait remonter
en ligne car personne ne m’a rien dit à ce sujet. » Les
seuls deux témoins cités reconnaissent effectivement n’avoir rien
dit à ce sujet, même si le fait que tout le monde faisait son sac
leur paraissait une indication suffisante. Mais la Cie devait d’abord
monter aux casernes Marceau avant de gagner les lignes. Le
commissaire -rapporteur écrit même en toutes lettres : « Nous
nous sommes efforcés, sans du reste y réussir, de faire la lumière
sur ce point ». pas plus le caporal sévenec que le sergent
Rigollet, le second n’était au régiment que depuis 2 jours, ne
connaissaient Daubignard. Daubignard est arrêté le 25 décembre
1916.
Recours en
révision rejeté le 19 mars 1917, recours en grâce rejeté le 2 mai
1917: il est fusillé à
Montigny (Marne)
le 4 mai 1917 à 5h. Le pourvoi introduit par sa veuve est rejeté à
nouveau le 18 avril 1932.
Auguste Eugène
Defis, né le 10 juillet 1890 à Vincennes, élevé à Vermenton
par son tuteur, célibataire, photographe, 2è classe au 82e
R.I.
Condamné le 10 mai
1916 par le CG de la 10è DI à 10 ans de TF (refus d’obéissance
pour marcher contre l’ennemi, peine suspendue), Defis, lui, est
arrivé aux casernes Marceau. C’est pendant le transfert à Vaux,
profitant d’une nuit très noir qu’il disparaît le 22
novembre1916. Il se rend à Paris, pour voir, dit-il, son cousin qui
devait partir pour Salonique deux jours plus tard. Il est arrêté le
2 janvier 1917. Lors de son interrogatoire, à la question posée de
savoir pourquoi il n’est pas retourné à son corps après ces deux
jours, Defis répond simplement « qu’il se trouvait mieux
chez lui que de revenir à Verdun ». Les 240 jours de punition
qu’il cumule permettent de l’accabler facilement.
Defis est accusé
d'abandon de poste en présence de l'ennemi et de désertion à
l'intérieur en temps de guerre. Lors de l’audience du CG de la 9è
DI, le 20 mars, le témoin principal est disparu (fait prisonnier)
durant l’offensive, l’autre a été dirigé d’urgence sur une
nouvelle destination.
« Après mon
arrestation du 2 janvier j’avais rejoint mes camarades aux
tranchées près de Berry au bac, j’y suis resté jusqu’au 20
février 1917, et à cette datte, j’ai quitté ma Cie qui était au
repos… j’ai pris le train et je me suis rendu à Paris. Au bout
de dix jours, le 2 mars 1917, je me suis présenté volontairement à
la place de Paris… Je croyais passer mon conseil de guerre de suite
et changer après de régiment »
Le ministère de la
guerre, rejetant la demande de grâce, demande des explications au
rapporteur quant au fait que ce dernier abandon de poste n’est pas
été instruit ou poursuivi.
Pas de pourvoi en
révision.
Edmond
Pierre Jésus, ne le 19 octobre 1890 à Crépy en
Valois, forain, Mettray, 13è Régiment de chasseurs à cheval, 4è
escadron;1,65m blond, yeux roux, oreilles décollées, tatouages, une
rose au bras droit, une branche de trèfle au bras gauche. Jamais
condamné. Punitions : 319 jours de prison, 129 de cellule
(nombreuses insolences, refus d’obéissance, violences, menaces)
Le
soldat Jésus s’est réellement tiré une balle dans le pied, comme
en témoigne la pièce de conviction, sa chaussure gauche présentée
à l’audience. « Fractures compliquées des articulations
tarso-métatarsiennes droites par balle : tunnel à entrée sur
le bord interne du pied et à sortie sur le bord externe. »
Le
1er janvier 1917, Poincelot et Jésus sont placés en
sentinelles au poste d’écoute en avant des premières lignes. Le
Maréchal des Logis Mullet entend cinq coups de feu.
Témoignage
Ernest Joseph Poincelot : « J’étais de faction au poste
d’écoute avec le chasseur Jésus. Au cours de la conversation il
me dit : « J’ai envie de me flanquer une balle »,
je lui répondis « tu ne ferais pas cela ». Il reprit
« si, je veux me casser la cheville ». Presque
immédiatement après il tira deux ou trois balles depuis la
tranchée, puis, montant sur le talus, il tira un nouveau coup de
fusil et me dit « ça y est, cours appeler à la tranchée.. Je
lui répliquai « ce n’est pas possible, tu n’as pas eu ce
culot ». Je regardais de près pour voir si effectivement le
sang coulait. Dès que je me fus aperçu qu’il était réellement
blessé, j’allai appeler de l’aide. Le maréchal des logis Mullet
vint avec moi. Jésus lui raconta alors qu’il avait tiré sur les
bulgares qui l’avaient blessé, tandis que lui n’en avait pas
tué. »
Rapport :
« il était à la connaissance des gradés que l’inculpé se
vantait à chaque instant de passer à la première occasion dans les
lignes ennemies. »
Jésus,
après ses aveux : « J’étais mal vu des gradés qui
connaissaient mon passé : je ne parle pas de mon lieutenant et
de mon capitaine qui étaient bons pour moi mais des chefs
supérieurs. J’espérais, en commettant l’acte qui m’est
reproché me soustraire à l’autorité de mes chefs actuels et être
changé d’unité après ma guérison. Je pensais d’autre part, au
cas où le fait ne serait pas découvert que l’on me tiendrait
compte de ma blessure et que je pourrais ainsi racheter mon passé. »
CG de la 57è DI
Recours en révision rejeté le 20 mars 1917, recours en grâce
rejeté le 4 mai, Jésus est fusillé le 4 mai 1917 à l’âge de 27
ans à Monastir (Bitola, Macédoine), 5h30.
Mort par la
France (Tué à l’ennemi).
Lucien Jacquot,
né le 08 décembre1896 à Vincennes Soldat au 9è Régiment de
Marche de Zouaves « Déserteur tué en s'évadant » à
Courteçon (Aisne) le 18 mai 1917.
Prosper Paul
Godot, né le 6 avril 1890 à Paris 18è, 2è classe au 4è
BMILA, tailleur d’habits à Saint-Ouen, célibataire
CG du détachement
du sud tunisien. Témoins absents, leurs déclarations sont lues par
le greffier, elles n’existent plus, seules les minutes du jugement
subsistant. Recours en révision rejeté le 20 mars 1917. Godot
est-il coupable d’avoir exercé à Tataouine une voie de fait
envers son supérieur, le sous-lieutenant Poli du même corps ?
Recours en révision
rejeté le 22 maiGrâce rejetée le 24 mai. Godot est fusillé à
Médenine (Tunisie) « à la parade » le 25 mai à 5h.
Edmond
Petitfrère, né le 3 avril 1894 à Rumigny (Ardennes)
Mort à
Courcy (Marne) le 28 mai. La fiche de décès porte sur la ligne
« genre de mort » un point d’interrogation suivi sur la
ligne du dessous de « non imputable au service ».
Juin
Alors qu’à peine 509 désertions
avaient été signalées, en 1914, puis 2 433 en 1915 et 8 924 en
1916, leur nombre s’élevait déjà aux alentours de 15 000 sur les
six premiers mois de 1917.
Voir la Thèse
d’André Loez dont l’annexe,
disponible en ligne présente des tableaux fort intéressant
permettant de mesurer l’ampleur du phénomène. Selon cette
documentation, la première mutinerie attestée a eu lieu le 29 avril
au 20è R.I. sans violences, la dernière le 5 septembre au 151è
R.I. voit des officiers molestés, la plus longue et la plus
organisée, comptant 1500 participants du 3 au 12 juin au 21è R.I. ,
camp Berthelot, avec fusillade, Internationale et drapeau rouge.
Tracts, chansons et affiches circulent, les graffitis abondent. Dans
le cantonnement vosgiens de la 15è DIC, une planchette apposée sur
un arbre le 14 juin porte l’inscription : « crevons nos
officiers, la guerre finira ».
« Les mutineries se manifestèrent
essentiellement par des refus de certains soldats de plusieurs
régiments de monter en ligne. Ces soldats acceptaient de conserver
les positions, mais refusaient de participer à de nouvelles attaques
ne permettant de gagner que quelques centaines de mètres de terrain
sur l'adversaire.
Cette grande crise au sein de l'armée
française amena son lot de sanctions contre les mutins. Environ 3
500 condamnations, en rapport avec ces mutineries, furent prononcées
par les conseils de guerre avec une échelle de peines plus ou moins
lourdes. Il y eut entre autres 1381 condamnations aux travaux forcés
ou à de longues peines de prison et 554 condamnations à mort dont
49 furent effectives parmi lesquelles 26 l'ont été pour actes de
rébellion collective commise en juin ou juillet 1917. »
(Prisme 1418)
Divers rapports du commandement
cherchant à déterminer les causes des mouvement, outre celles
d’ordre militaire (retard des permissions, manque de nourriture)
désignent la mauvaise influence de l’intérieur sur le front, la
dénonciation par la presse de la faillite du commandement et
l’excitation causée par les commentaires sur la révolution russe
et la Conférence de Stockholm et celles « des femmes qui ont
entendu des propos révolutionnaires », la distribution de
tracts pacifistes « par le canal des permissionnaires »,
la « certitude que le gouvernement cache la vérité et
« bourre le crâne » des soldats, la rumeur que les
femmes et les enfants vont manquer de charbon et de nourriture, la
rumeur que les agents de police, les annamites et les troupes noires
massacrent les femmes et tirent à la mitrailleuse à Paris »
"Et faites des enfants, vous qui n'en faisiez guère"(Apollinaire)
Parmi ces causes, que le commandement ne
considère que comme des rumeurs, les pénuries alimentaires, et les
gréves des femmes sont une réalité. Elles constituent même,
quoique l’histoire officielle s’efforce de l’occulter,
peut-être le mouvement social le plus important du 20è siècle,
détrônant mai 68 en tant que cinquième révolution française.
Dessin
de guerre de Forain : « Pourvu qu’ils tiennent ! -
Qui ça ? - Les civils !
La
révolution des femmes
"Si
les femmes qui travaillent dans les usines s'arrêtaient vingt
minutes, les Alliés perdraient la guerre !" Cette boutade de
Joseph Joffre, prononcée en 1915, anticipe l'effroi que va susciter
un mouvement social que personne n'avait vu venir. En 1917, 430.000
femmes travaillent dans les usines d'armement ; si la France et
l'Angleterre ont puisé de la main-d'œuvre dans leurs empires
coloniaux, les femmes constituent la première réserve. C’est
alors qu’apparaît le mot de midinettes, midi +dinette, celles qui
mangent sur le pouce.
Debout de dix à quatorze heures par
jour, les "munitionnettes" effectuent un travail harassant
- les lois de salubrité sont suspendues. Ce n'est guère plus
reluisant dans l'industrie du vêtement, qui voit fleurir le travail
à domicile. Ces "cousettes" qui s'épuisent sur leurs
Singer pour 2 francs la journée sont qualifiées de "victimes
les plus lamentables de la guerre" par le maire de Lyon Edouard
Herriot. Une précarité aggravée par l'explosion des prix de la
vie. Le charbon anglais ne traverse plus la Manche alors que l'hiver
est le plus froid de la guerre - la Seine est prise dans les glaces,
les températures restent sous zéro jusqu'en avril.
Ce sont donc les ouvrières qui, seules,
déclenchent la première grève à Paris: 10 000
couturières grévistes. L’Humanité décrit ces milliers
d’ouvrières, derrière leurs pancartes improvisées : « Les
corsetières arborent fièrement une jarretelle en soie bleu ; une
plume d’autruche indique le groupe des plumassières ; les
employées de banque ont collé sur un carton l’affiche du dernier
emprunt. […] Nos vingt sous ! La semaine anglaise ! Rendez-nous nos
poilus, scandent les manifestants. On voit les cochers de fiacre et
les chauffeurs de taxi faire monter les grévistes pour les amener à
la Grange-aux-Belles, le siège de la CGT, [qui déjà campée sur sa
ligne collaborationniste, refuse de prendre leur action en
considération]. Des soldats en permission accompagnent leurs petites
amies et les gars du bâtiment descendent de leur échafaudage pour
applaudir ces jolies filles. »
Peter Read in Apollinaire et les
Mamelles de Tirésias :
Le
mouvement s’étend du 12 mai jusqu’à la mi-juin, pour
l’essentiel, bien qu’il ne s’arrête totalement qu’à la fin
juillet. Le mouvement est déclenché par les 250 couturières de la
maison Jenny, aux Champs-Elysées. Rapidement, d’autres «
midinettes » les rejoignent et des foules importantes d’ouvrières
défilent sur les boulevards : « C’est presque la fête, un
immense sentiment de force et de libération. En quelques jours, la
grève s’étend à toute la corporation, aux industries du vêtement
et même à toutes les industries féminines parisiennes ; plus de
20000 femmes ont cessé le travail. » Elles réclament une
augmentation de 20 sous (un franc) par jour et « la semaine anglaise
» (c’est-à-dire le samedi après-midi libre). Le 18 mai, 10000
ouvrières se réunissent à la bourse du Travail. Le mouvement
s’amplifie, les employées de banque, les confectionneuses
militaires, les serveuses de restaurant, les ouvrières en caoutchouc
et bien d’autres grossissent le flot des mécontentes. C’est «
l’aurore aux doigts de rose», une vague dont le sommet se situe
entre le 29 et le 31 mai, avec 54 grèves dont 24 nouvelles pour la
seule journée du 30, mobilisant plus de 50000 grévistes.
Il ne s’agit pas d’une grève
générale, mais plutôt de grèves « généralisées », passant de
secteur en secteur. Les grèves ont en commun avec les mutineries
militaires qu’il n’y a pas de cohérence organisée, qu’elles
naissent de façon spontanée. Un porte-parole de la CGT s’efforce
de minimiser la dimension politique des revendications féminines : «
Les grèves présentes ont comme origine la cherté de la vie. La
hausse constante des denrées nécessaires à l’existence a
déterminé un déséquilibre tellement grand dans les budgets des
ouvrières que ces dernières se sont vues contraintes de réclamer.
Vers la fin du mois
de mai, la grève atteint les usines Renault et Samson : le
gouvernement et les employeurs font des concessions importantes. Un
projet de loi, rapidement voté, et promulguée le 11 juin impose
l’usage des contrats collectifs de travail dans l’industrie du
vêtement : « véritable révolution pour le monde industriel et
grand acquis syndical, prélude à la loi du 23 avril 1919
généralisant les conventions collectives »
Un interdit moral
avait été franchi, celui de faire la grève en temps de guerre. Au
cours du mois de juin 1917, on compte plus de 70 000 grévistes,
hommes et femmes confondus, dans les usines de guerre de la région
parisienne. Un mot d’Anatole France, au sommet de sa gloire, est
alors abondamment cité dans les écrits et les tracts
contestataires : « On croit mourir pour la patrie et on
meurt pour des industriels. » Il formule une ligne de pensée
qui réunit mutins du front et grévistes de l’arrière.
Avec le sérieux qui la caractérise,
Marcelle Tinayre définit l’état d’esprit de la nouvelle
génération dans un article intitulé « Pour les femmes.
Gagner sa vie », à la une du Journal du 24 juin 1917 :
Les idées et les mœurs ont bien changé. Ce n’est plus que dans les toutes petites villes que l’on trouve encore des familles imbues de vieux préjugés et des femmes qui regardent le travail comme une déchéance. La majorité des Françaises est plus sérieusement instruite, mieux armée pour la vie réelle, moins timide et moins romanesque, moins résignée aussi que nos grand-mères.
Nous le constatons aujourd’hui particulièrement. La guerre, en privant de ressources des milliers de femmes, a créé parmi elles le besoin et la volonté du travail. Les petites-filles des « dames » défuntes avouent leur pauvreté et, conscientes de leurs droits et de leurs forces, demandent à vivre, laborieusement et proprement. »
"Et faites des enfants, vous qui n'en faisiez guère"(Apollinaire)
Graffiti
relevé dans un train de permissionnaires en Gare du Nord le 27 juin
1917
« Camarades
ne faites pas de gosses car ils servent à défendre les
capitalistes »
graine de morts : l'effrayante propagande
nataliste, prédisant que les enfants de 17 seront les déportés de
42
Les câbles tenus secrets de l’Armée
au gouvernement sont parlants. Extraits :
« 13 mai 1917. Gouverneur militaire
Lyon. Les ouvrières chargement cartoucherie Valence au nombre de 950
ont pris prétexte hier soir d’une modification tarifs salaires
pour cesser travail et rester bras croisés dans ateliers. En
présence de cette attitude, directeur les a autorisées à sortir à
minuit 30. Sortie s’est effectuée tranquillement mais groupement
s’est formé plus loin et manifestation comprenant environ 500
femmes s’est produite rue Valence. Actuellement grève continue.
Femmes des autres ateliers en tout 2 500 ont cessé travail moins par
esprit de solidarité que par crainte des grévistes. Après-midi
cortège s’est formé sans violences et autre incident.
Directeur aidé du syndicat s’efforce
de faire reprendre travail. Mais ce soir n’ayant pas encore abouti,
personnel avisé par affiche que ateliers chargements et fabrications
fermés jusqu’à nouvel ordre ainsi que autres ateliers de femmes.
Hommes continuent travail dans mesure possible. La grève a pour
prétexte des questions salaires mais en réalité pour cause de
lassitude, énervement, difficultés de vie, privations notamment de
charbon et en général mauvais esprit continue à régner chez
personnel féminin. »
« Rennes. 5 juin 1917. Préfet Ille et
Vilaine à Intérieur. Suis informé qu’un mouvement ouvrier se
prépare à l’arsenal de Rennes où deux à trois mille femmes vont
quitter travail demandant modification des salaires. »
« Rennes. 6 juin 1917. Préfet à
Intérieur et Sous-secrétaire d’État Munitions Paris. Grève des
ouvrières de l’Arsenal annoncée hier continue en s’accentuant.
Elle s’est étendue au personnel masculin de cet établissement et
ce matin seuls les ouvriers mobilisés ont repris le travail. Toute
la matinée, des cortèges de femmes ont parcouru la ville essayant
de débaucher les ouvrières des différents établissements
travaillant pour la guerre. Des cris de « A bas la guerre » sont
poussés par une bande de femmes et de jeunes gens malgré le poste
militaire trop faible ; dans cette usine 250 femmes ont été
débauchées.
A la fonderie THAU un cortège de femmes
a également forcé la porte, une centaine de femmes ont été
débauchées.
Toutes ces manifestations débordent le
syndicat de l’Arsenal qui déclare avoir été surpris par cette
grève et essaie de l’organiser dans le sens de la modération. […]
Vais m’entretenir avec Président du syndicat et secrétaire Bourse
du Travail pour obtenir leur concours et leur exposer de maintenir au
mouvement le caractère de revendications corporatives faute de quoi
l’autorité ne pourrait continuer aux manifestants la confiance et
l’indulgence accordés jusqu’ici. […]
Importante réunion grévistes aura lieu
aujourd’hui à 16 heures pour entendre direction arsenal aux
réclamations soumises ce matin 11 heures. »
La censure postale envoie à la 5e
division d’infanterie cette lettre, interceptée le 5 juin 1917,
d'une munitionnette, à son fiancé sur le front : « J’approuve
les poilus qui ne veulent plus rien savoir de la guerre. A Paris, les
grèves succèdent aux grèves et les poilus permissionnaires sont
contents ». Et elle lui écrit la chanson entonnée dans les
manifestations : « Et l’on s’en fout/ On aura la semaine
anglaise/ et l’on s’en fout/ on aura les vingt sous ! »
Durant l'année 1917, 694 grèves
affectent l'économie de guerre; elles sont menées essentiellement
par des femmes et des jeunes hommes.
Pétain fait aussi interdire par le gouvernement toute propagande
pacifiste et syndicale et renvoyer le préfet de police de Paris qui,
selon lui, a laissé les grèves s'étendre dans la capitale.
Tract manuscrit : La révoluson ou la fin de la guerr
trouvé par le général Féraud et joint à son rapport du 1er juin 1917
Témoignage extrait des carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier de Béziers, sur les mutineries du 30 mai au 6 juin 1917 :
"La
révolution russe eut une répercussion sur le front français et un vent
de révolte souffla sur presque tous les régiments. Il y avait d'ailleurs
des raisons de mécontentement ; l'échec douloureux de l'offensive du Chemin des Dames qui n'avait eu pour résultat qu'une effroyable
hécatombe, la perspective de longs mois encore de guerre, enfin, c'était
le très long retard des permissions c'était cela je crois qui irritait
le plus le soldat.
Un soir, un caporal chanta des paroles de révolte contre la triste vie de la tranchée, de plainte, d'adieu pour les êtres chers qu'on ne reverrait peut-être plus, de colère contre les auteurs responsables de cette guerre infâme, et les riches embusqués. Au refrain, des centaines de bouches reprenaient en choeur et à la fin des applaudissements frénétiques éclataient auxquels se mêlaient les cris de " Paix ou révolution ! A bas la guerre ! Permission ! Permission ! ". Un soir, patriotes, voilez-vous la face, l'Internationale retentit, éclata en tempête. Cette fois, nos chefs s'émurent, notre capitaine-adjudant-major-flic vint lui-même escorté par tout le poste de police. Il essaya de parler avec modération mais dès les premiers mots des huées formidables l'arrêtèrent. [...] Je rédigeai un manifeste protestant contre le retard des permissions. Dans l'après-midi l'ordre de départ immédiat fut communiqué ; la promesse formelle était faite que les permissions allaient reprendre dès le lendemain. Les autorités militaires, si arrogantes, avaient dû capituler. Le lendemain soir, à sept heures, on nous rassembla pour le départ aux tranchées. De bruyantes manifestations se produisirent : cris, chants, hurlements, coups de sifflet. Bien entendu, L'Internationale retentit. Si les officiers avaient fait un geste, dit un mot contre ce chahut, je crois sincèrement qu'ils auraient été massacrés sans pitié. Ils prirent le parti le plus sage : attendre patiemment que le calme soit revenu. On ne peut pas toujours crier, siffler, hurler et, parmi les révoltés, n'ayant aucun meneur capable de prendre une décision, ou la direction, on finit par s'acheminer vers les tranchées, non cependant sans maugréer et ronchonner. Bientôt, à notre grande surprise, une colonne de cavalerie nous atteignit et marcha à notre hauteur. On nous accompagnait aux tranchées comme des forçats qu'on conduit aux travaux forcés. »
Un soir, un caporal chanta des paroles de révolte contre la triste vie de la tranchée, de plainte, d'adieu pour les êtres chers qu'on ne reverrait peut-être plus, de colère contre les auteurs responsables de cette guerre infâme, et les riches embusqués. Au refrain, des centaines de bouches reprenaient en choeur et à la fin des applaudissements frénétiques éclataient auxquels se mêlaient les cris de " Paix ou révolution ! A bas la guerre ! Permission ! Permission ! ". Un soir, patriotes, voilez-vous la face, l'Internationale retentit, éclata en tempête. Cette fois, nos chefs s'émurent, notre capitaine-adjudant-major-flic vint lui-même escorté par tout le poste de police. Il essaya de parler avec modération mais dès les premiers mots des huées formidables l'arrêtèrent. [...] Je rédigeai un manifeste protestant contre le retard des permissions. Dans l'après-midi l'ordre de départ immédiat fut communiqué ; la promesse formelle était faite que les permissions allaient reprendre dès le lendemain. Les autorités militaires, si arrogantes, avaient dû capituler. Le lendemain soir, à sept heures, on nous rassembla pour le départ aux tranchées. De bruyantes manifestations se produisirent : cris, chants, hurlements, coups de sifflet. Bien entendu, L'Internationale retentit. Si les officiers avaient fait un geste, dit un mot contre ce chahut, je crois sincèrement qu'ils auraient été massacrés sans pitié. Ils prirent le parti le plus sage : attendre patiemment que le calme soit revenu. On ne peut pas toujours crier, siffler, hurler et, parmi les révoltés, n'ayant aucun meneur capable de prendre une décision, ou la direction, on finit par s'acheminer vers les tranchées, non cependant sans maugréer et ronchonner. Bientôt, à notre grande surprise, une colonne de cavalerie nous atteignit et marcha à notre hauteur. On nous accompagnait aux tranchées comme des forçats qu'on conduit aux travaux forcés. »

Mutineries
des 20è et 21è BCP et du 20è R.I.
Mouvement de révolte sans
violence les 30 et 31 mai 1917, caractérisé par une réunion
nocturne d’environ 200 soldats débattant de l’indiscipline dans
la 5è division, réclamant des permissions et la fin de la guerre.
René Louis Brunet,
né le 2 juillet 1879 à La Ferté St Aubin, chaudronnier à
Orléans, célibataire, chasseur (caporal cassé par suite d’une
altercation avec un supérieur) à la 2è Cie de mitrailleuses du 20è
BCP
Condamné
(légèrement) pour insoumission à la loi sur le recrutement et
filouterie d’aliments.
Citation :
« Caporal de la classe 1899, remarquable par son entrain et son
mépris du danger. Grenadier volontaire, s’est toujours proposé
pour les missions les plus périlleuses. Le 26 septembre(1915), s’est
introduit seul dans une tranchée ennemie et a ramené devant lui 83
prisonniers valides dont plusieurs sous-officiers. Grièvement blessé
quelques minutes plus tard (aux deux jambes), n’a cessé de
maintenir le moral de ses hommes par ses paroles et son exemple. »
Brunet a été
arrêté par ruse le 1er juin à 17h grâce au lieutenant
Hellier qui l’a conduit vers le poste de police en discutant de
choses et d’autres.
Émile Paul Eugène
Buat, né le 5 mars 1887 à Arzillières, cultivateur, marié, sans
enfant, chasseur au 21è BCP
Condamné en 1912
pour coups et chasse.
Le dossier de Buat
contient des pages volantes pliées en quatre où se trouve -au verso
d’une chanson sentimentale- une version de La chanson de Craonne
notée au fort de Plesnoy le 8 octobre 1916 portant le titre A
Verdun au fort de Vaux. « Il
est joint à ce rapport (plainte en CG rédigée le 2 juin par le
sous-lieutenant Petitjean) une chanson trouvée sur lui, à la
fouille faite au moment de son arrestation. »
Personne, nous dit-on, n’a été condamné à mort pour avoir chanté la chanson de Craonne. Mais pour l’avoir notée et transportée sur soi ? Le cas d’Emile Buat -le simple fait qu’elle figure au dossier comme élément à charge- semble prouver, même si la chose est passée sous silence par les autorités lors du procès, que ce soldat qu’on a simplement vu causer avec d’autres « agités », ait été désigné comme un des meneurs de la rébellion, et non tout à fait pris au hasard parmi les 200 hommes qui se réunirent le 31 mai pour décider s’ils allaient se mettre en grève.
Notes d’audience
du CG de la 13è DI. le 5 juin 1917 :
Joly : Je n’ai
pas vu passer les mutins. Je suis allé à la réunion du 30 mai.
Nous avons été coupés par des officiers. Après le passage de
ceux-ci, un chasseur qui se trouvait dans un groupe m’a tendu un
papier que j’ai lu. Ce papier était signé du 129è et 36è R.I.
Il nous invitait à faire comme les rebelles. Le lendemain j’ai
assisté à une conférence faite par le chasseur Brunet.
Buat : « Je
n’ai pas assisté à la réunion du 30 dont j’ignorais
l’existence, mais à celle du 31. J’en avais été avisé par un
homme dont je ne saurais dire le nom, qui m’a dit il y a réunion
ce soir à 7 heures au champ de tir. J’ignorais le but de cette
réunion. Arrivé à la réunion, le chasseur Brunet que je ne
connaissais pas mais qui est ici et que je reconnais bien a fait un
petit discours. Il a commandé un papier nous invitant à faire cause
commune avec les mutions. A un certain moment, un chasseur qui était
là, un rouquin, m’a dit : « Et toi quel est ton
avis ? » Je lui ai répondu Je suis de l’avis de tout le
monde. Il m’a dit « Ce n’est pas une réponse » alors
j’ai dit « Du moment qu’on est d’avis de ne plus marcher,
j’estime qu’il ne faut se laisser embarquer ni en chemin de fer
ni en autos, et de rester ici. »… Je reconnais qu’une
nouvelle réunion avait été programmée pour le lendemain. On
devait y prendre de nouvelles décisions.
L’inculpé Joly,
interpellé dit : Je confirme mes déclarations, à savoir que
j’ai vu Buat causer de groupe en groupe. Je le reconnais
formellement.
Brunet : J’ai
assisté à ces deux réunions, je ne sais pas pourquoi. A la
première réunion, quand nous avons été dispersés par des
officiers, j’ai obéi. Je n’ai pas entendu la lecture du papier.
En allant à la réunion du 31, je n’avais pas de mauvaise
intention. J’avais surtout l’intention de me promener dans les
bois, et par curiosité. J’étais couché sur l’herbe, des
groupes se formaient, un papier a été lu. Je ne sais par qui.
Alors, je ne sais pas ce qui m’a pris. Je me suis levé, et j’ai
prononcé les paroles rapportées dans mon interrogatoire [Rapport du
Commandant Richier : « il finit par avouer par morceaux
qu’il avait déclaré que c’était aux officiers qui touchaient
beaucoup d’argent et dont c’était le métier à se faire casser
la gueule les premiers, quand leurs femmes et leurs parents en grêve
se faisaient massacrer par les Annamites, qu’il avait terminé
par ; Vive la liberté. Marchons tous main dans la main ».]
Je n’ai jamais été chargé de faire la conférence contrairement
à ce que dit Buat. Je n’ai rien dit quand il s’est agit
d’organiser la conférence du premier juin.
L’inculpé Buat,
confronté, déclare : C’est bien Brunet, qui, à la séance
du 31 mai a dit/ « puisqu’il n’y a pas assez d’hommes,
nous nous réunirons demain le soir à la même heure ».
L’inculpé Joly,
confronté déclare : « C’est bien en effet Brunet qui a
la séance du 31 mai nous a engagés à nous réunir le premier juin.
Sous-lieutenant
Roenley : Trois chasseurs avaient été envoyés à la réunion
du 31 pour découvrir les meneurs. Des déclarations de ces chasseurs
il résulte : qu’in parlait de grèves à l’intérieur, de
faire porter une lettre au 21 d’Infanterie et au 109è pour les
engager à faire cause commune… J’ai connu Brunet. Je sais qu’il
a eu une belle citation, qu’il a gagné ses galons de caporal pour
sa belle conduite, mais il s’enivre fréquemment. [rapport
Richier : « les gradés qui firent leur devoir de bons
français en espionnant les conversations pour trouver un meneur ne
doivent pas être cités comme témoins »]
Recours en révision
rejeté le 7 juin 1917, recours en grâce rejeté le 9 juin.
Le chasseur Maurice
Joly, (né le 15 décembre 1896 à Paris 8è, célibataire,
mécanicien ajusteur, jamais condamné) jugé solidairement pour
« provocation de militaires à passer aux rebelles armés »
obtient par grâce résidentielle la commutation de la peine de mort
peine en TF à perpétuité. Un ordre de parade est néanmoins émis,
avec défilé des troupes pour assister à la lecture du jugement et
à la dégradation le 23 juin 1917. Le 24 décembre 1920 il obtient
la remise du restant de sa peine. Le Commissaire du Gouvernement
avait pourtant émis un avis défavorable. Il rappelait ainsi les
faits : « Le 30 mai 1917, dans la matinée, des troupes
mutinées traversèrent en camions automobiles le cantonnement de
Dommiers (Aisne) où se trouvait le 20è BCP et lancèrent des
proclamations manuscrites provoquant les militaires à la rébellion.
Dans l’après-midi eut lieu une réunion des soldats du 20è BCP
auquel appartenait Joly. Ce dernier lut une de ces proclamations
lancées par les mutinés et qui disait entre autre chose
(sic) : »Les amis, nous tenons à vous faire savoir que
nous avons refusé de marcher, et que nous embarquons pour être
dirigés sur Paris. Il ne faut pas laisser tuer nos femmes et nos
enfants par les indigènes, ni nos pères qui font des obus pour nous
casser la figure. Fais comme nous c’est le moment de marcher tous
ensemble, car on nous a assez bourré le crâne depuis trois ans ».
Brunet et Buat sont
fusillés au lieu-dit chemin de la ferme de Plaisance à la route de
Château Thierry Soissons à Grisolles (Aisne) le 10 juin 1917, 5h du
matin.
René Brunet est inhumé à
Neuilly-Saint-Front et Émile Buat, enterré dans son village natal
de la Marne ; son nom figure sur le monument aux morts. Leur
exécution aurait été précipitée par une lettre insistante du général Philippe Pétain.
Emeutes de Beuvardes (2 juin 1917)
Le 12 juin 1917, Joseph Dauphin,
né le 10 février 1882, à Tauves, près de la Bourboule est fusillé
après l'échec au Chemin des Dames, car prétendument instigateur d'une
mutinerie. Il était cultivateur et cantonnier à Tauves, hameau de la
Chaleille, marié et père d'un enfant, né en octobre 1909 ; il mesurait
1,59 m. Il fut mobilisé le 4 août 1914, devint caporal en mars 1915, se
distingua lors des combats de juillet 1915 dans les Vosges, en étant
cité à l'ordre du Bataillon et en obtenant la Croix de guerre ; il
avait entre autres pour avoir ramené sur ses épaules un lieutenant
blessé près des barbelés ennemis ou pour avoir tenu une position jusqu'à
l'épuisement des ses cartouches. Il est décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze, pour "sa belle conduite au feu".
Il avait 35 ans en juin 1917. Joseph Dauphin est jugé le 6 juin 1917 pour rébellion à main armée en réunion de personnes et outrages envers ses supérieurs avec cinq autres soldats du 70e Bataillon de chasseurs alpins (ainsi Renauld A., 25 ans, mineur à Valenciennes, père d'un enfant et condamné à mort le même jour ; le 3e condamné à mort est Libert F., 38 ans, garçon livreur à Lille et père de trois enfants) ; deux soldats mobilisés, avocats de métier, ont défendu les accusés.
Il avait 35 ans en juin 1917. Joseph Dauphin est jugé le 6 juin 1917 pour rébellion à main armée en réunion de personnes et outrages envers ses supérieurs avec cinq autres soldats du 70e Bataillon de chasseurs alpins (ainsi Renauld A., 25 ans, mineur à Valenciennes, père d'un enfant et condamné à mort le même jour ; le 3e condamné à mort est Libert F., 38 ans, garçon livreur à Lille et père de trois enfants) ; deux soldats mobilisés, avocats de métier, ont défendu les accusés.
Fin mai, le 70e Bataillon (appartenant à la 47e Division d'Infanterie) stationne à Beuvardes, sur la rive droite de la Marne. Dans ce secteur de l'arrière-front, depuis plusieurs jours, des mutineries de soldats ont lieu, dans la 5e Division surtout ; les soldats de cette division sont déplacés en camion encore plus loin du front, par mesure de sécurité ; mais leur action va ainsi se propager par le bouche à oreilles.
C'est dans ce contexte qu'éclate le soir du 2 juin 1917, une révolte dans la 7e compagnie du 70e Bataillon, à laquelle appartient Joseph Dauphin ; elle est relatée par le Journal des marches (p. 15) : au moment de l'appel, une effervescence inhabituelle due à la boisson est remarquée ; dans un local, où se trouve une partie de cette compagnie, une "discussion très agitée ayant un sens révolutionnaire" se fait entendre ; le capitaine intervient mais dès sa sortie du local, cinq ou six hommes des plus agités s'arment de bâtons, cassent les vitres et hurlent "À bas la guerre ! À bas la guerre !". Les officiers s'éloignent alors que des bâtons et des pierres leur sont lancés ; les émeutiers vont dans la rue et crient "À bas la guerre ! Vive la Révolution ! Vive la Russie !".
Un coup de pistolet puis des coups de fusil sont tirés en l'air ; il est 22 h 30 ; alors les émeutiers se dirigent en nombre en direction du bureau du commandant et du local du poste de police militaire, au centre du village ; ce bâtiment est investi en tirant des coups de fusil sur la façade, puis les émeutiers essaient de convaincre d'autres compagnies de les suivre, sans succès ; à 2 h du matin, les émeutiers se dispersent et rentrent dans leur cantonnement. Au matin, on compte trois blessés dont deux par balle. Etant le seul gradé présent dans le groupes d'hommes arrêté après la beuverie le caporal Dauphin aurait chanté un peu fort "J'ai deux grands bœufs dans mon étable" mais l'accusation l'accuse d'avoir crié "vive la Révolution ! A bas Poincaré ".
Le 3 juin, le Général de division parla aux compagnies puis le Bataillon fut rapproché du front, mais 21 soldats furent arrêtés. Six prévenus seront jugés le 6 juin par le Conseil de guerre, sans instruction préalable ; sept autres le seront le 10 juin, pour les mêmes faits, dont Brugière François venant lui aussi de Tauves (classe 1906, recrutement de Clermont-Ferrand, matricule 1415).
François Bruguière
Il est pris, sans qu'on connaisse plus de détails le concernant dans les
émeutes de Beuvardes du 2 juin 1917. Ces dernières s'inscrivent dans le
cadre plus large des mutineries de 17 et s'apparentent à une séance de
beuverie au cours de laquelle des insultes seront lancées et des coups
de feu tirés une partie de la nuit.
Dégrisés, un peu plus vingt hommes seront traduits devant la justice militaire.
Trois sont condamnés à mort. Deux d'entre eux, le Caporal Joseph Dauphin de Tauves ( Puy-de-Dôme ) et le chasseur Arthur Renauld de Saint Amand ( Nord ) sont passés par les armes le 12 juin 1917 à la ferme de Faité entre les villages Roucy ( Marne ) et de Ventelay ( Aisne ). Le troisième, Libert, père de plusieurs enfants, voit sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité.
Une douzaine d'autres soldats sont condamnés à des peines de Travaux Publics pour "révolte à main armée en réunion de personnes".
Les peines vont de 5 ans de travaux forcés à perpétuité et la destination pour la plupart est l'Algérie.
François Bruguière lui est condamné à une peine de 10 ans de déportation.
La tradition familiale voudrait qu'il ait été condamné pour avoir refusé de participer au peloton d'exécution des deux condamnés à mort, le Caporal Dauphin étant un camarade, originaire comme lui de la commune de Tauves.
Dégrisés, un peu plus vingt hommes seront traduits devant la justice militaire.
Trois sont condamnés à mort. Deux d'entre eux, le Caporal Joseph Dauphin de Tauves ( Puy-de-Dôme ) et le chasseur Arthur Renauld de Saint Amand ( Nord ) sont passés par les armes le 12 juin 1917 à la ferme de Faité entre les villages Roucy ( Marne ) et de Ventelay ( Aisne ). Le troisième, Libert, père de plusieurs enfants, voit sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité.
Une douzaine d'autres soldats sont condamnés à des peines de Travaux Publics pour "révolte à main armée en réunion de personnes".
Les peines vont de 5 ans de travaux forcés à perpétuité et la destination pour la plupart est l'Algérie.
François Bruguière lui est condamné à une peine de 10 ans de déportation.
La tradition familiale voudrait qu'il ait été condamné pour avoir refusé de participer au peloton d'exécution des deux condamnés à mort, le Caporal Dauphin étant un camarade, originaire comme lui de la commune de Tauves.
Incarcéré à Marseille, Oran puis Alger.
Un télégramme avertit sa famille de son transfert à l'hôpital
militaire d'Orléanville (Chief) où il décédera (sans doute d'épuisement) le 17 février 1918.
La demande de révision des trois condamnés à mort fut rejetée le 9 juin. Le 12, à 3 h 30 du matin, Dauphin et Renauld sont fusillés dans le ravin de Beaugilet, à Ventalay ; le peloton d'exécution était composé de soldats venant du 70è Bataillon de Chasseurs mais aussi du 30è et du 115è. Le soldat Libert a obtenu une grâce présidentielle : sa peine de mort fut commuée en travaux forcés à perpétuité ; il sera libéré en juillet 1922. Le 14 juin, le 70è Bataillon monte aux tranchées sur le Chemin des Dames. La tombe de Dauphin se trouve dans la nécropole de Cormicy (Marne) ; son décès n'a pas été reconnu mort pour la France. Son nom figure sur le monument aux morts de sa commune, mais, malgré les différentes démarches entreprises dans les années 1920, puis après 1998, il n'a jamais été réhabilité.
Conséquence de la multiplication des mouvements de protestation et par la crainte de la contagion révolutionnaire, le 8 juin 1917, le gouvernement de la France décrète la suspension du droit de révision des condamnations militaires à la peine de mort, rendant les pleins pouvoirs aux conseils de guerre, et permettant à nouveau la perpétration immédiate des décisions d’exécution sans recours en grâce possible. Cette abdication du pouvoir politique aurait dû plonger les français dans la guerre civile, si la rupture de la triple entente par l'effondrement de l'empire russe n'avait permis l'entrée en guerre officielle des Etats-uniens en avril 1917.
12 juin 1917 : exécution des "meneurs" de la révolte Villers sur Fère
L’incident a lieu, dans la soirée du 27 mai, à Villers-sur-Fère, à une cinquantaine de kilomètres au sud des premières lignes. Il a pour origine l’annonce de la montée en ligne du 18e RI. Une centaine de soldats du 2e bataillon manifestent par des cris et des menaces avec arme leur refus de remonter au Chemin des Dames, d’où le régiment a été relevé le 8 mai, après avoir perdu plus de 1 000 hommes. Le régiment est cité à l'ordre de l’armée, puis mis au repos quelques jours. Le 27 mai au moment de repartir vers Craonne, plusieurs incidents graves se déroulent.
Après une nuit d’agitation, au petit matin du 28 mai, le calme est revenu. L’incident a été court, mais émaillé de coups de feu. Des menaces ont été proférées. La prévôté a dépêché sur place trente gendarmes. Et la population de Villers-sur-Fère a été témoin du défilé dans la rue d’un cortège de militaires entonnant L’Internationale et brandissant un drapeau rouge.
Le 7 juin, 14 hommes inculpés de révolte sous les armes passent en Conseil de Guerre. Cinq condamnations à mort sont prononcées:
Fidèle Cordonnier, né dans le Pas-de-Calais a obtenu une grâce de Poincaré, Président de la République. La peine de mort a été commuée en 20 ans de prison par décret du 11 juin.
Le 12 juin 1917, sont fusillés à Maizy dans l’Aisne :
Casimir Canel né le 1er mars 1896 à Avesnes-le-Comte dans le Pas-de-Calais,
Alphonse
Robert Didier, né le 7 avril 1884 à Vagney,
vosgien, employé de commerce,
Luis Alain
Didier, petit-fils d'Alphonse: « Alphonse étant père de trois
enfants aurait été épargné. Par esprit de solidarité il aurait
exigé de partager le sort de ses camarades et s’en serait expliqué
dans une lettre écrite à sa femme dans la nuit précédant son
exécution. Cette lettre bien évidemment n’a jamais été
retrouvée. La lecture des faits relatés dans les archives mises à
jour par les historiens n’enlève rien au courage de cet homme qui
n’hésita pas à descendre du camion embourbé qui le conduisait au
supplice afin d’aider ses bourreaux et ainsi en terminer plus vite
avec son inexorable destin. La "forte tête" comme l’a
décrit le général Hirschauer dans son rapport n’était point un
lâche et il l’a prouvé une fois de plus en refusant le bandeau
lors de son exécution ! »
Jean-Louis Lasplacettes né le 26 août 1887 à Aydius ,canton d'Accous (64)
Jean-Louis Lasplacettes présente de très bons états de service. Son
registre de matricule contient cette appréciation : « excellent soldat
depuis le début de la campagne, toujours volontaire pour des missions
périlleuses ». Le 19 avril 1917, un mois avant les incidents de
Villers-sur-Fère, il obtient une citation à l’ordre du régiment pour
avoir « le 16 avril, faisant partie d’une patrouille, fait dix-sept
soldats et un officier prisonniers ». Quand débute l’offensive du Chemin
des Dames, à la mi-avril 1917, il a à son actif trente mois de
campagne.
Avant-guerre, il exerce le métier de cultivateur à
Aydius. Son village natal, situé à 788 mètres d’altitude, aux confins de
la vallée d’Aspe, non loin de la frontière espagnole, compte alors près
de 500 habitants (une centaine aujourd’hui). Célibataire et sans
enfant, sa fiche militaire le mentionne comme soutien de famille,
vraisemblablement parce que son père étant malade, il subvient aux
besoins de ses parents dont il est le fils aîné. Lasplacettes possède un
niveau d’instruction 3, selon sa fiche militaire, il sait lire et
écrire.
Pour Moulia et pour les soldats Canel, Didier et Lasplacettes, la sanction tomba : le peloton d’exécution.
"Aujourd'hui, 5 juin 1916, Le Conseil de guerre de la 36è division... a déclaré le susnommé Moulia Germain (son surnom), caporal au 18è R.I. àl'unanimité coupable d'avoir participé comme instigateur à une révolte commise sous les armes en réunion de plus de quatre".
A l’aube du 12 juin, à Maizy, un quatrième homme, condamné à mort lui aussi, n’est pas dans le pré. Il s’agit du caporal Vincent Moulia, parvenu à s’évader la veille de l’exécution, favorisé dans son entreprise par le hasard d’un bombardement allemand sur le secteur de la ferme de Maizy, lieu de détention des condamnés.
Blessé par baïonnette dès 1914 à la bataille de Charleroi, à nouveau
blessé par balle le 24 mai 1916 à Verdun et promu caporal après avoir
refusé de se faire évacué, Mouria avait surpris et fait prisonnier huit
officiers allemands tapis dans une tranchée. Il avait encore sauvé
d’une mort certaine son capitaine blessé en le charriant sur son dos
hors du champ de bataille. A Craonne, il avait montré tant
d’ardeur au combat qu’il devait recevoir sa croix de guerre.
le 12 juin, Vincent Moulia ne pensait qu’à une chose : s’évader. A peine enfermé
dans ce silo à betteraves, il avait repéré une petite trappe au plafond.
La veille, il s’était porté volontaire pour nettoyer les restes de deux
soldats déchiquetés par un obus dans la cour de la ferme. Il en avait
profité pour inspecter les lieux. Le coup était jouable. Restait à se
débarrasser de la sentinelle enfermée avec eux.
– J’ai envie de pisser, lui dit-il.
Le soldat ouvrit la porte sur l’aube naissante et sortit dans la cour. Mais personne ne le suivit.
– Qu’est-ce que tu fous, Moulia ?
– J’arrive, le temps de mettre mes chaussures…
Mais Vincent Moulia avait déjà verrouillé la porte de l’intérieur, enfermant la sentinelle dehors. Il se saisit d’un long bâton, fit jouer la trappe du silo et se hissa à l’extérieur. Là, une deuxième sentinelle s’interposa. Moulia l’envoya à terre d’une ruade et se lança, pieds nus, dans une course éperdue. D’un bond prodigieux, il franchit la clôture de la ferme. Des coups de fusil claquèrent dans la nuit. Une balle siffla au-dessus de sa tête. Moulia détala sans se retourner et s’évanouit dans la forêt.
Le jour était à présent levé sur Maizy. Tapi au bord du canal latéral de l’Aisne, Moulia entendit trois salves retentir au loin. La quatrième aurait dû être pour lui. On verra plus loin, ce qu'il devint.
Henri Désiré Valembras,
né le 15 octobre 1887 à Avernes-Sous-Exmes (Orne)
cultivateur,
domicilié à Survie, arrondissement d’Argentan dans l’Orne,
célibataire, soldat au 313è R.I.,
déjà condamné au
civil pour coups et blessures et vols, et en septembre 1915 par le CG
de la 9à DI à 2 ans de prison pour abandon de poste sur territoire
en état de guerre.
Extraits
des Carnets de
guerre du sergent Granger 1915-1917 :
"28
(mai 1917 à Brouillet)… brusquement on nous apprend notre départ
pour demain matin… il faut se coucher de bonne heure car demain
matin réveil à 3 heures. Manifestations par quelques Poilus
agissant sous l’influence du pinard ; nuit mouvementée, tout
se calme avec un maigre résultat pour les auteurs de ce désordre ;
ils s’en repentiront à bref délai.
C’est
au 313è RI, où
pourtant les incidents semblent avoir été plus limités et qui a
été décoré 3 jours plus tôt après avoir durement combattu
pendant près de 3 ans, que survint la peine la plus lourde ;
une condamnation à mort exécutée (…) Le soldat Henri Valembras,
de la classe 8, cultivateur, célibataire, va servir d’exemple. Il
a frappé un capitaine à coups de pieds et de poings…"
Condamné
le 8 juin 1917 par le CG de la 9è DI pour révolte et voies de fait
envers un supérieur à l’occasion du service ( pas de dossier de
procédure, minutes et dossier de révision seul, qui n’apprend pas
grand chose.) Sont inculpés
lors
du même procès
Sylvain Emile Poitrenaud (17 juin 1894, Paris, garçon laitier) et
Léon Charles Victor Vanderrièle (3 mars 1897 Saint Pol sur mer,
débardeur), du même régiment.
Question
1 : Le soldat Valembras s’est-il rendu coupable de s’être,
le 28 mai 19617, à Brouillet et conjointement avec sept autres
militaires, livré à des violences et refusé de rentrer dans
l’ordre à la voix de ses supérieurs ?
2
– Le même est-il coupable d »avoir aux mêmes dates et
lieux, exercé des voies de fait envers son supérieur, le capitaine
Briol, en lui portant un coup de pied et un coup de poing. 3 – à
m’occasion du service.
4
– même question qui la première pour le soldat Vanderrièle. 5 –
Le même est-il coupable d’avoir aux mêmes dates et lieux refusé
à l’ordre relatif au service à lui donné par son supérieur le
capitaine Adrian… qui lui ordonnait de rentrer à son
cantonnement ?
Vanderrièle
est condamné à 10 ans de TP (3 voix
contre deux) Poitrenaud
à la même peine à l’unanimité.Recours
en révision rejeté le 10 juin 1917 (frais
de procédure 114,90 francs partagés entre les soldats Loutier,
Dupont, Charlon,
Lamotte, Simon (graciés
1918)-gracié en 1919-,
Rondelle, Pierre, Bié
-1 an,- et Lecomte -sursis, réhabilité en 1919 ). A
noter que les neuf
soldats jugés
indépendamment des « meneurs » appartenaient tous à des
régiments différents, ce qui laisse supposer l’étendue de la
manifestation. Il règne d’ailleurs le plus grand flou dans ce
dossier de révision, de nombreux autres cas y étant joints (Cremer,
Bouleau, Ceroil, Jacquel, Roynard, Brochi, Lacabanne, des 4è et 82è
R.I., du train etc;) les juges n’ayant pas trop l’air de savoir
s’il faut considérer certaines fuites de moins de six mois comme
des désertions ! Après la faillite du commandement, c’est la
justice militaire elle-même qui donne l’impression de se déliter.
En
cherchant bien, on finit par trouver, au milieu des avis d’écrou
et de remises de peine, un interminable rapport assez illisible, qui
n’est peut-être qu’un brouillon
:
« Le
28 mai dernier (1917), au moment de l’appel du soir, une vive
effervescence se manifestait parmi les troupes cantonnées dans les
baraquements
d’Arcis le Ponsart. Cette effervescence ne tardait pas à se
traduire par une manifestation, assez violente. Les hommes du 82è
R.I. et du 66è Chasseur y prirent part et il est certain que
d’autres éléments participèrent aussi à ces incidents puisque
un tringlot de la 8è Cie du train se trouve parmi les inculpés et
qu’il résulte d’un rapport de M. le commandant Caler que deux
artilleurs ont été vus parmi les manifestants. Quoiqu(il en soit,
certains soldats se groupèrent aux abords du camp et se mirent à
crier : « Permissions ! Permissions ! Nous
ne monterons pas sans avoir nos permissions !»
Comme toujours en
pareils cas, les premiers mutins furent d’abord entourés puis
renforcés d’un nombre toujours grandissant de curieux et au bout
d’un certain temps les manifestants formèrent des cortèges pour
sortir du camp et se rendre dans le village. A ce moment les
officiers, prévenus,
arrivèrent et leur intervention ramena au camp les militaires qui
cherchaient à en sortir, mais des cris plus séditieux furent
poussés comme par exemple ; « Nous ne remonterons pas aux
tranchées ! A bas la guerre, etc. » Contenus par les
officiers sur la route qui borde les baraquements du côté sud, les
mutins se rabattirent alors sur le camp, criant, chantant
l »Internationale, se livrant à [illisible],
de violences extrêmement regrettables tandis que certains d’entre
eux, pénétrant dans les baraques où les hommes demeurés calmes
étaient déjà couchés, les exhortaient à se joindre à eux et
employaient la force et la menace lorsque la persuasion ne suffisait
pas. C’est en vain que les officiers essayèrent
de ramener leurs hommes à de meilleurs sentiments, ils ne furent pas
obéis et quelques uns même furent malmenés
comme le Capitaine de Croÿ du 82è R.I. M. le Coloniel Bhier… les
harangua, leur donna l’ordre de se disperser, mais ne fu pas
écouté. Cet officier
supérieur fut même frappé avec une trique ou u bâton, mais comme
il faisait nuit noire et qu’il était
entouré à ce moment
là d’un groupe de révoltés, il ne put reconnaître l’auteur de
ce lâche [assault?]. Cependant au fur et à mesure que les heures
passaient, le nombre des mutins diminuait et vers minuit il ne
restait plus sur la route du camp qu’une dizaine d’exaltés dont
quelques uns étaient assurément ivres et qui finire,t à leur tour
par rentrer dans l’ordre. Le nombre des mutins n’a pas pu être
déterminé avec précision … les
inculpés... parlant de 2 à 300, un 3è au contraire d’une
cinquantaine.(…) Quoiqu’il en soit, il est certain que les 9
inculpés de cette affaire ne sont pas les seuls contre lesquels des
poursuites seront engagées et il est certain aussi que ce mouvement
n’a pas pris spontanément naissance à
Arcis le Ponsart au moment où il s’est produit. [ Ici c’est la
structure mentale de l’officier ne parvenant pas à dissimuler tout
à fait sa stupeur, qui est prise en défaut, aucune affirmation
n’étant étayée que par la rumeur, celle
de la concomitance d’autres mouvements fournissant l’indice d’un
soulèvement généralisé.
Or, si le mouvement avait été coordonné par de véritables
meneurs, ses conséquences se seraient sans doute étendues bien
au-delà d’une « révolte sans arme », et il ne restait
pas de commissaire-rapporteur pour en faire état.] Les prévenus ont
gardé quand nous les avons interrogés sur ce point un mutisme
presque absolu. Aucun d’eux ne veut avouer avoir reconnu parmi les
mutins la présence de tel ou tel de ses camarades. Ils ajoutent
qu’il n’y a pas eu de conciliabule au camp pour préparer la
chose et qu’ils n’ont été l’objet d’aucune incitation
étrangère. [Le
rédacteur évoque alors le témoignage d’un adjudant qui serait
tombé sur « un individu qui ne portait pas d’écusson et
devait être très probablement un agitateur étranger venu à Arcis
pour y fomenter la révolte ». Suivent
des arguties juridiques destinées à faire coller les événements
aux textes. Suivent
enfin les dénonciation des officiers ayant « reconnus
formellement chaque inculpé » sans
parvenir à leur prêter d’autres menées séditieuses que d’avoir
au pire chanté l’Internationale ou crié « en avant ! ».
Charlon et Simon
auraient été libéré de prison par les mutins. Bié et Rondelle
auraient échangé des
propos comme « C’est dommage qu’on ne m’ait pas suivi,
j’aurais foutu
le feu à la baraque des officiers
sans la moindre hésitation ! » et « je viens de
Monastir et de Salonique, c’est dégoûtant de vois les choses qui
se passent là-bas » ce qui permet de les considérer comme des
meneurs.]
Valembras
est fusillé le 13 juin 1917, « à la parade » à Roucy à
4h30.
Adolphe Elie Lozay, né le 9 mai
1892 à Orléans, 2è classe au 3è BMILA, décédé à l’hôpital
mixte d’Orléans le 14 juin, « tué d’une balle de revolver
au cours d’une arrestation » (Déserteur) ».
Pierre Gaston Lefèvre, né le
4 juin 1897 à Morfontaine (Meurthe et Moselle), caporal au 109è
R.I., 1ère Cie
A la veille de la guerre, il exerce le
métier de cantonnier, puis selon le PV d’exécution de presseur.
Le 7 août 1914, les Allemands prennent son père en otage et le
fusillent. Son frère infirme avait été emmené, puis fusillé à
son tour. Pour venger les siens, Pierre Lefèvre franchit les lignes
ennemies et vient s’engager à la mairie de Mézières
(Ardennes) le 14 août. N’ayant que 17 ans, il avait falsifié son
âge pour pouvoir s’engager. Blessé au printemps 1915, il est
alors soigné à l’hôpital de Lyon.
Le 9 juin 1917, à
la suite de la mutinerie de Mersin, il est condamné à la peine de
mort par le Conseil de guerre de la 13e Division, pour "révolte
par prise d’armes sans autorisation et agissements contre les
ordres des chefs".
Lefèvre à
l’audience : « Je reconnais avoir participé à la
réunion du 17è R.I. Je reconnais également que j’ai dit aux
hommes de participer tous à la manifestation. Je reconnais également
n’avoir pas obéi à l’adjudant Pons qui me disait de faire
rentrer mon escouade dans le devoir. Je reconnais avoir chargé mon
fusil dans le but de me défendre si l’on tirait sur moi. »
Recours en révision rejeté le 12 juin
1917, avec celui de Charles Léon Rouellé (1ère classe) et Chaillot
Léon (tous trois condamnés à mort). Par décret en date du 14 juin
1917, les peines de Rouellé et Chaillot sont substituées en 20 ans
de prison. Chaillot obtient une nouvelle remise de 4 ans de peine le
17 octobre 1921, tandis que Rouellé est gracié par décret du 21
septembre 1921.On a vu que c’était désormais l’habitude,
gracier deux des condamnées pour montrer la clémence du pouvoir
punitif qui désigne le plus coupable à fin d’exemple.
Chaillot à l’audience : « Je
ne suis pas un meneur ; je n’ai jamais rien fait pour cela ;
il n’y a d’ailleurs qu’un mois que je suis à la Cie. Je
reconnais que j’ai suivi les manifestants à la ré »union du
17è à Mersin, mais je n’ai rien entendu. Je n’ai pas entraîné
les hommes près des manifestants, mais seulement pour les conduire
au Capitaine ».
Témoin à charge Castéran, capitaine
du 109è R.I. : « … au sujet de Rouellé. Ce discours
avait l’air d’être appris et récité. En substance, il a dit/
Nous en avon assez, nous voulons manifester, nous voulons la paix,
nous en avons assez de la guerre. Il faut faire cesser les
hostilités. Le Gouvernement se moque de nous. Ça m’est égal
d’être Allemand ou Français. » J’estime que ce discours a
eu une grande influence sur les hommes qui sont partis.
Rouellé : « Je suis parti
comme les camarades à la manifestation de la nuit. Je n’ai pas
assisté aux réunions préalabales. Les sous-officiers nous avaient
rassemblés pour aller auprès du Capitaine. Les coups de sifflet
sont partis. Néanmoins je suis allé au rassemblement. Je reconnais
avoir pris la parole, et exposé nos revendications. A ma défense je
crois devoir dire que plusieurs hommes ne voulaient pas aller au
rassemblement ordonné par le capitaine, je les y ai emmenés. J’ai
dit au Capitaine « Nous ne voulons pas faire de bêtises ;
nous voulons simplement manifester notre opinion. » A ce
moment, on a crié « On en a assez entendu ». Les hommes
sont partis. J’ai été entraîné avec la foule. Je proteste
contre l’accusation d’antimilitarisme qu’on porte contre moi ».
Conjointement sont condamnés :
Boyer René Michel, caporal, condamné à 10 ans (remise de peine
d’un an en 1921), établissement mixte de Tunisie :
« J’ai fait comme tout le monde, j’ai suivi la foule. Après
que j’ai eu réfléchi, j’ai pensé à mes parents et je suis
revenu. Je suis rentré à 3h du matin, j’ai essayé de ramener
plusieurs camarades avec moi. J’ai été jusqu’à Mersin. J’ai
entendu un adjudant qui parlait de marcher sur Paris. Je suis revenu.
Si j’étais chaussé c’est que je venais de porter le prêt au
soldat Vergniol. »
Founier Adolphe, (109è, instigateur) , 10 ans remise de peine
rejetée en 1919, atelier TP n°16 de Coligny (Nièvre), remise de 5
ans en 1920.
« J’ai pris part à la manifestation, mais je n’ai
rienentendu, je suis un peu sourd. Je ne me souviens pas avoir dit
« Au 109è on est trop bêtes pour en faire autant ».
J’avais mon fusil, mes vivres de réserve, mais je n’étais pas
équipé. J’ai pris mon fusil parce que j’avais peur qu’on me
le prenne… Je n’ai pas crié « en avant ».
Thirion Charles Henri, instigateur,10 ans, Collioure, puis Nièvre,
remise de 5 ans (22 mars 1920)
« Le lieutenant nous avait rassemblé dans la matinée pour
nous faire une conférence sur les mutineries de certains régiments
et nous a engagé à faire notre devoir. Je reconnais avoir étét de
tente en tente, mais je n’ai réveillé personne. Je nie avoir dit
à l’adjudant Besse « Vous allez voir tout à l’heure »
Je n’ai pas vu le sergent Leblanc. Si je circulais de tentes en
tentes, c’est parce que j’avais entendu le 17è, et je voulais
voir ce qui se passait chez nous.
Rapport 1921 : « A la suite de révoltes survenues dans
des régiments stationnés dans la région de Soissons, une certaine
effervescence se manifesta à partir du 30 mai 1917, aux 1ère et 2è
Cie du 109è R.I. Le 1er juin 1917, vers 23 heures une
cinquantaine d’hommes de ces deux compagnies prirent leurs armes et
leurs équipements et allèrent rejoindre près du village de Mersin
les mutins du 17è R.I. qui voulaient marcher sur Paris. Mais une
dispute s’éleva entre les révoltés du 17è et ceux du 109è ;
ces derniers rejoignirent alors leur cantonnement et tout rentra dans
l’ordre. Thirion (2è Cie) fut l’un des instigateurs de cette
révolte. Il a reconnu avoir circulé vers 22h15 d’une tente à
l’autre et, interrogé par son adjudant sur ce qu’il faisait, il
lui a répondu « on va le voir tout à l’heure ». Il
s’était manifestement chargé de prévenir ses camarades. Il a
pris part à toute la manifestation. Thirion dès avant cette
manifestation était connu pour son mauvais esprit. »
Capelli Jean-Baptiste, 10 ans, détenu à Collioure, remise de peine
de 5 ans (22 août 1919)
« J’ai fait comme tous les camarades. J’ai crié « en
avant » comme tous les camarades. J’étais équipé parce que
les camarades étaient équipés, et qu’on devait aller faire une
manifestation ; on l’avait dit le soir, alors j’ai suivi le
mouvement, tout le monde y allait. J’ai pris mes vivres de réserve
parce que tous les camarades les prenaient. Je n’ai pas réfléchi. »
Charlut Jules, 10 ans, atelier de TP n°15 (Collioure), peine
suspendue le 9 juillet 1919. Croix de guerre.
« J’ai suivi les camarades lorsqu’ils sont allés à la
manifestation du 17è. Je suis sorti équipé et armé, parce que
tout les camarades en avaient fait autant. D’ailleurs cela avait
été dit dans la soirée. A la réunion il y a eu des discours, et
surtout des cris ; on criait « à bas la guerre ! »
Le 17è voulait nous emmener à Soissons. Je n’ai pas voulu y
aller, et je suis rentré à mon bivouac avec les camarades dans la
matinée. »
Champroux, Léon Eugène, 8 ans, peine suspendue le 15 mai 1919
atelier n°15 ; croix de guerre, citation, caporal cassé
« J’ai été entraîné dans le flot. <je n’ai pas
assisté aux réunions préparatoires. J’ai été à Mersin. J’ai
entendu un discours. Je proteste contre les accusations dont je suis
l’objet quand le capitaine affirme que j’ai crié « En
avant, cette fois nous ne nous laisserons pas faire.3 Il a dû faire
confsion. Je n’étais pas au rassemblement. Je suis plutôt
renfermé, je ne fréquente personne et je n’ai pas l’habitude de
conseiller personne. A la réunion, lorsque j’ai entendu un
adjudant du 17è dire qu’il fallait aller à Paris faire une
révolution, piller les gares, je me suis dit « ça n’ira pas
ça ». Je ne suis ni un voleur ni un sanguinaire ; alors
je suis rentré au bivouac ».
Moraine, Paul Louis Arthur, 5 ans, Collioure, puis atelier 54
(Trégastel), gracié en 1920
« J’ai pris part à la manifestation du 1er juin,
involontairement ; mais je n’ai assisté à aucune réunion.
Je n’ai pas entraîné mes camarades : j’avais un peu bu et
j’ai fait comme tout le monde. Si j’ai dit à mes camarades de ne
pas obéir à l’adjudant Pons, c’est involontairement, mais je
l’ai dit. Le caporal Lefèvre est venu par deux fois à notre tente
dans la nuit du 1er au 2 juin pour nous presser de nous
apprêter, et nous dire de ne pas manquer d’assister à la
manifestation. Nous avions touché le prêt le 1er juin
1917. »
Lefèvre
est fusillé au champ de tir
sus au sud-ouest de la station de Saint-Christophe, près de
Soissons le 16 juin 1917 à
4h30 Lefèvre est aujourd’hui inhumé au cimetière
militaire d’Ambleny.
Lettre testamentaire : seules la signature et la date sont de la main du fusillé (qui écrit d’ailleurs 1916 au lieu de 1917). La lettre, comme en témoignent le style, la composition et l’orthographe, a été rédigée par quelqu’un d’autre dans un but d’intimidation et d’appel au patriotisme. Sans doute une pure contrefaçon :
" Chers Camarades,
Dans quelques instants je vais être fusillé pour avoir pris part aux manifestations et aux actes d’indiscipline auxquels se sont livrés, il y a quelques jours, un trop grand nombre de nos camarades.
Au moment de mourir, je comprends la gravité d’une faute qui en affaiblissant le moral de l’armée, compromettait la victoire de la France.
Je demande pardon à la patrie de la faute commise.
Mais, en même temps, je demande à tous mes camarades de comprendre le sens de mon sacrifice.
C’est devant ma douleur de condamné à mort, devant le désespoir de ma famille si tendrement aimée, devant la France pour l’amour de laquelle j’aurais voulu mourir devant l’ennemi, que je les supplie tous de ne jamais plus se laisser entraîner à des actes d’indiscipline.
Victime de la faute commise, je leur demande d’avoir pitié de la France.
Je leur demande aussi de penser aux malheureux qui pourraient être un jour condamnés comme moi parce qu’ils se seraient laissés prendre une minute aux mensongères paroles de quelques mauvais Français.
Oh ! je vous en supplie, devant ma mort, souvenez-vous toujours, chers Camarades, que tous les soldats de France sont solidaires et qu’une faute commune peut entraîner la mort de quelques-uns.
Que mon sang, versé dans de si effroyables conditions, serve à vous unir tous dans une même volonté de discipline et contribue de cette manière à la Victoire de la France.
Adieu !
Vive la France !
Priez pour moi. De là-haut, je le ferai pour vous.
Lefèvre Pierre Gaston
Le 16 juin 1916
Albert Truton, né à Nocé (Orne), cultivateur à
Bellou sur Houisne, Albert Truton a épousé en 1912 Lucienne Cellier
dont il a un enfant, Suzanne, née en 1913. Caporal au 75è R.I.
Lors de la mobilisation générale, il
est incorporé au 103è R.I. Passé au 75è en juin 1915, il devient
caporal le 30 juin 1916. Le 6 août 1916, il est blessé par un éclat
d’obus et il est cité à l’ordre du régiment comme "bon
gradé courageux et débrouillard. Blessé à son poste de combat".
Croix de guerre, étoile de bronze.
Après la mutinerie de Pargnan, il est
condamné à mort par le Conseil de guerre de la 27è D.I. le 10 juin
1917 pour " refus d’obéissance, étant commandé pour marcher
contre l’ennemi". Poursuivis sous le même chef d’inculpation,
les caporaux Joseph Mathais et François Boyer sont condamnés à 20
ans de TF, les soldats Maurice Pommey, Fernand Leblanc, Clément
Duchène, à 10 ans avec interdiction de séjour, Edouard Blanc, et
Lucien Villain à 10 ans (et 5 d’interdiction de séjour), Robert
Martin, 3 ans de prison, Sylvain Boeuf et Gabriel Dedieu, à 2 ans,
le soldat Elie Saurel à 6 moi avec sursis. Tous
(sauf Mathais, insoumis,
et Truton ; coups et blessures le 27 mars 1912-sursis)
présentaient un casier judiciaire vierge.
Peut-on
d’ailleurs parler de mutinerie ? Les chefs répètent tous à
peu près la même chose. Citons au hasard le « compte rendu »
de l’adjudant Duffoy de la 3è section :
« Dans
l’après-midi, de 7 à 16 heures un
rassemblement de la Cie a eu lieu. Tous les hommes de l’unité
étaient présents. Après une causerie morale et des instructions
pour la relève l’ordre de rompre les rangs a été donné, aucun
signe de mutinerie n’a été constaté. (…)
A
21h30, j’allais pour rassembler la section, aucun homme n’était
équipé. Je leur dis de le faire, mais il m’a été répondu que
ceux de la compagnie voisine et des autres sections ne montaient pas,
qu’ils en faisaient autant. Leur demandant la raison qui les
faisait tous agir ainsi ils m’ont répondu qu’ils réclamaient
du repos et leurs permissions… Voyant qu’il n’y avait rien à
faire j’ai rendu compte au Commandant de la Cie. Apprenant quele
soldat Villemagne de ma section venait d’être frappé par ses
camarades je suis allé le chercher et je l’ai trouvé à terre la
figure ensanglantée : lui demandant ce qui s’était passé il
m’a dit avoir été frappé par ses camarades parce qu’il ne
partageait pas leur manière de faire, mais il ne m’a cité aucun
nom. Le Lt Colonel étant venu sur ces entrefaites m’a fait
conduire le soldat Villain au poste de police. A un nouvel essai de
rassembler la Cie fait par le Lt Bernère accompagné des 4 chefs de
section, aucun homme n’a répondu à l’appel de son nom à la
1ère section, seul le soldat Leblanc, non encore appelé, s’est
approché du Commandant de la Cie et lui a dit qu’il n’y avait
rien à faire tant qu’ils n’auraient pas eu du repos et leurs
permissions. A ma section, à part les soldats Loret , Serre,
pas de réponse à l’appel. Invités à s’équiper ces 2 soldats
m’ont répondu que leurs camarades les empêcheraient de sortir, en
effet un barrage avait été fait aux issues au moyen de caisses de
fer. En me retirant j’ai trouvé le Lt Chassard entouré d’un
groupe d’hommes parmi lesquels j’ai reconnu le caporal Truton,
les soldats Blanc et Pommey qui m’ont paru très exaltés, les
autres je ne les ai pas connus. A partir de minuit le calme fut un
peu rétabli et vers 2 heures au moment du départ pour les nouveaux
emplacements aucun homme de la section n’a manqué à l’appel.
Cette mutinerie a été favorisée par le cantonnement très vaste où
2 Cies y étaient (sic) cantonnées et par le manque d’éclairage
les bougies étant éteintes chaque fois que l’on a essayé de
faire un appel. »
Albert
Truton, Lettre
du 8 juin 1917 ;
« Ma cher femme cherie
Je
mempresse de te faire savoire le sort que je passerais demain car je
suis désignée a passer le conseil de guerre par ce que ont a pas
voulut monter aux tranchée hier soir nous sommes 10 qui vont passer
le conseil de guerre pour refue dobeissance je pense ètre aquitte
mes je suis cassee de caporal et de grande chance que nous allont
ètre changer de régiment ces bien malheureux car je navais rien
dit nous sommes 3 caporaux de la même compagnie ils ont prie les
gradée pour ètre responsable / enfin
cher petite femme ne te fait pas de mauvais sang pour cela car il y
en a assez dun qui sef asse du mauvais sang. ce nempeche pas de
avoire ma permission car ces un droit quand mon tour seras arrivee je
partirais comme les autres, mes si tu savait cher femme que je pleure
car mois quit a jamais etee punis jent nest gros sur le coeur. Quand
Chauveau seut airas en permission il te diras comment sa ses fait je
nes pas tors mes faut pas charcher a comprendre car celui qui est
fautive nes pas punis car il se tire toujour des pieds /cher femme surtout ne te fait pas de chagrin pour cela ce nes pas un crime, mes
se sont des affaires militaire. Je termine cher femme ma lettre en
desirent quelle se trouve en bonne santee et ma cher petite fille Son
mari qui aime pour la vie et qui ne cesse de penser en tois. Mils bon
baisers venent de fermer ma lettre, tant que pour me recrire de ce
moment attent que je te donne mon adresse »
Recours en révision et en grâce rejeté
le 15 juin 1917. Truton est fusillé le 18 juin à Pargnan à 4h. Le
détail de l’ordre se contente de se référer au règlement des
places sans détailler la présence des troupes ou de la musique.
Truton est aujourd’hui inhumé au cimetière militaire français de
Cerny-en-Laonnois.
Les nuits révolutionnaires de Ville-en-Tardenois (133è R.I, 41è DI)
Une
des caractéristiques majeures de la répression de ces événements
- parmi les plus importants, en nombre de participant des révoltes
de 1917 - est la perte des dossiers de procédures des Conseils de
Guerre chargés de les sanctionner, comme des passages des condamnés
en conseil de révision. L’étalement dans le temps des exécutions
des « meneurs » (voir Maréchal Hatron, et en juillet
Camille Biloir) sans doute partiellement choisis au hasard, montre la
volonté du commandement de veiller à ne pas allumer de nouveaux
incendies, peut-être parce que quelques hauts gradés étaient visés
par d’autres officiels impatients de s’en débarrasser.
Rapport
sommaire du général Mignot, commandant la 41e
Division d’Infanterie sur les incidents de la 82e brigade, pendant
la journée du 1er juin et la nuit du 1er au 2 juin :
« Le 1er juin, vers 13 heures,
dans le camp de Ville-en-Tardenois, des vociférations éclataient
subitement vers les baraquements du 23e régiment d’infanterie. Le
lieutenant-colonel Brindel et les officiers s’y portaient aussitôt
et cherchaient à calmer les manifestants, une centaine environ.
Bientôt le mouvement s’étendait au 133e, au camp nord, puis à
Chambrecy. Les manifestants réclamaient le repos qui, soi-disant,
leur était dû, se refusant absolument à remonter aux tranchées,
disant qu’on les avait assez bernés et qu’ils n’avaient plus aucune confiance en la parole des généraux. Cependant ils
assuraient que si le repos de 45 jours promis leur était donné, ils
ne se refuseraient plus ultérieurement à relever les
camarades.
Le mouvement gagnant peu à peu
d’intensité jusqu’à quinze heures sur place, à ce moment une
colonne de manifestants portant le drapeau rouge et chantant
l’Internationale tentait de gagner Ville-en-Tardenois. Le colonel
Baudrand et le général Bulot se portaient au devant d’eux,
enlevant leur drapeau rouge et s’efforçant d’arrêter la
colonne. Bientôt le général Bulot se mettait à leur tête et les
entraînait vers le camp nord, en traversant le village, en silence…
Il semblait que tout péril fût conjuré, et je me hâtai d’aller
en rendre compte à l’Armée. Mais vers 18 heures, après la soupe
le flot des manifestants se porta vers la mairie de
Ville-en-Tardenois, commençant à s’exciter fortement, à force de
cris, sous l’influence de la chaleur, mais sans que l’on
remarquât des gens particulièrement ivres. C’étaient des gens
butés sur une idée et sur qui aucune parole ne pouvait avoir
d’influence.(...) Surtout, de la guerre, ils en avaient « marre,
marre, marre », ils n’en voulaient plus, et réclamaient la
paix à tout prix.
Le général Bulot, qui avait eu un
certain succès vers 15 heures, paraissait cette fois
particulièrement visé. « Assassin, buveur de sang ! ».
Sa situation a paru même devenir tragique à un moment donné, et on
put craindre que le général, très pressé et bousculé, ne fût en
butte à un mauvais parti... je n’avais devant moi que des gens
butés, 7 ou 800 environ, avec un certain nombre de mines
patibulaires, formant les meneurs apparents, et qui, criant et tous à
la fois s’efforçant de m’empêcher de parler. Quand on
m’applaudissait, un certain nombre d’excités criaient non !
non ! à tue-tête, et finissaient par entraîner les autres.
(…) A cet instant, comme certains violents essayaient de me faire
le croc-en-jambe, je pus rentrer à l’intérieur de la mairie avec
le général Bulot.
Entraînés peu à peu par les
officiers, et la nuit s’avançant, les manifestants finirent par
rentrer chez eux. Toutefois, une bande d’une centaine d’avinés,
de repris de justice, qui s’étaient procuré de la boisson auprès
des habitants épouvantés, se tenait en permanence devant la mairie,
demandant la tête du général Bulot. Vers 10 heures, ils résolurent
d’aller à Romigny, où les attendaient, disaient-ils, les 120e et
128e. Le mouvement, éventé par téléphone, ne réussit pas. Un
meneur fut même pris par les barrages de la 4e D.I. et les
manifestants revinrent sur le camp, cassant les vitres à coups de
pierres et forçant les hommes endormis à quitter leurs baraques et
à coucher dans le camp.
La nuit, jusqu’à 3h 30 du matin, fut
une suite d’allées et venues au cours desquelles la mairie fut
mise en état de siège, les vitres et les portes brisées à coups
de pavés. Les fourgons renversés au milieu de la rue. Cette
situation fut tragique. Dès que les dernier ivrogne eut enfin
disparu, je renvoyai immédiatement le général Bulot chez lui à
Chambrecy, avec recommandation de ne plus se montrer. Dans la matinée
du 2 juin, selon mes prescriptions, on fit, sans grand entrain
d’ailleurs, des séances de jeux et d’exercices à l’extérieur
du camp, et il n’y eut aucune manifestation.
Mon impression, comme celle du général
Bulot et des deux colonels, est que le mouvement est nettement
révolutionnaire, sinon dans ses causes premières, du moins dans son
exécution.
Depuis longtemps, la 41e D.I. avait été
privée du repos normal, attribué à toute troupe venant des
attaques. Après la Somme, le général commandant en chef avait
promis un long repos, 40 pour cent de permissions ; au cours du
retour, la destination fut changée pour l’Argonne, et l’on entra
en secteur au bout de 5 – 6 jours seulement, sans même être
reconstitué. Ce manquement à une promesse affecta beaucoup l’esprit
des hommes. Dans la dernière offensive, la 41e D.I. fut plus
éprouvée que d’autres, et, bien qu’ayant obtenu une succès
apprécié, fut maintenue cinq semaines en secteur, alors que les
divisions voisines, étaient retirées plus vite du feu, et
jouissaient d’un plus long repos… Alors qu’ayant obtenu la
fourragère, ils se croyaient droit à 45 jours de repos, ils
devaient remonter, dans un secteur très difficile, au bout de 20
jours seulement. Ce n’était là qu’un prétexte, d’ailleurs.
Il y a des meneurs évidents répartis dans tous les régiments, même
des divisions voisines, qui ont monté l’affaire en véritable
émeute. Les plus excités étaient les récupérés âgés venus des
embuscades de l’Intérieur, et surtout les jeunes gens de la classe
17. J’en ai bu un qui était au 133e depuis 8 jours, n’avait
jamais vu le feu.
A un moment donné, dans la nuit, un
aspirant et un sergent du 23e ont vu, vers le camp sud, une auto
venant de Romigny, et contenant au moins deux civils, et peut-être
des militaires. Comme les manifestants, l’un des civils cria « vive
la grève ! A bas la guerre ! ». L’autre lui
dit : « tais-toi donc, nous pourrions faire repérer notre
numéro ». L’obscurité ne permit pas de le prendre, et
l’auto, après avoir fait demi-tour, à Ville-en-Tardenois, revint
sur Romigny.
Je le répète : le mouvement est
absolument révolutionnaire. La force ne peut rien, en ce moment,
pour la répression. On peut au contraire, aller au devant des pires
dangers. Tous les officiers éprouvent cette inquiétude. Des hommes
ont d’ailleurs déclaré que s’ils remontaient aux tranchées,
ils passeraient à l’ennemi ! Les plus grandes précautions
sont nécessaires pour ne pas laisser éclater l’étincelle, qui
peut gagner très rapidement. Il importe que les régiments soient
dispersés en des cantonnements éloignés, où il serait possible de
les reprendre, de découvrir les meneurs, et d’arrêter
subrepticement ceux qui sont déjà connus.
Le
bruit cours qu’après une réunion tenue cet après-midi au foyer
du soldat du camp par des meneurs étrangers […]120e, 128e et ceux
du 23e et 133e, on aurait résolu une nouvelle manifestation pour ce
soir. Des affiches manuscrites […] Vive la Paix au nom de
[…]l’Armée ont été apposés sur des baraques. Hier un soldat
étranger affublé de galons de commandant serait passé dans toutes
les baraques en félicitant et approuvant les manifestants. »
A
la date du 10 juin, une note secrète du Q.G. de la IVè armée
informe de l’arrestation des « meneurs principaux » :
au 23è, Neyret, Merle, Masset, Guyot, Lassalle, Jacquard. Au 133è :
Frayssé, Aubry, Jeannot, Ravaud, Durand, Lacombe, Couvreur, Janin,
Hartmann. Au dépôt divisionnaire de la 41è DI : Godinier,
Coudeau, Danjean, Gallet, Simonet, Gojon, Renoux, pauvet, Noaillac,
Bernard, Bruinet, Pardon, Garel.
Aimé Aubry, né le 3 décembre 1895 à Paris, comptable, célibataire 2è classe au 133è R.I. (déjjà condamné le 28 mars 1916 pour désertion, peine suspendue) : « A été vu en tête de la manifestation puis au premier rang de ceux qui se sont présentés à l’état-major de la division pour exposer les revendications de ses camarades ».
Georges
Raoul Fraïssé, né le 25 juin 1885 à Argeliers
(Aude), industriel à Paris. « donnait des ordres « Colonnes
par quatre en avant ! Ordres qui étaient exécutés sans
hésitation ».Réhabilité le 26 juillet 1961 ! en vertu
de la loi du 3 janvier 1925...
Antoine
Joseph Hartman(n), né le 17 février 1887 à Lyon, célibataire,
jamais condamné : « en tête de la manifestation portant
un drapeau rouge qui lui a été arraché par son colonel ».
Charles
Jeannot, 24 ans, célibataire, sans antécédent judiciaire : »deux
jours après, au Fresne, a tenté d’organiser une nouvelle
manifestation où cris d’excitation au meurtre et de provocation à
la désobéissance ont été poussés, sont condamnés à mort par le
CG de la 41è DI, (audience du 12 juin 1917) : « tentative
de refus d’obéissance en présence de l’ennemi et de provocation
à la désobéissance adressée à des militaires », mentionne
un dossier rédigé a posteriori, sans aucune pièce de procédure ni
minutes de jugement. Pour Fraïssé et Hartman existe une fiche de
décès portant la mention « fusillé ». « Recours
en grâce refusé par le général Pétain ». Ces trois soldats
et sans doute un 4è non mentionné du 82è R.I. ont été exécutés
(champ de tir de Chalons sur Marne) le 19 juin 1917 à 19h au lieu
dit Les Gilsons, commune de L’Epine.
A
partir de mai, on l’a vu, la demande facultative de grâce à la
disposition du commandement n’existe plus. Dès lors, l’envoi des
dossiers est automatique et donc les 59 exécutés de mai à décembre
sont tous d’initiative politique. En réalité, cette
responsabilité ne porte que sur l’exécution de 52 d’entre eux.
En effet, le général Pétain a été autorisé de mi-juin à
mi-juillet, à décider à son niveau d’exécutions sans en
demander la permission au pouvoir politique. Il a usé de cette
latitude 7 fois. Les dossiers d’Aubry, Hartman et Fraissé n’ont
donc pas été transmis à la présidence, même si Pétain a gracié
Jeannot. A en croire ses « Souvenirs », le principal
meneur de la révolte du 133è était docteur en droit et rédacteur
d’un journal des tranchées, mais comme il ne le désigne pas il se
peut que le gâtisme soit passé par là.
Pour
une fois, de hauts gradés feront aussi les frais des incidents. Les
généraux Mignot et Bulot, les colonels Brindel et Baudrant seront
déplacés, les uns pour insuffisance d’autorité, les autres pour
abus de pouvoir ayant envenimé les choses.
Une
fois la 41è DI évacuée, la 14è vient, le 6 juin,occuper les
campements de Ville-en-Tardenois qui vont connaître une nouvelle
poussée de fièvre révolutionnaire, à la fois moins spectaculaire
et plus violente sous l’impulsion des hommes du Dépôt
Divisionnaire qui auraient servi de « courroie de
transmission » pour répandre l’agitation aux 42è, 44è et
60è R.I. Ces événements sont très mal connus, les documents de
procédure à l’issue des faits s’étant volatilisés. On ne peut
les approcher qu’à travers les mémoires du Lieutenant Emile
Morin, qui vécut les événements de l’intérieur sans que son
témoignage fût jamais sollicité. Celui-ci raconte qu’entendant
des cris et des chants interdits, il voit du côté des baraquements
de la DD des hommes en armes agitant un grand drapeau rouge. L’ayant
aperçu ils se ruent sur lui aux cris de « A la baraque des
officiers ! ». Il s’y réfugie sous le sifflement des
balles, charge son revolver et sort par une porte latérale, roule en
bas du talus :
« Relevé
aussitôt, je bondis à l’entrée de la baraque occupée par ma
section et là je fais volte-face et, revolver au poing, me trouve
devant une troupe hurlante armée de fusils, baïonnette au canon !
Vingt fusils s’abaissent et vingt baïonnettes pointent contre moi
tandis que des cris contradictoires s’élèvent : « Arrache
tes galons !.. Mets-toi à notre tête ! Nous marcherons
sur Paris ; il faut que la guerre finisse ! Nous en avons
marre de nous faire massacrer pour rien ! A mort les députés !..
A mort les marchands de canons !.. A mort les embusqués !..
La paix !.. La paix !.. Le 42 venez avec nous… Nous avons
des fusils !»
Alors
s’élève une voix dans la foule des révoltés qui lui sauve la
vie en hurlant « Laissez-le tranquille… C’est un bon
copain ». Comme il recule à l’intérieur menaçant ses
propres hommes de leur tirer dessus s’ils bougent une oreille, et
que les pavés déchirent les planches et les vitres, les révoltés
incendient des paillasses qui commencent à embraser le baraquement,
provoquant la fuite des hommes de la section vers les champs
avoisinants où certains passeront la nuit. Les mutins changent alors
d’objectif et décident d’assiéger le poste de police.
« Les
officiers, entendant la fusillade avaient eu le temps, grâce à ma
résistance, de rejoindre le camp. Le commandant Jusselain avait fait
mettre une mitrailleuse en batterie et donné l’ordre à un
mitrailleur, puis au sous-lieutenant Merck de s’y asseoir, mais
tous deux avaient hésité. Alors il s’était assis lui-même à la
pièce et avait ouvert le feu, après avoir fait chaque fois les
sommations d’usage ». Bilan, (à ses dires) un mort et trois
blessés. « Le lendemain, j’apprends aussi que des mutins ont
poursuivi le lieutenant Fritschi et l’ont obligé, sous la menace,
à arracher ses galons, et enfin que quelques rares soldats du 42è
se sont laissés entraîner par les révoltés. » Cinq soldats
des 44è et 60è R.I. dont un caporal auraient été déférés
devant le conseil de guerre, mais il ne subsiste aucune trace de ce
qu’il advint d’eux.
La quadruple exécution de Chacrisse
Joseph Célestin Bonniot du 97ème RINé le 22 février 1884, à Clelles. Boulanger à Pellafol (38)
Brigadier le 28 novembre 1915. Caporal au 97ème RI le 12 juin 1916. “ Cassé de son grade et remis soldat de 2ème classe le 8 août 1916 pour avoir tenu des propos démoralisateurs à une personne étrangère à l’armée. ”
Le 3 juin 1917, le soldat Bonniot et environ 120 hommes du 97ème RI refusent de monter en ligne à Braye-en- Laonnois (Aisne). Le 13 juin, il est déféré avec 7 camarades devant le CG de la 77ème DI. 3 sont condamnés. Seul Bonniot se voit refuser la demande de présenter une grâce présidentielle. Son pourvoi en révision est rejeté le 17 juin.
Condamné à mort pour abandon de poste en présence de l'ennemi.
Fusillé le 20 juin 1917, à Chacrise (Aisne), à 8 heures du matin, avec les soldats Degouet, Vally et Flourac.
“Par décision ministérielle du 22 août 1921, a reçu l’application de l’article 18 de la Loi d’amnistie. Amnistié le 22 août 1921. ”
Louis Flourac
Soldat au 60è BCP, 8e compagnie, Louis Flourac a 24 ans en 1917. Agriculteur à Saint-Ybars près de Pamiers, il est un des 27 mutins exécutés au printemps 1917.
Le 4 juin 1917, sa compagnie reçoit l’ordre de monter aux tranchées. Le capitaine Daigney, commandant de compagnie et les chefs de section donnent immédiatement l’ordre à leurs hommes de se mettre en tenue. Au rassemblement, 19 chasseurs appartenant à la 3è et 4è sections refusent de monter à la tranchée. Les motifs mis en avant (le repos, les permissions) font de cette affaire un cas emblématique des mutineries de 1917 :
Le capitaine ajoute que "ce chasseur avait déjà pris une part active aux deux manifestations des 1er et 2 juin 1917. Sournois et hypocrite, il jouissait sur ses camarades d’un ascendant qu’il employait mal. Il passait à la Compagnie pour un peureux et sans se faire remarquer autrement aux tranchées il n’a jamais fait preuve de courage." Il est donc poursuivi pour "refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi.
Le choix des accusés – 6 sur 19 – fait l’objet d’une enquête après la guerre sur la demande de la veuve d’un des accusés, Charles Vally, le 30 juin 1925. Elle soutient que la désignation s’est faite au tirage au sort. Le capitaine Daigney – auteur du rapport sur Flourac – "déclare tout d’abord qu’il ne fut pas personnellement témoin des refus d’obéissance reproché le 4 juin 1917 aux 19 chasseurs des 3è et 4è sections de son unité, ce groupe se trouvant, ce jour là, sous les ordres du lieutenant Nybelen. Mais il affirme que les faits incriminés donnèrent lieu à une enquête sérieuse faite par ses soins. Il ajoute que "les accusés ne furent nullement désignés par le sort. [...] La désignation de ceux-ci fut faite en tenant compte de leur attitude, de la violence de leurs protestations, de l’influence qu’ils avaient paru exercer sur leurs camarades en tant que meneurs, en un mot de leur plus grande culpabilité."
Flourac comparaît le 10 juin à 17h aux côtés de cinq autres chasseurs de sa compagnie accusés du même crime. Tous nient d’avoir refusé d’obéir. Les chefs de section témoignent à charge. D’autres sous-officiers ou chasseurs sont plus évasifs : les uns n’ont rien vu, d’autres soutiennent que "personne n’a bougé"
Tous sont jugés coupables à l’unanimité des voix et sont condamnés à la dégradation et la peine de mort. Le 17 juin 1917, le recours en révision est rejeté. Pourtant, seuls Flourac et un de ses camarades, Charles Vally, sont exécutés le 20 juin 1917. Les quatre autres voient leur peine commuée en peine de travaux forcés à perpétuité. Riendans les notes d’audience, le jugement ou les dossiers de révision ne permet de comprendre la différence de traitement entre les condamnés.
Certains d’entre eux avaient des antécédents judiciaires à la différence de Flourac et plusieurs avaient été décrits dans les rapports de leurs officiers dans des termes au moins aussi durs. Un fonctionnaire du ministère de la Justice note à propos de cette affaire dans les années 1920 : "Laculpabilité de Vally n’est pas contestable. Sans doute, il paraît peu conforme à l’équité que, dans un cas de mutinerie collective, telle que celle à laquelle Vally a participé, quelques hommes seulement considérés comme les meneurs soient poursuivis et sévèrement condamnés (en l’espèce, à la peine de mort, et exécutés) mais juridiquement le fait que tous les coupables n’ont pas été punis ne peut servir de base à une instance en révision."
La rapidité du jugement – moins d’une semaine après les faits –, les zones d’ombre dans le choix des accusés – six sur les dix-neuf mutins – et la différence de traitement entre les accusés témoignent d’une justice militaire qui renoue avec des pratiques en vigueur durant les premiers mois de la guerre.
Louis Flourac fait partie des 27 fusillés sur plus de 500 mutins condamnés à mort.
"L’an 1917, le 20 juin à 5 heures, nous Guyot Amédée, sergent commis greffier près le conseil de guerre de la 77è division d’infanterie [...], nous nous sommes transportés à Chacrise pour assister à l’exécution de la peine de mort avec dégradation militaire prononcée le 12 juin 1917 par ledit conseil de guerre en réparation du crime de refus d’obéissance en présence de l’ennemi contre le nommé Vally Charles du 60è bataillon de chasseurs à pied, né le 8 février 1892 à Raon-l’Etape (Vosges). [...] Arrivé sur le lieu de l’exécution, nous greffier soussigné, nous avons donné lecture au condamné en présence de M. le commandant Ducimetière, juge audit conseil de guerre [...]Arnould Paul, 60è BCP, 20 juin 1917, après l’exécution de Chacrisse :
"L’émotion était tellement forte chez moi que je n’ai pu manger de la journée. Ce n’était pas leur mort [...] puisque j’en vois tous les jours aux tranchées, mais c’était la chose d’avoir tiré dessus, tiré sur les pauvres copains que je connaissais depuis 2 ans."
Jean Marie Victor
Cadot, né le 6 avril 1889 à Saint-Loup-de-Varennes (Saône et
Loire), manœuvre à Châlons-sur-Saône, célibataire, chasseur au
4è BMILA
1er CG de
l’Amalat d’Oujda (audience du 20 mars 1917) : Procédure
suivie contre les chasseurs Cador, Jules Romary (TF à perpétuité,
commués le 24 juin 1922 en « un jour de prison ») et
Jean Dureisseix (10 ans de TP) sous l’inculpation d’outrages par
paroles, gestes et menaces envers un supérieur pendant le service,
et, en outre pour les deux premiers « tentative de voies de
fait envers un supérieur pendant le service ».
« Le 1er
octobre 1916, vers 7h30, deux voitures mobilisées dont l’une
chargée de munitions, faisant partie du convoi régulier de
Colomb-Béchar(sud-oranais) à Bou Denib (Maroc), étaient arrêtées,
enlisées entre colomb Béchar et El Mosra (Algérie), au passage dit
« de la dune ». Le capitaine de Charnacé, du 5è spahis,
commandant le convoi, plaçiat à la garde de ces deux charrettes, le
caporal Sautereau, du 4è BMILA et son escouade de 12 hommes ainsi
que deux spahis, agents de liaison. Ils devaient attendre les animaux
de renfort que le capitaine allait leur expédier et protéger et
escorter les charrettes jusqu’à El Mosra, où le convoi devait
camper. Le caporal Sautereau prenait les dispositions suivantes :
sept chasseurs étaient détachés en avant et sur les flancs, un
chasseur derrière et lui-même à la garde immédiate des voitures,
avec les chasseurs Ulmann, Cadot, Romary et Dureisseix. Les renforts
envoyés par le commandant de convoi arrivaient vers 16 heures 30.
Une demi-heure après les deux charrettes et leur escorte avaient
repris leur marche, après une discussion provoquée par Cadot,
Romary et Dureisseix, au sujet de la nourriture, et au cours de
laquelle ces trois chasseurs avaient outragé le caporal Sautereau de
ces mots : « Grosse vache, sale tante, enculé ;
c’est toi qui manges tout. Tu as mangé avec le sergent trois cent
francs de l’ordinaire ». Vers 17h30 ces mêmes chasseurs
s’obstinaient à ne pas prendre dans l’escorte la place que le
caporal leur avait assignée, celui-ci les invitait à s’y placer.
Les trois chasseurs Cadot, Romary et Dureisseix l’accueillent de
ces mots : « Qu’est-ce que tu viens nous faire chier,
grande vache, emmanché, enculé ! On a assez vu ta sale
figure » Cadot ajoute : « Et puis tiens ! Je
vais te descendre ». Mais chacun d’eux revendique le
privilège de faire feu sur le caporal Sautereau. Et Dureisseix,
prenant le bras de Cadot, lui dit : « Non ! c’est
moi qui vais le descendre ». A son tour Romary intervient :
« Laissez cela ! Dit-il, c’est mon affaire ! »
Cadot s’est dégagé. Il charge son arme et fait feu sur le caporal
qui n’est qu’à environ deux mètres de lui [« Vous n’avez
pas de couilles pour tirer, c’est moi qui vais le faire »
selon l’un des muletiers]. La balle l’effleure presque, mais il
ne touche pas. Le chasseur Ulmann avait vu le geste de son camarade
et d’un revers de main avait pu faire dévier l’arme à temps.
Dureisseix se retirait, Romary également, mais à cinq mètres, ce
dernier qui venait de charger son fusil mettait à son tour le
caporal en joue. De nouveau Ulmann intervenait et prenant Romary à
bras le corps, mettait fin au drame. Le caporal Sautereau montait
alors sur une voiture et se plaçait sous la protection des muletiers
et du maréchal-ferrant qui chargeaient leurs mousquetons. Un quart
d’heure après, Cadot, comprenant enfin la gravité de l’acte
qu’il venait de commettre s’approchait de son supérieur :
« Caporal, lui dit-il, vous ne m’avez jamais rien fait et je
ne vous en en veux pas. J’ai fait cela dans un moment de colère et
j’espère que vous laisserez ça là. » Le caporal n’ayant
pas paru accepter cette solution, Cadot lui criait ; « Si
on ne t’a pas eu ici, on t’aura autre part, grosse vache ! »
A 19h30, voitures et escorte au camps d’El Mosra. » Admettons
que ce rapport romanesque -qui reprend mot à mot les déclarations
de sautereau-, soit en quelques points (le dernier paraissant des
plus douteux) le reflet de la vérité.
« Cadot
fut condamné 4 fois pour vols et une 5è fois pour contravention aux
règlements de régie. Romary, 15 fois pour coups et blessures,
outrages publics à la pudeur, menaces de mort, bris de clôture, vol
et rébellion, et deux fois par des conseils de guerre, pour
destruction d’un fusil et abandon de poste, Dureisseix, une fois
pour vol civil et une fois pour vol militaire. »
Interrogatoire
Cadot : « Nous n’avions pas mangé depuis la veille,
c’est depuis 24 heures. Nous avons su, en arrivant à la charrette,
où il se trouvait, que des spahis avaient apporté du pain, de l’eau
et du chocolat pour tous. Nous avons réclamé notre droit ; non
seulement le caporal ne l’a pas fait, mais il nous a outragés et
nous avons répondu… Il était ivre au moment où nous réclamions
à manger. D’ailleurs il est connu comme mauvais sujet et brutal.
Il a frappé trois hommes, pendant que nous étions en prévention de
conseil de guerre ».
Romary :
« Comme il gardait encore pour lui un bon quart de pain et deux
barres de chocolat, nous lui fîmes observer qu’il ne pouvait pas
avoir plus de droit que nous. Le caporal nous insulta alors nous
traitant de pierrots, de piliers de prison, ajoutant qu’il avait
assez de nous. En ce qui me concerne je lui ai répondu en le
traitant d’emanché (sic) qu’il sortait de centrale comme moi et
qu’il ne valait pas plus que moi… le caporal Sautereau que
j’avais connu comme 2è classe au 8è groupe spécial au Kreider
est un violent, brutal, qui a même frappé trois hommes du 7è
bataillon d’Afrique du 12 au 17 décembre 1916 à Belibila, les
chasseurs Bernier, Gerardin et Idou. »
Recours en révision
(Cadot), rejeté le 26 mars 1917, recours en grâce rejeté le 18
juin 1917. Caqdot est fusillé au Terrain d’aviation, Oujda (Maroc)
le 20 juin 1917, à une heure inconnue.
Gustave dit Maréchal Gaston Hatron,
né le 17 février 1898 à Saint-Ouen dans la Somme, soldat au 23e
R.I., célibataire, sans antécédent judiciaire, 19 ans (mineur)
Engagé volontaire pour la durée de la
guerre le 08 janvier 1915 à la mairie de Belley, évacué blessé de
Curlu (80) le 14 septembre 1916, rentré le 28 octobre 1916, condamné
par le Conseil de Guerre de la 41e Division dans sa séance du 18
juin 1917 à la peine de mort avec dégradation militaire pour "
tentative de refus d'obéissance en présence de l'ennemi et
provocation à la désobéissance".
Partisan actif des manifestations
pacifistes et révolutionnaire des 1er et 2 juin 1917 à
Ville-en-Tardenois, Maréchal Gaston Hatron a « manifestant de
la première heure, le premier déployé le drapeau rouge en tête
des manifestants du 23è R.I., en présence de son colonel, et a
refusé de lâcher cet emblème révolutionnaire,malgré les
injonctions de son chef de corps. On dut lui arracher des mains. »
(Rolland) Il fait partie des 95 mutins déférés devant le conseil
de guerre de la 41e D.I. le 18 juin 1917, seul condamné, recours en
grâce présidentielle transmise mais refusée. Aucune trace de
procédure officielle, seule demeure sa fiche de décès.
Hatron est fusillé à 19 h à L'Épine
(51) le 27 juin 1917 au lieu dit Les Gilsons, champ de tir de
Chalons. Evidemment non réhabilité, même son acte de naissance
reste introuvable.
Les 4 de Rarécourt
Adolphe Le François, né le 17
janvier 1878 à Londres (Angleterre). Marié,sans enfant, il
travaille comme journalier à Marseille.
Engagé volontaire à Tunis le 1er juin
1899, il sert successivement au 1er régiment étranger, 4è, 15è,
8è, 23è R.I. (en Algérie, au Sahara, à Magadascar). Soldat à la
1ère compagnie du 1er bataillon du 129è R.I., il prend part aux
plus importantes batailles de 1914 et 1915 (Charleroi, Guise, La
Marne, l'Artois). En 1916, il se trouve dans le secteur meurtrier des
Eparges et participe à la bataille de Douaumont, dans laquelle le
129è paye le plus lourd tribut en hommes. Il participe activement
aux manifestations pacifistes qui éclatent au sein des 129è et 36è
R.I., les 28-30 mai 1917, au hameau de Léchelle (Aisne). Adolphe Le
François s'y révèle comme l'un des principaux meneurs. Alors que
les soldats du 1er bataillon tentent de propager le mouvement aux
autre bataillons du 159è, 36è, 74è et 274è R.I., un quart du 2è
bataillon du 129è qui cantonne à Poisy se joint à la manifestation
qui prend la direction de Missy-aux-bois ou cantonne le 3è. Devant
la menace d'une extension du mouvement de protestation déjà fort
avancé, le commandement prend la décision le 30 au matin d'éloigner
les mutins du 129è en les faisant embarquer en camion pour Roye dans
la Somme, ce qui met un terme à l'insurrection. 22 soldats du 159è
sont finalement déférés le 20 juin 1917 devant le CG du QG de la
2è armée, jugement pour lequel est ordonné le huis-clos, en raison
de la dangerosité pour l’ordre public, à Heippes (Meuse) :
Dehais, Lagnel, Dieudegard (caporal), Marie (caporal), Héron
(caporal), Grand, Gilbert, Leroy (caporal), Houdeville, Gand, Guérin,
Delaire, Cavernes, Cabeit, Grouy (clairon), Bisson, Thouant, Mielly.
Tous écroués à l’atelier de TP de Bougie, donc déportés en
Afrique du Nord (peines de 5 à vingt ans de TF ou TP)
Extraits du long rapport (lui-même
citant des extraits du rapport d’origine) produit en 1935 pour le
tribunal de Rouen - n’oublions pas que c’est l’ennemi qui
raconte- :
Le 27 mai 1917, jour de la Pentecôte,
le 159è R.I. occupait dans l’Oise les cantonnements de Saint-Ouen,
Busserol, Chavez, Montapin etc. dans les environs de la
Ferté-sous-Jaurre… Les camions automobiles enlevèrent cette unité
dans les cantonnements de Chazelles, pour le 1er
bataillon, de Pleizy pour le 2è… de Missy-au-Bois pour le 3è…
Il ne semble pas douteux, d’après le rapport du Colonel Boucher…
que la soudaineté du départ le jour de la Pentecôte mécontenta
tout le monde ; que des femmes et des enfants avaient fait le
voyage de Paris dans l’espoir de passer les deux jours de fêtes
avec leur mari ou leur père… Cette cause à elle seule n’est pas
suffisante… il faut rechercher les causes de ces manifestations
tout d’abord dans le mauvais état d’esprit résultant de l’échec
de l’offensive du 16 avril, à laquelle le régiment qui se croyait
appellé à prendre part comme troupe de poursuite a subi une
profonde déception, car, prenant ses désirs pour des réalités, il
avait estimé que cette offensive donnerait des résultats décisifs
pour la fin de la campagne [cette littote étant destinée à masquer
l’incompétence du commandement] . Enfin les buits les plus
divers avaient couru… Les permissionnaires avaient notamment
rapporté que des grèves importantes avaient éclaté dans certaines
grandes villes et à Paris [ce qui n’était pas un bruit mais une
réalité], où des femmes avaient été tuées par des soldats
annamites qui, d’après les ordres du gouvernement, avaient fait
usage contre elles de mitrailleuses. A ces causes extérieures qui
semblent être manifestement le résultat d’une campagne voulue et
concerté non seulement au 129è, mais dans d’autre régiments
étrangers à la 2è armée, il convient d’ajouter d’autres
causes de démoralisation tenant à la durée de la guerre, à la
lassitude qui en a été le résultat… Il était fatal qu’au
cours de semblables manifestations organisées, des paroles des plus
blâmables fussent prononcées ; les projets les plus criminels
envisagés. Sans pouvoir rapporter mla preuve absolue que ces
manifestations aient pour but la marche sur Paris, on est obligé de
reconnaître que cette éventualité a été envisagé (sic)… Il
n’a pas été possible de préciser si les mnifestations ont été
spontanées ou...provoquées par des circonstances extérieures, par
des conseils, des provocations venues de l’étranger ou de
personnes n’appartenant pas à l’armée. Il est même assez
difficile de se prononcer sur le point de savoir si les
manifestations ont pris naissance au 159è, ou aux compagnies
divisionnaires du génie (3/3, 3/4, 3/16) qui étaient cantonnées à
Léchelle, comme distante environ d’1 km de Chazelles et dans
laquelle les hommes du 1er bataillon du 129è étaient
allés dans l’après-midi du 28 mai chercher du vin, car le seul
débit de leur cantonnement était fermé. D’après certains
indices, il semblerait qu’une manifestation grave aurait eu lieu
dans cette commune. On a parlé du drapeau rouge qui aurait été
sorti, de l’internationale qui aurait été chantée… Il semble
qu’un homme qui appartenait au génie aurait pris la tête d’un
cortège avec un képi recouvert de l’étoffe rouge des signaleurs.
Quoiqu’il en soit, à la suite de ce meeting de soldats, un cortège
de manifestants se forma. Les hommes, 150 à 180 environ, appartenant
au 1er bataillon, se dirigèrent en colonne vers 19h30 au
cantonnement de Chazelles… Quelques instants après une colonne
d’environ cent hommes débouchait sur la route. Le Commandant les
arrêta, leur demanda à quoi rimait cette manifestation. Les
réponses partirent du milieu du groupe. « Nous ne voulons plus
aller aux tranchées ; nos femmes meurent de faim. Des Annamites
tirent sur elles pendant que nous nous faisons casser la gueule. La
révolution russe a fait rater l’offensive du 16 avril. Le
Gouvernement aurait dû répondre aux offres de paix des Allemands ».
Le Commandant leur donna l’ordre formel de se disperser… Les
hommes se dispersèrent par petits groupes et rentrèrent au
cantonnement… Toutefois ce calme était plus apprent que réel, et
le bruit se répandit parmi les officiers que les hommes devaient le
lendemain, partir de leur cantonnements vers huit heures, afin de
s’entendre avec les militaires des autres bataillons pour organiser
une manifestation collective. (…)
Le 29 mai vers 8 heures du matin, malgré
les mesures de surveillance prises par le commandement, une partie
des hommes du 1er bataillon parvint à échapper à
l’action de ses officiers, tout en gardant d’ailleurs vis-à-vis
d’eux une attitude correcte et déférente. De petits groupes se
formèrent et bientôt un cortège de 250 hommes se dirigea vers
Ploizy, dans le but d’entraîner le 2è bataillon. Ces hommes
pénétrèrent dans les cantonnements, engagèrent les hommes du 2è
bataillon à faire cause commune avec eux et à se joindre au
cortège.(…) A Ploizy… les hommes en immanse majorité avaient
refusé de suivre et avaient déclaté qu’on verrait après la
soupe ; la plupart des hommes du 1er Bataillon
avaient alors quitté Ploizy pour se diriger vers Missy-aux-Bois où
était cantonné le 3è Btn. Après la soupe, c’est à dire vers
10h1/2 ou 11h, un clairon du 2è Btn sonna le rassemblement à
Ploizy. A cette sonnerie les manifestants se réuniurent et
« glissant dans les mains de leurs chefs » ,
quittèrent leur cantonnement en colonne et rejoignirent à
Missy-aux-Bois les manifestants du 1er Btn. Vers midi, les
trois bataillons du régiment, à l’exception d’un certain nombre
de soldats ayant conservé la compréhension de leur devoir, étaient
réunis et redescendaient à Chazelles, formant un groupe d’environ
un millier de manifestants. Les hommes des 2è et 3è Btn restèrent
dans les bois environnants le cantonnement, tandis que les hommes du
1er Btn mangeaient la soupe. (…) Vers 14h, un homme
ayant réussi par ruse à s’emparer du clairon du poste de police,
fit entendre la sonnerie du rassemblement, à la suite de laquelle
les hommes se réunirent sur la route dans la direction de
Bercy-le-Sec, dans le but d’aller débaucher le 36è régiment ;
le rassemblement eut lieu dans le plus grand ordre, par Cie et par
Btn. La colonne comprenait environ 860 hommes, sans compter quelques
traînards ou timides qui marchaient à une certaine distance. Un
certain nombre de discours furent prononcés,Les uns prêchaient le
calme, semblant indiquer de la part des manifestants une organisation
voulue et combinée ; d’autres discours au contraire, avaient
nettement pour but de prêcher le désordre. La colonne des
manifestants fut rencontrée dans l’après-midi par le général
Lebrun, commandant le C.A. qui s’efforça de ramener le calme dans
les esprits, supplia les hommes de ne pas se livrer à des
manifestations stériles. Le général, d’après les dépositions
de certains témoins, aurait été particulièrement ému en voyant
ses efforts restés sans succès… Enfin les hommes des 1er
et 2è Btns, dont un certain nombre portait de fleurs rouges et était
muni de badines fraîchement écorcées, se présentèrent au
cantonnement du 36è R.I. Il est évident que celui-ci était averti
de ce qui devait se passer et que la fusion entre les deux régiments
eut lieu sans la moindre difficulté. De nombreux discours furent
prononcés et parmi les orateurs, plusieurs excitèrent les hommes à
se réunirent (sic) le lendemain pour marcher en armes sur Paris afin
de prêter assistances aux grêvistes, se présenter devant le
parlement et lui faire connaître les revendications des mutins. Il
fut convenu que le lendemain tout le 36è et le 129è se réunirait à
nouveau et irait débaucher le 74è. Mais l’autorité militaire,
tenue au courant de ce qui s’était passé rendit impossible
l’exécution des projets formés par les mutins en faisant
embarquer le 30, pour une destination inconnue, tout le 129è R.I.
Quelques difficultés, quelques actes d’indiscipline, d’ailleurs
isolés, se produisirent au moment de l’embarquement. Toutefois,
grâce à l’énergie des officiers, le régiment tout entier
embarqua dans les camions. En cours de route, certains hommes
rencontrant d’autres troupes au cantonnement firent le geste des
« mains retournées ». Enfin, le régiment fut embarqué
par chemin de fer, en gare de Roye, le 31 mai , à 7h. Quelques actes
d’indiscipline semblent encore avoir eu lieu. Mais on peut dire
qu’à partir de ce moment, tout véritable mouvement était étouffé
à ce régiment.
Charges résultant des faits établis à
l’encontre des quatre condamnés à la peine capitale :
Caporal Lebouc : … sergent cassé
pour « absence de son poste comme chef de poste » a pris
part à la manifestation de l’après-midi du 29 mai. Il prétend
avoir suivi la colonne tout à fait à l’arrière ; mais de la
déposition du sergent Laymer, il résulte qu’il eut un rôle tout
autre et plus actif. Le sergent affirme en effet l’avoir entendu
dire : « C’est moi qui avait le groupe de la 6è Cie »
voulant indiquer par là que dans la colonne, il était à la tête
des hommes de sa Cie… Le 30 mai au matin, lors de l’embarquement,
il est allé dans les divers cantonnements pour engager les hommes à
refuser à s’embarquer. Il a été vu alors par les
sous-lieutenants Renard et Gaulier. Ce dernier l’a entendu dire :
« On n’embarque pas ; la 6è est restée couchée ».
Chemin : Le soldat Chemin et les
soldats Gand et Guérin se sont particulièrement compromis et ont
été les chefs du mouvement de leur compagnie, la 5è. Le capitaine
Lemaître, commandant la Cie, déclare en effet, les avoir vus montés
sur un talus et appelant leurs camarades, leur faisant des gestes
d’appel et les incitant à les suivre. Ils étaient à la tête
d’un groupe que le capitaine lemaître tenta d’arrêter, et ils
furent les premiers à violer ses ordres… Chemin est un mauvais
soldat. Il a 23 ans, est cordonnier de son état et son casier
judiciaire témoigne de sa mauvaise conduite. Confié à l’assistance
publique à la suite d’acte de mendicité, il a été envoyé en
correction jusqu’à sa majorité pour s’être rendu coupable de
vol domestique. Enfin, il a été condamné le 13 juin 1916 par le CG
de la 5è DI à 10 ans de TP pour abandon de poste et désertion en
face de l’ennemi.
Mille : Il est
bachelier-ès-sciences, a préparé l’examen de capitaine au long
cours et a voyagé. A Paris il était caissier aux Galeries
Lafayettes. C’est un homme intelligent, mais d’un moral
déplorable, de tendances nettement anarchistes. Il ne conteste pas
la par qu’il a prise à cette manifestation qu’il semble
pleinement approuver… Il dit hautement qu’il est las de la
guerre, n’a aucune confiance en la justice de son pays, et désire
évidemment sincèrement « que les ferments de misère soient
actifs pour notre intérêt commun »… Il ne manifeste aucun
repentir de sa faute mais s’en glorifie.
Le François : Ce soldat de la 1ère
Cie est condiféré par son capitaine comme particulièrement
suspect ; s’est signalé au cours des manifestations notamment
aux réunions avec le 36è R.I. A pris la parole (deux fois), parlant
avec grande violence. Il résulte des déclarations des témoins…
qu’après être allé» à Léchelle le 28, il avait pris la parole
et déclaré qu’il fallait dès le lendemain débaucher les autres
bataillons et « faire du patin ». C’est également lui
qui, au cours de la jounée du 29, alors que le 129è et le 36è
avaient fusionné, prenait de nouveau la parole pour dire qu’on
était victime du Gouvernement, qu’on faisait tirer sur la foule
par des Annamites… qu’il fallait marcher suir Paris et que le 36è
les accompagne. Cet inculpé est certainement un des meneurs les plus
dangereux des manifestations qui se sont produites. »
Marcel Arsène
Chemin, né le 3 septembre 1894 à Collonges-au-Mont-d’Or,
célibataire, cordonnier à Lisieux
Marcel Jules
Gilbert Lebouc, né le2 janvier 1893 à Nantes, marié, un
enfant, couvreur à Rouen
Henri
Mille, né le 29 août 1884 à Darnétal (Seint Inérieure),
célibataire, caissier-comptable à Paris 10è, et Le François sont
condamnés à mort pour "abandon de poste et refus d'obéissance
devant l'ennemi". Il sont fusillés le 28 juin 1917 à 4h40 à
la sortie nord de Rarécourt (Meuse) et enterrés hâtivement dans le
cimetière communal. Recours en révision rejeté le 15 juin. Un
réexamen de leur cas est demandé par le ministère de la guerre le
9 juillet 1935, alors que le délai pour la révision expire le 14
juillet de la même année.
Edouard Emile Louis est né à Maintenon le 20 février 1889. Emile est recensé en 1901 et 1906 au hameau de Saun ; sa famille compte 6 enfants. Il aurait été en réalité élevé par sa grand-mère jusqu’à l’âge de 14 ans, puis "livré à lui-même". A l’âge de 20 ans il exerce la profession de garçon de restaurant.
Il est incorporé au 13e régiment de cuirassiers. Manquant à l’appel le 14 juin 1911, il est déclaré déserteur. Il se présente au poste de police du 2e régiment de cuirassiers à Paris au mois de juillet. Il est alors condamné à 1 an de prison avec sursis, pour désertion en temps de paix. Il rejoint le 13e régiment de cuirassiers. Il est à nouveau condamné à 1 an de prison avec sursis, cette fois pour complicité de vol militaire. Il obtient une remise de peine de 6 mois. En mars 1913 il incorpore le 5e, le 1er puis le 4e bataillon d’Afrique en campagne au Maroc. Le certificat de bonne conduite lui est refusé. Il passe dans la réserve en mai 1914 et est maintenu sous les drapeaux jusqu’au mois de juin.
A la mobilisation, alors qu’il réside à Mamers dans la Sarthe, il est rappelé et affecté à la 3e compagnie du Groupe Spécial. Il est blessé par balle à Roclincourt (Pas-de-Calais) et soigné à Angers. Il passe au 115e régiment d’infanterie le 10 avril 1915 et est promu caporal le 23. Au mois de mai il passe au 8e régiment d’infanterie. Au mois de juin, dans l’Aisne, le 8e régiment reprend aux Allemands des tranchées de première ligne, dans le secteur du Bois de la Mine et du Bois Franco-Allemand. La bonne conduite d’Emile Louis lui vaut une citation à l’ordre de la brigade (12 juin). Décoré de la Croix de guerre, il est promu sergent. Au mois de septembre suivant le 8e régiment est cantonné à Guyancourt (Yvelines). Emile Louis demande un laissez-passer ; il souhaite préparer un mariage par procuration. Le laissez-passer lui est accordé. Le 9 octobre, à Ville-d’Avray, il épouse Marie Taulet, couturière de 16 ans. Il est mentionné sur l’acte de mariage qu’Emile Louis est sergent au 115e régiment d’infanterie, décoré de la Croix de guerre et de la médaille coloniale. Il est domicilié chez ses beaux-parents. Le procureur de la République de Versailles a accordé une dispense de publication et de délai.
Emile Louis ne regagne pas son régiment mais il se rend à Mamers et se présente volontairement au dépôt du 115e régiment. Poursuivi pour désertion et abandon de poste, il est condamné à 60 jours de prison ; une ordonnance de non-lieu lui permet de rejoindre le 8e régiment le 8 décembre. Il est cassé du grade de sergent et, soldat de 2e classe, il est affecté à la 10e compagnie.
Le 8e régiment tient toujours ses positions au Bois-des-Buttes, au Bois Franco-allemand et au Bois de la Mine. La compagnie dont fait partie Emile Louis se trouve en soutien au bois de La Sapinière, à 500 mètres de la première ligne qui est elle-même, dans le secteur du Bois de la Mine, à quelques mètres des Allemands. Emile Louis, considérant que le secteur est "calme", abandonne son poste. Plusieurs raisons l’auraient poussé à cet abandon. Il évoque la contrariété de ne pas avoir changé de régiment après sa cassation. Il aurait reçu des menaces de la part de ses camarades : "ils m’ont dit que puisque j’étais soldat de 2e classe comme eux, ils me feraient la peau". Il affirme lors d’un interrogatoire avoir rejoint son ancien sergent-major qu’il lui devait une somme d’argent, reliquat de sa solde de sous-officier.
Il est arrêté le 20 janvier 1916 à Ville-d’Avray et est retenu à Versailles, au dépôt du 41e colonial, d’où il réussit à s’enfuir, pour retrouver son épouse "qui (le) menaça de demander le divorce". En fait il quitte les Yvelines pour la Loire-Atlantique. A Nantes il est employé officiellement comme courtier. En fait il vend des bicyclettes volées. Il serait "le chef d’une bande voleurs, ou du moins un membre de cette bande". Arrêté pour ce motif et pour vol d’argent au préjudice de son beau-frère à Ville-d’Avray, il est transféré à la prison de Poitiers. Il est condamné à un an de prison. A Poitiers, il organise avec deux complices une évasion. Lors de leur fuite l’un de deux complices tue un gendarme ; les deux hommes réussissent à s’enfuir tandis qu’Emile Louis est rattrapé. Il est transféré à Versailles où, le 24 août, il est condamné par le tribunal à 6 mois de prison pour vol. Le 17 septembre 1916, il adresse une lettre au procureur de la République de Versailles : "je suis déserteur. Je désirerais passer au Conseil de guerre pour retourner au front rachetez ma faute par une bonne conduite. J’ai déserté à la suite d’une cassation de mon grade".
Cette fois il est transféré dans la Somme, afin d’être présenté devant le conseil de guerre. Il est soigné à l’hôpital militaire de Châlons-sur-Marne pour gale. Bien qu’ayant été signalé comme individu dangereux, il n’est pas surveillé. Entré le 13 octobre, …il s’enfuit le 30. Arrêté à Epernay, il est ramené à Châlons le 4 novembre… et s’enfuit à nouveau. Un mandat d’arrêt est lancé contre lui. C’est finalement à Paris qu’il est arrêté, porteur d’un livret militaire au nom du soldat Lequeux, aumônier à Nantes. Le livret, tout comme la permission qu’il présente, a été volé et falsifié. Emile Louis est également accusé de vol de bicyclette. Il est détenu à la Santé à partir du 8 décembre 1916. Lors d’un interrogatoire en date du 19 mai 1917, il "demande à être renvoyé au front si c’est possible pour racheter (s)a faute". Jugé par le conseil de guerre de la 2e division d’infanterie à Ramerupt dans l’Aube le 24 mai suivant, il est condamné, à l’unanimité, à la peine de mort. Les chefs d’accusation retenus contre lui sont abandon de poste en présence de l’ennemi, vol d’un livret individuel, falsification et usage d’une permission. Il aurait également été recherché par le conseil de guerre du Mans comme témoin dans une affaire d’espionnage concernant un sous-officier d’origine allemande.
Emile Louis se pourvoit en révision. Le pourvoi est rejeté le 2 juin. Il demande un recours en grâce, rejeté par le président de la République le 27 juin. Il est exécuté le 28 juin, à Saint-Brice en Seine-et-Marne.
espion fusillé à Reims (1917?)
Maria Liebendall (épouse Gimeno de Sanchis), née le 27 mai 1887 à Düsseldorf.
Civils
Marguerite
Francillard est la
première espionne fusillé à Vincennes, le 10 janvier 1917. Aucun
élément officiel de procès n’existant dans les bases de données,
on la connaît généralement par la photo spectaculaire de sa mort.
Modeste couturière à Grenoble, devient la maîtresse d’un espion
allemand basé à Genève. Elle se déplaçait à Genève pour faire
passer les messages que lui remettaient les espions allemands en
France. Sentant qu’elle était suivie par des agents français,
elle disparut mais elle fut vite repérée à Paris. Elle continuait
à porter les messages à Genève. Elle fut arrêtée ainsi que ses
fournisseurs allemands.
Après la messe dans la chapelle de la prison, l'abbé Geispitz lui fit promettre de prononcer devant le peloton d'excution les paroles suivantes : "Je demande pardon à Dieu et à la France. Vive la France!" Mais elle ne put que bafouiller quelques bribes de la phrase, à voix basse.
Maria Liebendall (épouse Gimeno de Sanchis), née le 27 mai 1887 à Düsseldorf.
Active à Nice et à
Marseille, maria Liebendall est accusée d’avoir fourni aux
autorités allemandes des renseignements militaires, et notamment
dans le courant de l’année 1915 d’avoir tenté de procurer des
renseignements concernant l’appel et l’entrée en campagne des
jeunes gens de 18 ans, le départ des troupes pour le front et le
corps expéditionnaire d’Orient, l’emplacement de forts et de
poudrières aux environs de Nice, en les remettant à la dame Lebrun
qu’elle croyait être un agent chargé de les communiquer au
service de l’espionnage. (Voir affaire Pfaadt)
CG de la Xvè région. Exécutée à Marseille Champ de tir du Pharo le 16 janvier 1917
CG de la Xvè région. Exécutée à Marseille Champ de tir du Pharo le 16 janvier 1917
Jeannette
Antoinette Dufay, née le 25 novembre 1870 à Paris 11è,
trois enfants, femme de chambre à Francfort sur le Mein (Allemagne)
avant la guerre
De père français et de mère allemande, elle fut femme de chambre dans plusieurs hôtels en France dont l'hôtel Meurisse, en 1915, elle travaille au Grand Hôtel de Mannheim. Espionne active, elle se faisait embaucher, en France, dans des usines d’armement et fréquentait les techniciens et ingénieurs de l’usine. Elle transmettait ses rapports en Suisse. La douane de Pontarlier l’a arrêtée et une perquisition, faite à son domicile, s'est révélée fructueuse
De père français et de mère allemande, elle fut femme de chambre dans plusieurs hôtels en France dont l'hôtel Meurisse, en 1915, elle travaille au Grand Hôtel de Mannheim. Espionne active, elle se faisait embaucher, en France, dans des usines d’armement et fréquentait les techniciens et ingénieurs de l’usine. Elle transmettait ses rapports en Suisse. La douane de Pontarlier l’a arrêtée et une perquisition, faite à son domicile, s'est révélée fructueuse
Reconnue coupable CG
du gouvernement militaire de Paris (recours en révision rejeté le 9
janvier, en cassation rejeté le 1er février) d’avoir
fourni des informations à l’Allemagne en janvier et février 1916
et d’avoir tenté de fournir des informations en juin 1916, son
action étant alors déjouée. Ne demeurent que les minutes de ce
procès tenu à huis-clos, qui portent mention de l’exécution à
Vincennes le 5 mars
à 6h28.
Stephan Tassé,
né en 1891 à Egri (Serbie), cultivateur, marié, 2 enfants
Le 18 décembre 1916
vers 15 heures, le cadavre du canonnier Blanc du 105è RAL, parti à
la chasse la veille, est trouvé par des cavaliers dans la plaine au
nord du village D’Egri-Dolno : selon le Dr Farnanier « La
mort est survenue au petit jour du 17 décembre 1916. Elle est due à
un très violent coup de fusil servant de massue appliqué par
derrière… Nous avons la certitude que cet homme a été assassiné
par plusieurs individus… du fait de la constitution robuste de ce
canonnier et du fait qu’une balle a été tirée. » L’enquête
piétine un certain temps jusqu’à ce qu’elle soir confiée à
l’inspecteur Paoli du service de la Sûreté à Monastir :« Nous
nous rendîmes à Egri pour enquêter. Le pope et le maire Athanos
Dimitri nous ont déclaré qu’ils ignoraient le crime. Ces deux
individus connus de longue date comme très dangereux se refusèrent
à fournir toute explication... » Mais ils sont renseignés par
un certain Bagine Ristoff qui s’étant échappé nuitamment du
village vient leur déclaré que le jour du crime les chiens de
Stepahne (Stepho) Tassé ont aboyé violemment, provoquant les
questions de deux femmes du village au maire qui aurait répondu
d’abord « dequoi te mêles-tu ? » puis « le
Français a trouvé ce qu’il cherchait ». Pressé de
questions le monktar Athanos Dimitri « finit par déclarer que
Stephan Tassé avait assassiné le soldat français avec un autre,
puis se renferma dans le mutisme le plus absolu. Nous le menaçons du
revolver afin d’avoir le nom de l’autre criminel ; il tomba
alors en syncope et mourut quelques instant après. Le médecin du QG
conclut à une mort due à une affection cardiaque. Il est à retenir
que le monktar a désigné Tassé comme le criminel. Stephan tassé
est un fanatique bulgare acharné et un criminel habituel ; il a
tué sous le gouvernement turc Kristo Tneïtehe et son frère, la
fille de Hogna et ne cessait de répéter dans le village que les
bulgares ne tarderont pas à retourner. »
CG de la 57è DI,
recours en révision rejeté le 20 mars (14 jours après son
exécution, mais c’est devenu la coutume en Orient pour les
autochtones, seuls les soldats français bénéficiant d’un sursis
à l’exécution). Tassé est fusillé à Monastir (Serbie) le 6
mars à 8h.
Vincent
Ciro Moni, né le 28 septembre 1874 à Bagni di Lucca
(Italie), fabricant de saucissons à Paris.
De
cette affaire extrêmement compliquée, impliquant des relations
entre la Belgique (pays d’origine de Mme Moni et sa mère),
l’Italie, la hollande, la suisse, voire l’Espagne et l’Allemagne,
reste l’impression que Moni était un grand comédien. Ses
déclarations -interminables- devant le3è CG de Paris, paraissent
relever d’une improvisation brillante, entretenant le suspense à
coups de « et je dirai mieux », inventant des
personnages, faisant intervenir des morts, des espions de toute
nationalité au signalement extravagant. Ne se paye-t-il pas le luxe
de suggérer qu’il soit remis au contre-espionnage italien ?
afin de confondre les réseaux ennemis avec lesquels il paraît avoir
communiqué autant par chiffre que par écriture sympathique. Une
lettre de juin ou juillet 1916 qui lui est attribuée, recense les
mouvements des régiments français, dans le Nord, en Alsace, en
Belgique, en partance pour les Dardanelles, annonce une offensive
conjointe de l’Angleterre et de la France en Champagne pour les 8
ou 9 août 1916, fait était de chevaux reçus d’Argentine et
d’Amérique, de la fabrication de canons lourds pour lesquels les
munitions manquent encore, des pertes de l’aviation etc. Moni
prétend que la plus grande partie de ces informations sont de son
invention, comme les filets anti-sous-marins déployés en Sicile,
que le peu d’argent que les allemands lui auraient envoyé ne
compenseront jamais les pertes de ses commerces, lui qui représentait
en Belgique les machines à écrire Monarch, fabriquait à grande
échelle de la charcuterie revendue à l’armée belge par des
banquiers multi-millionnaires qu’il dénonce avec la plus grande
précision… A cela se joint au dossier une foule de lettres de sa
femme, en détention au camp de Fleury, bombardant les commissaires
de demandes afin de récupérer ses malles conservées par une
concierge du Bd des Batignolles qui vend ses effets et réclame des
loyers indus, un tel imbroglio qu’il faudrait s’y pencher des
mois durant pour en démêler les ficelles. Non compté les dernières
lettres de Moni à sa femme et sa belle-mère, confinant à la
bigoterie, et dans lesquels les appels à s’en remettre à Dieu
cachent sans doute encore des messages qui ont égaré les autorités.
Recours en grâce rejeté le 16 mars 1917. C’est probablement par
lassitude d’être conduits sur des pistes inexploitables que les
autorités se sont décidées à exécuter Moni, remettant sa famille
en liberté (pour expulsion après passage après des « camps
de triage »), le condamnant pour espionnage et tentatives
d’espionnage, donc sans être réellement fixés sur la nature de
ses actions. Moni est exécuté à Vincennes le 19 mars à 5h59.
Nicolaï Dose,
né en 1872 à Vivitsa (Macédoine) marié, trois enfants, pêcheur
et batelier, illettré
Dose a été dénoncé
au service de la sûreté de l’Armée Française d’Orient par le
pope et le mouktar de Vivica qui l’accusent d’avoir fourni des
renseignements à l’armée bulgare sur les effectifs français et
d’avoir prêté assistance aux comitadjis bulgares qu’il forçait,
par la violence et les menaces, les habitants de la région à
ravitailler et à qui il offrait l’hospitalité la plus large dans
sa propre maison. Après une enquête assez sommaire (reposant
uniquement sur les deux témoignages du pope et du maire), le CG de
la 156è DI le condamne à mort le 10 avril 1917.Recours en révision
rejeté le 19 avril 1917. Dose est fusillé à Bukovo (Serbie) le 21
avril 1917.
Carafil
Djelladine, né en 1881 à Seltcha, marié, 3 enfants, illettré,
condamné 2 fois pour vol :
« Djelladine
a une très mauvaise réputation. Il passe pour vivre de vols et de
rapine. Les habitants de la région l’accusent d’être l’auteur
de nombreux assassinats. Djelladine Carafil a été accusé d’avoir
à Kucaca, entretenu des intelligence avec l’ennemi en découvrant
à l’ennemi un agent du service français des renseignements
[Alexis Papajiorackim, épicier à Koritza, réussit à s’enfuir
durant son transfèrement à Seltea, ayant surpris une conversation
où il était question de l’assassiner ; après avoir roulé
dans le ravin avec un de ses gardes, il traversa à la nage le fleuve
Dévoli et fut recueilli de l’autre côté par la gendarmerie
mobile] . Dans le courant de février 1917, commis une tentative
d’embauchage en faisant provoquer le Capitaine Ferid Fasheri de la
gendarmerie albanaise, à passer à l’ennemi. »
CG du
commandement militaire de Koritza ; fusillé à Koritza
(Albanie) le 6 mai 1917, 5h.
Ali Cherafedine,
né en 1891 à Florina (Grèce), sans profession
CG de la 156è DI :
intelligence avec l’ennemi en Serbie, enrôlements militaires au
profit de la Bulgarie(coupable à quatre voix contre une), tels sont
les motifs consignés dans les minutes du jugement. Le condamné
étant décédé avant la transmission du dossier au conseil de
révision, l’action publique est éteinte.
Cherafedine a été
fusillé à Bukovo (Serbie) le 31 mai 1917 à 4h.
A travers ces procès
expéditifs on voit l’influence du général Maurice-Paul-Emmanuel
Sarrail, devenu commandant en chef des armées alliées d’Orient le
16 janvier 1916. Sarrail saisit cette occasion pour exercer une sorte
de tyrannie durant laquelle il déposera le roi Constantin en juin
1917. « Le nombre des Macédoniens, des Grecs, des Juifs, des
Turcs et des Albanais qu'il a fait fusiller sans jugement, pour des
peccadilles est considérable. Par ses soins diligents, les camps de
concentration de Zeitenlick et de Mithylene regorgeaient de gens. On
y mettait des vieillards, des enfants et on les y oubliait. Sarrail
paraissait éprouver une sorte de jouissance à y envoyer des
notables (députés, maires, anciens ministres etc.), des religieux
(popes, muftis, rabbins). » (source Prisme
1418 ) Le 21 avril, en réponse à la circulaire Painlevé qui
oblige à soumettre toute condamnation à mort à l’approbation du
pouvoir politique, il émet un télégramme recommandant l’exécution
immédiate de tous les condamnés si ce ne sont pas des militaires
français :
Donner ordres
pour que dorénavant les condamnations à mort pour turcs, bulgares,
grecs, etc. soient immédiatement suivies d’exécution. Seuls les
soldats français doivent, avant d’être fusillés, avoir leur cas
soumis au Conseil de Révision et appel au Président de la
République.
Quoiqu’il
soit limogé en décembre 1917, ses abus de pouvoir seront
récompensés par le commandement de l’armée du Levant en 1924, où
il aura toute latitude, à près de 70 ans, de massacrer les Druzes.
Arif Banouche
(Soviani), né en 1898 à Starova (Albanie), célibataire,
cultivateur, illettré
Arrêté par des
gendarmes albanais du contingent français, alors qu’il descend de
sa barque sur les berges du lac Malik, Banouche, 18 ans, « après
avoir reçu environ 200 coups de bâton, qui lui furent appliqués
selon la méthode en usage dans ce pays » cesse de nier :
« j’ai été obligé d’avouer que j’avais été chargé
d’une mission d’espionnage qui m’avait été confiée, le 16
mars écoulé, après une entrevue avec un certain Illio, agent du
service de renseignement autrichien. Le prénommé m’avait versé
une somme de dix livres turques en or et m’avait promis un sac de
farine de maïs pour me rendre à Sverza où je devais reconnaître
la force des effectifs français stationnés dans cette région. Je
devais ensuite continuer ma route sur Florina… Si j’ai accepté,
c’est à la suite des menaces faites par Illio qui m’avait
bastonné et me disait qu’il me couperait en morceaux.».
CG de la 57è DI (9
juin 1917) : Les notes d’audience font apparaître un certain
Osman Bacalbachiche, 21 ans, sujet turc, condamné à mort par le CG
de la 156è DI, (dont la peine a été commuée par le Général en
chef) entendu à titre de renseignement qui explique lorsqu’on lui
montre une lettre rédigée par l’inculpé : « lorsque
moi-même je pratiquais l’espionnage le mot famille signifiait une
unité importante supérieure au régiment. Le nom du fils avait
trait à une unité inférieure au régiment… Les phrases ont
l’allure d’une lettre missive mais cela ne signifie rien,
moi-même lorsque je correspondais avec des agents d’espionnage, je
le faisais sous forme de comptes d’épicier. » Mis en
présence d’Arif Banouche, il déclare : « Je le
reconnais parfaitement, l’ayant vu plus de vingt fois dans les
lignes bulgares. » Banouche a lui-même livré trois autres
personnes qu’il désigne comme espions, mais qui seront acquittées,
seul son témoignage pesant contre elles.
Banouch
est fusillé dans la cour de la gendarmerie de Monastir le 12 juin
1917 à 4h.
Hernandez Nicolas
Calvo, né le 10 septembre 1870 à Aldea del Obispo
(Espagne), débitant de boissons, mercier et vendeur de journaux à
Irun
Francisco Serrat,
né le 3 avril 1882 à Blanès (Espagne), bouchonnier
Francisco Torres,
né la 8 avril 1887 à Barcelone, tailleur d’habits à Bordeaux
Soupçonnés, Jeanne
Lay, femme Bonardel, employée aux Dames de France à Bordeaux,
Madeleine Jambon, Felipe Beck et Antonio Ruiz, seront remis en
libertés faute de preuves.
Serrat est arrêté
le 7 septembre 1916 à Bordeau. Lors de la fouille on trouve sur lui
une liste de bateaux se trouvant au port de Bordeau (destination,
date de départ, nature de la cargaison, armement). Surveillé depuis
un certain temps, il se rend fréquemment à Irun pour voir Calvo.
Une lettre de la même écriture adressée à Hendaye à l’adresse
du délégué de l’Office national de la main d’oeuvre agricole,
provoqua l’arrestation de Serrat chez qui fut trouvée une lettre
chiffrée et la grille de chiffrement, renseignant également sur les
mouvements maritimes. Calvo sera confondu par le témoignage d’un
certain Abadia, tailleur à Hendaye, à qui il avait proposé de le
renseigner sur les mouvements des ports de Rochefort, La Rochelle,
St-Nazaire, brest et Cherbourg et d’en rendre compte à un certain
Hermann, ex-consul allemand à Cognac, retiré à St-Sebastian en
Espagne. Cet homme accepta d’accord avec un agent du
contre-espionnage français avec lequel ils forgèrent des rapports
fantaisistes. Un co-détenu de Serrat, Brun, parvint également à
lui faire croire qu’allant bientôt sortir il était prêt à
travailler pour l’Allemagne. Serrat finit pat avouer devant le
procureur de la république de Bayonne qu’il est entré au service
de l’Allemagne le 10 ou 12 août 1916, ce qui renvoie le dossier
devant la justice militaire.
CG de la XVIIIè
région, recours en révision rejeté le 5 avril 1917
Calvo,
Serrat et Torres sont fusillés à (Mérignac) Luchey-Halde le 30
juin 1917 à 5h.

















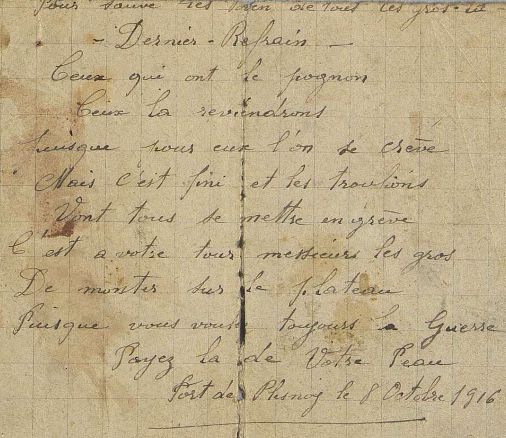
















Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire