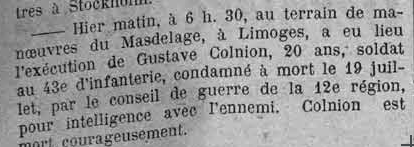Juillet
André Alfred
Vasse, né le 4 janvier 1893 à Graville sainte-Honorine,
tôlier au Havre, célibataire, clairon au 274è R.I. 21è Cie,
casier : néant. Punitions, néant. 3 blessure (éclat d’obus
à la tête à Guise en 1914, bras gauche en juin 1915, à la cuisse
en décembre 1915.
Inculpé de révolte
avec, du même régiment ;
Jolivet
Adrien, boulanger à Montbrun, casier vierge, deux punitions l’une
portant pour moif d’être resté indûment 48h à Paris, lors d’une
permission de détente de 7 jours ; condamné à mort, peine
commuée en 16 ans de prison le 30 juin, amnistié le 4 mars 1922
(alors en supension de peine au rgt de marche de la Légion étrangère
à Meknès)
Auguste Désiré
Lefèvre (garçon-charcutier à Paris), 8 ans de TP, amnistié le 15
octobre 1920 (atelier de TP d’Orléanville)
Henri Auguste
Deshais, maçon à Petit Quevilly, marié, casier vierge, croix de
guerre,5 ans de TP (Orléanville, dirigé en août 1919 sur le 40è
R.I., remise de la moitié de la peine en mai 1920)
Rapport du
Lieutenant Viel : « Le 6 juin 1917, le 6è Bataillon du
274è était cantonné à Longueval (Aisne) et devait monter en ligne
le soir. Dans l’aprèe-midi une agitation se produisit dans le Btn,
agitation qui se traduisit le soir, pour une grande partie des
hommes, en un refus formel de monter en ligne, déclarant que leur
attitude était conforme à celle des camarades des autres régiments
de la division. L’action des officiers de la Cie et des officiers
supérieurs ne put convaincre les mutins et ce n’est que le
lendemain matin qu’un officier de la Cie put les décider et les
ramener tous sans exception. Beaucoup parmi eu regrettent leurs
fautes, mais déclarent n’avoir pu quitter les groupes autour
desquels quelques-uns faisaient bonne garde pour empêcher toute
défection. L’influence de ces derniers fut énorme sur leurs
camarades dont beaucoup sont de très bons soldats et dont l’attitude
fut une très grande surprise pour leurs chefs. Le clairon Vasse,
intelligent, peut être considéré comme un des principaux meneurs,
certainement le premier dans la Cie… Pendant lepeu de temps qu’il
a été à la Cie, le clairon Vasse s’y est montré un soldat
médiocre, paresseux et de mauvais esprit. »
Alors que le
lieutenant Viel nourrit pour Vasse un mépris relativement distancié,
ce méchant homme paraît entretenir vis-à-vis de Lefèvre des
sentiments proches du dépit amoureux, le vouant aux gémonies avant
de le porter au pinacle, comme si quelque chose d’inconnu, survenu
en dehors du régiment lui avait volé son petit soldat-modèle :
« Il est de
toute nécessité de punir les hommes qui sont apparus comme étant
les meneurs et Lefèvre est un de ceux-là. Ancien mitrailleur de la
C.M.6, passé à la 21è Cie par mesure disciplinaire, il a encouru
dernièrement deux punitions pour absence illégale, dont la dernière
a été annotée de la façon suivante par le colonel : »à
la prochaine faute grave sera versé dans une section de
discipline. » Soldat de la classe 1916, très intelligent,
grand et fort, il exerce sans aucun doute, une autorité néfaste sur
ses camarades, en particulier sur ceux de la classe 1917 de sa
section qui l’ont suivi dans la mauvaise voie. »
« Le soldat
voltigeur Jolivet semble avoir été parmi les meneurs. D’un
caractère hypocrite et sournois dont rien n’approche, jamais un
gradé n’a pu lui faire dire une parole, malgré qu’aucun geste
ou acte de sa part n’ait trahi son attitude il apparaît que cet
homme a été dangereux au cours des incidents et on peut être
certain qu’aucun interrogateur lui fera dire quelque chose.
Mobilisé jusqu’au 5 juin 1916 à la 12è section du C.O.Q. comme
boulanger, Jolivet est arrivé au 274è à cette date. Venu après
blessure à la 21è Cie le 26 janvier 1917, il vient d’être
l’objet d’une plainte en CG, qui a été suspendue sur la demande
du Colonel. Il est bien de ceux qui n’ont pas droit de se plaindre.
Le soldat Jolivet doit être puni. »
Notes d’audience :
CG de la 5è DI, le 16 juin 1917
Vasse : « J’ai
pris part à la révolte mais je ne suis pas un instigateur. »
Déposition du
lieutenant Marcel Viel : « Fin de mai, le Colonel nous a
prévenus des incidents du 36è et du 129è. Le Guillou, officier de
jour dans ma compagnie a fait punir deux hommes pour mauvais propos
tenus. Le soir du 6, il y avait effervescence… vers 18h j’étais
dans la cour de ma Cie ; des hommes d’autres Cies sont arrivés
conduits par Vié, Duchemin, etc. ces deux derniers se sont mis en
rapport avec Vasse, agent de liaison avec les autres unités. Je l’ai
vu aller de groupe en groupe… Jolivet n’était pour rien dans
cette affaire ; il est d’un caractère fermé, je le connais
très peu mais suffisamment pour dire que c’est un mauvais soldat…
Lefèvre était un très bon soldat, puis il a pris une permission de
48h, puis une autre et son attitude changeait de jout en jour. Son
attitude a poussé les jeunes gens de sa section,
fusilliers-mitrailleurs comme lui, à ne pas monter. Deshais est un
soldat franc, loyal, il a deux citations et a été blessé ; il
s’est présenté à moi pour faire une coup de main aux Eparges. Je
n’ai rien qui mette Deshais dans le même cas que les autres ;
il n’est pas monté et peut-être que cette attitude a pu
influencer les autres. Si Lefèvre avait dit « nous montons »
ses camarades seraient montés et cela je l’affirme. C’est un
modèle de fusillier-mitrailleur qui en impose aux autres. »
Sous-Lieutenant
Maurice Sansom : « Je suis resté pour ramener les mutins.
Vers 19h30, ceux qui étaient resté allèrent chercher leurs fusils
et équipements, tous les soldats ont défilé devant moi. J’ai vu
Vasse, une canne à la main qui a dit en m’apercevant :
« Allez les gars, n’écoutez pas l’officier qui a l’air
de faire des discours, il s’agit de rester là, rejoignons les
autres ».
Vasse : « Un
colonel nous ayant dit de rester là et de monter le lendemain, nous
nous sommes groupés dans la cour de la 21è Cie. »
Lefèvre : « Je
n’ai pas d’influence sur mes camarades comme mon commandant de
Cie a l’air de le dire. »
Recours en révision
rejeté le 22 juin : un télégramme chiffré du 30 juin émanent
de l’Etat-Major nous apprend que le Président a rejeté la grâce
de Vasse, mais aussi qu’il a commué en 20 ans d’emprisonnement,
les peines capitales prononcées contre :
Victor Henri René
Barjolle, Raymond Frankel, Paul Maxime Selim, Eugène Jule Eugène
Verraux, François Eugène Bouy, Victor Gabriel Pierre Rouge, du 74è
R.I. et Charles Turpin du 274è
en seize ans, celles
prononcées contre (outre Jolivet) :
Guillaume Marie
Guidou, Louis Maury, Henri Lazare Chauveau, Pierre Alfred Auguste
Marie, Louis Germain Hay, Georges honoré Montagnat du 74è R.I.,
Eugène Albert Groslambert, Gaston Eugène Albert Julienne, Louis
Augustin Stanilas Lacuisse du 274è,
soit 17 condamnés,
dont 16 n’apparaissent pas dans la procédure.
Vasse est fusillé à
Paars (Aisne) le 2 juillet 1917 à 7h : « onze balles
avaient porté. Il s’est manifesté dans le cadavre quelques
mouvements convulsifs qui ont cessé immédiatement après le coup de
grâce. »
Ernest Joseph
Terrier, né le 8 juin 1896 à Saint-André de Val de
Fier(Haute-Savoie), garçon fromager à Rumilly, célibataire, soldat
au 327è R.I.
CG du Gouvernement
militaire de Lyon (3 avril Grenoble, jugement cassé, les juges
n’ayant pas mentionné le nombre de voix aboutissant à la
condamnation : Lyon audience du 11 mai)
Dans l’après-midi
du 25 janvier 1917 aux environs de Rumilly, le jeune Pétrus
Perrotin, se rend chez la veuve Chavanel dont il avait battu le
trèfle et qui lui avait dit quelques jours auparavant de venir se
faire payer. Il trouve porte close. La voisine la plus proche, Mme
Chapuis, l’accompagne au fenil où,elle l’engage à se laisser
glisser dans un trou ménagé à dessein dans le plancher, au-dessus
du râtelier de l’écurie ; « de là, il gagna la
cuisine, qui communique avec la chambre à coucher. Il n’alla pas
plus loin, car il aperçut le corps de la veuve Chavanel, en travers
de la porte, le haut du corps dans la cuisine, le bas dans la chambre
à coucher. » La gendarmerie la trouve ainsi, sous une
couverture, dans une chemise maculée de sang, couchée sur le côté,
appuyée sur le montant de la porte, jambes parallèles, main droite
sur la fesse droite, visage ensanglanté. Dans la chambre, une large
tache de sang se trouve au pied du lit, le tiroir médian d’un
buffet à deux corps a été fracturé, des billets de 20, 5, 1
francs traînent sur le rebord de la fenêtre, à proximité de
laquelle une serpe sanguinolente est découverte, déposée sur la
table. Une chaise a été renversée.
Très vite l’enquête
se focalise sur Ernest joseph Terrier, récemment en permission à
Rumilly, qui, dans la nuit du dimanche 21 au lundi22 janvier a fait
des « dépenses désordonnées » dans la maison de
tolérance de cette ville. Apparu entre 18 et 19h dans cet
établissement, Terrier monte avec Augustine Dexarcis, et redescendu
au bout de vingt minutes, annonçant son intention de revenir passer
la nuit avec elle. Il paye alors à la tenancière, Mme Mallet le
prix de la nuit, cinq francs, tirant de sa poche un portefeuille
usagé dont tombent quelques billets. « Cela ne chie pas, fait
Terrier ». Cinq minutes plus tôt il avait demandé à
Augustine la monnaie d’un billet de cent francs, laissant entrevoir
que le portefeuille en contenait une dizaine environ. A son retour
deux heures plus tard, il avise quelques jeunes gens attablés et
offre à l’assemblée 5 bouteilles de vin blanc cacheté à 5
francs l’unité qu’il règle avec un nouveau billet de 100
francs. Il monte peu après avec Augustine, Lucette (Clémentine
Bourdeaux) et quelques clients, et offre deux bouteilles de
champagne ; « la soirée s’avançant Terrier finit par
rester seul dans la chambre avec les deux femmes. L’orgie
commence ; toute la nuit, le champagne coule à flots, à tel
point même que pour ne pas s’enivrer… l’une des femmes répand
son verre à terre et s’attire une remontrance de Terrier. Trois
autres billets de cent francs sont encore changés, malgré la
résistance de la patronne qui voudrait bien ne pas donner toute la
monnaie. Vers 3h du matin, la patronne est à bout et va se coucher,
non sans avoir placé plusieurs bouteilles de champagne pleines à la
porte de la chambre où couchait Terrier. Le lendemain lundi, Terrier
reste dans la maison de tolérance jusqu’à 14h. Il déjeune avec
les femmes et change encore trois billets de 50f. » A la
patronne qui s’inquiète de la provenance de tout cet argent,
Terrier répond qu’il vient d’hériter de 30 000 francs, et à
Augustine Dexarcis qui le questionne sur les égratignures qu’il
porte à la main droite et la présence d’une tache de sang sur sa
manche gauche, qu’il s’est battu avec des conscrits en chemin.
Autres indices
confondants : Terrier a été rencontré par une demoiselle
Muffon vers 17h alors qu’il se dirigeait dans la direction du
faubourg où résidait la veuve Chavanel, dont l’autopsie a révélé
qu’elle avait été tuée après avoir dîné, sans doute vers 18h,
puisqu’elle avait déjà rentré ses poules. Des bribes de corne de
cerf ont été retrouvées sur le lit de la veuve ; or, un
certain M. Lois affirme avoir vu Terrier lors de sa dernière
permission, manger chez lui à l’aide d’un couteau à manche de
corne de cerf. De plus pendant l’effraction du tiroir, un encrier
s’était renversé ; or, plusieurs des billets changés par
Terrier portaient des taches d’encre.
A la suite d’une
reconstitution et d’une confrontation en présence de sa mère et
de s a jeune sœur le 2 mars, Terrier finit par avouer : le
dimanche 21 janvier entre 17 et 18h il est entré dans la maison par
le trou du fenil. Il a trouvé la veuve Chavanel couchée, lui a
demandé des sous. Celle-ci s’est dirigée vers le buffet en lui
disant de ne pas lui faire de mal. Mais en passant devant la fenêtre,
elle distingue le profil du voleur et s’écrie « C’est toi
Terrier ? » puis appelle à l’aide. Terrier lui donne un
coup de poing dans l’œil qui la renverse sur le lit, il la saisit
à la gorge, tente de la bâillonner avec un vêtement, mais comme
elle crie toujours, il la frappe de l’autre main avec le manche de
son couteau. Elle s’affale sur le dos sur le plancher contre le
lit, tête appuyée au buffet. Terrier va à tâtons chercher une
serpe dans la cuisine, et fracture le tiroir à grands coups. Il y
prélève une somme de 1250 francs et trois bons de 100 fr de la
défense nationale dont il se débarrassera en les déchirant.
« Quand je me suis aperçu que la veuve Chavanel, qui s’était
affaissée entre le lit et le buffet était morte, j’ai transporté
son cadavre dans la position où il a été trouvé et j’ai placé
sur lui une couverture. J’ai voulu ainsi prendre des précautions
pour éviter qu’on aperçoive le cadavre en regardant par la
fenêtre ». Terrier prétend qu’il n’a pas prémédité le
meurtre, et que si la veuve Chavanel ne l’avait pas reconnu, il ne
l’aurait pas tuée. Cependant, Bastard, coutelier à Rumilly
affirme avoir, le 21 janvier vers 16 heures, vendu à un militaire
qu’il ne connaissait pas un couteau à cran d’arrêt à manche en
bois de noyer. Terrier reconnaît avoir acheté ce couteau, mais
précise-t-il vers 19 heure, après son premier passage à la maison
de tolérance, et pour remplacer l’arme du crime dont il s’était
débarrassée en la jetant dans un champ enneigé. La question de la
préméditation reste donc indécidable par la simple constatation
des faits.
Le
commissaire-rapporteur, afin de lever toute ambiguïté, fait
soumettre Terrier à un examen psychiatrique qui conclut qu’en
l’état de la science, aucune affection physique ou mentale ne
paraît diminuer la responsabilité pénale de l’inculpé. Il
souligne que la prédisposition à l’impulsivité n’est qu’une
hypothèse, relève tout de même qu’une dizaine d’années avant
la naissance de Terrier, son père avait été convaincu d’homicide
au cours d’une partie de carte qui avait mal tourné, et que
Terrier avait été condamné le 17 novembre 1914 pour voies de fait
sur la personne de sa mère.
Divers points du
dossier resteront dans l’ombre après les aveux de Terrier, le
procureur du gouvernement ne pouvant s’y attarder ou n’ayant pas
la compétence de mettre en jugement certains personnages
secondaires. Une longue séquence de l’enquête s’attarde sur la
disparition du butin. Selon les témoins, Terrier aurait dépensé
environ 450 francs dans la maison de tolérance, et en serait
ressorti le lundi avec en sa possession un seul billet de 50 francs ;
800 francs se sont donc évanouis dans la nature. Terrier soutient
que durant la nuit de dimanche, il aurait vu Lucette, invitée à les
rejoindre non sur sa propre demande mais sur celle d’Augustine,
fouiller son portefeuille. Mme Mallet, la tenancière, qui n’est
toujours pas propriétaire du fond aurait remis à son frère
quelques jours après le passage de Terrier une recette
particulièrement élevée, ce qui entraîne pour les trois femmes
une suspicion de recel, voire de vol, présomption renforcée par la
découverte de ladite Clémentine Bourdeaux travaillait sous une
identité usurpée depuis son entrée au bordel de Rumilly. A
l’époque où la procédure est encore ouverte contre X, Louis
Chavanel, soldat au 56è R.I. en permission à Rumilly fait cette
déclaration confondante :
« Dès que
j’ai appris l’assassinat de ma mère par un télégramme que j’ai
reçu de mon voisin Perrotin, j’ai immédiatement pensé que
l’auteur de ce crime devait être Terrier Ernest que j’avais
fréquenté autrefois. Sa mère occupait la ferme Viret qu’elle
faisait valoir. Avant qu’il parte au régiment, je fus, un jour,
obligé d’intervenir parce qu’il voulait tuer sa mère… Il
avait brisé tout le mobilier… ces ffaits se plaçaient après la
condamnation dont il avait été l’objet pour des faits analogues.
Pendant cette nuit-là, nous n’avons pu dormir à la maison car
nous avions peur à chaque instant qu’il nous tue ou incendie notre
ferme. Depuis la route, il lançait des pierres sur notre maison dans
laquelle s’étaient également réfugiées sa mère et sa sœur. Il
essaya d’y pénétrer en forçant les portes. Quelques temps avant,
je fréquentai Terrier Ernest, dont j’igorais la mauvaise conduite,
quelque fois il venait à la maison pour boire un verre. Plus tard
j’ai appris que ce jeune homme était un malfaisant et j’ai cessé
de le fréquenter. Il m’avait menacé de me tuer parce que j’avais
défendu sa mère contre lui. Terrier savait parfaitement où ma mère
mettait son argent car il m’a vu plusieurs fois en prendre. »
Le 28 janvier, le
colonel du 327è R.I. télégraphie au procureur qu’en réponse à
sa demande de la veille, Terrier, rentré au corps a été mis en
prison. Recours en révision rejeté le 29 mai 1917.
Terrier est fusillé
à la Doua, Villeurbane le 3 juillet 1917 à 4h.
Joseph Louis
Ruffier, né le 4 mai 1884 à Lachassagne (Rhône), mineur
à Auchel (Pas de Caliais), célibataire, 2è classe au 370è R.I.
Le CG de la 170è
DI, des 23 au 25 juin 1917 condamne à mort 17 soldats pour révolte
dont ils sont considérés comme les instigateurs ou les chefs. :
le soldat infirmier François Mazoyer, Alexandre Joseph Orieux,
Gilbert François Détruit, le caporal Henri Saunier, Pierre Alfred
Gane, Léon Emmanuel Allart, le 1ère classe André Georges Pernin,
Joseph Albert Louis Levrault, Paul Joseph Rémy, le caporal Edouard
Félix Ponnaire, Vincent Léon Fontaine, Aimé Henri Victor Marcombe,
Louis Etienne Maillet, Albert Auguste Grandemange, Petrus Patay, le
1ère classe Henri Jean Legale, tous du 370è R.I. (et quatorze
autres inculpés condamnés à des peines moindres : Louis
Fridel, dit Eugène Angevin, le 1ère classe Jules Turbault, Charles
Albert Fromentin, Charles Beyon, Marcel Adrien Roth, 1ère classe
Auguste Jules Emile Poux, 1ère classe François Henri Léchenault,
Georges Edmond Clément, Félixe Etienne Parisse, François Chetaud,
Jean Auclair,, Armand Chamereau, Jean-Baptiste Manière, Gaston Louis
Auguste Desbordes).
Recours en révision
rejeté le 29 juin 1917 : parmi les moyens invoqués, on trouve
pour une fois un fait intéressant concernant le sens de la justice
des tribunaux militaires ;« étant donné qu’il résulte
d’un jugement avant-dire droit… que M. le Président du Conseil a
prononcé les paroles suivantes, encore qu’[il]…ait refusé sans
en avoir, nié la réalité, d’en donner acte à la défense , :
1-Au cours des
débats et à plusieurs reprises, le Président du Conseil de guerre
a déclaré que le rôle de délégué ou de porte-paroles était un
rôle de chef de la révolte
2- Le président du
CG a articulé à l’adresse d’un accusé (Legale) les paroles
suivantes : « Ce n’est pas une giffle que je vous aurais
donné, c’est mon revolver que j’aurais pris, et je vous aurais
brûlé la gueule » [Ne doutons pas qu’il fût coutumier du
fait.]
3- Le P du CG à
Auclair [condamné à 10 ans de TP] « je vais vous prouver,
moi, que vous êtes un meneur »
Attendu tout d’abord
que les paroles relatées sous le n°3 ont trait à un condamné qui
ne s’est pas pourvu en révision et qu’il n’y a pas lieu par
conséquent d’en faire état…
Pour sa mémoire et
la postérité, afin de se souvenir d’aller cracher sur la tombe de
ce Galiffet s’il en a une, ce président était le Lieutenant
Colonel Leyraud.
De façon tout à
fait extraordinaire le dossier de procédure est vide ; aucune
mention des grâces, aucun rapport sur le déroulement des faits.
Et pour cause, il
s’agit du procès des révolutionnaires de Coeuvres, relatifs aux
événements du 2 et 3 juin 1917, qu’il convient de faire oublier
pour réécrire l’histoire. Les autorités se sont efforcées de
faire disparaître les pièces d’instruction en les disséminant
dans d’autres procédures plus ou moins secrètes, divers
témoignages permettent de reconstituer et le déroulement des
événements et le procès scandaleux chargé de la réprimer.
Missy-aux-Bois, rue de l'Eglise
Le
procès de la sécession de Coeuvres et de Missy-aux-Bois
(2 au 8 juin 1917)
La reconstitution de
la procédure nous est connue par Joseph Jolinon, docteur en droit,
avocat à Lyon et soldat au 370è R.I. qui fut le défenseur de Roth,
Gane et Orieux. Après guerre, Jolinon quittera sa profession pour
commencer une carrière d’écrivain qui le voit publier une dizaine
d’ouvrages (dont, récompensée par le Grand prix du roman de
l’Académie française en 1950 pour Les Provinciaux). C’est
dans Le valet de gloire (1923), qu’ il raconte son
expérience de défenseur des mutins et dresse un portrait sombre de
l’armée et des hommes qui la composent. En 1930, il évoque à la
fois l’échec de l’offensive Nivelle et les actes de
désobéissance dans Les Revenants dans la boutique.
Alors qu’il
n’avait plus accès aux dossiers, Jolinon cite assez exactement les
propos dérangeants du Colonel Leyraud, et y ajoute même celui-ci
qui n’est pas relevé dans le dossier de révision :
« Avec des
salauds de votre espèce, on ne discute pas, on met des mitrailleuses
et on tire dans le tas. »
Jolinon rapporte que
son 3è client - sans doute le maçon Gane, marié, deux enfants,(
quoiqu’on ignore le statut marital de Roth qui ne s’est pas
pourvu en révision) -, était désigné par ses chefs comme
socialiste, qui produisirent une lettre écrite à sa femme après
son interrogatoire où il écrivait :"Tant pis, j'en ai assez,
je n'ai rien à défendre, j'ai travaillé en Allemagne avant la
guerre. On y touche de gros salaires. Tu le sais, ma patrie, c'est là
où on me paye le mieux".
Si le JM du 374è
ignore complètement les faits, d’autres documents les rapporte,
entre autre les lettres émanant des mutins saisies par le contrôle
postal (dont une partie importante est citée par Denis Rolland dans
l’ouvrage de référence sur les mutineries : La Grève des
tranchées .)
Comme dans le cas
des émeutes du 129è, tout commence, le 1er juin, par le
passage de camions aux dans le village de Coeuvres où n’est
demeuré que le 370è, les autres unités (17è R.I., 3è et 10è
BCP) ayant été envoyées dans des villages voisins. Des hommes du
36è et des révoltés du 129è, (3è Corps) qu’on emmène vers
Royes dont des adjudants et aspirants passent brandissant des
drapeaux rouges, chantant l’Internationale ; ils jettent des
tracts, crient « Ah bas la guerre ! Faites comme nous,
tout le 10è Corps a refusé de marcher. Faites comme nous, la guerre
finira demain ».
Selon le témoignage
du caporal Darimon (autre défenseur) : « Il n’y a plus de
galons » disaient-ils, en tournant leurs manches en dedans.
« Ce n’est pas sur Berlin qu’il faut marcher, c’est
contre Paris. Si vous n’êtes pas des lâches, vous n’irez pas au
front ».
Quoiqu’ils
paraissent accueillir l’incident avec placidité et indifférence,
les manifestations d’Amblény, de Soissons, Dommiers et Mercin ont
laissé des traces et échauffé les esprits.

Tract de mutin (probablement 5è DI)
Le 2 juin vers midi, le
régiment reçoit l'ordre de quitter le cantonnement pour gagner
Bucy-le-Long. L'ordre survient en même temps que les soldats
apprennent par les journaux que les passeports pour la conférence de
Stockholm ont été refusés aux syndicalistes, et que tout espoir de
paix s'évanouit.
La 17è Cie cantonnée à Laversine, et
la 23è à Coeuvres refuse de faire les sacs pour partir. Le colonel
Dussauge intervient personnellement mais se heurte à un refus
concerté et au silence, tandis qu'une colonne de la 17è Cie,
entraînant une partie de la 19è monte vers Coeuvres pour se rallier
au 23è. 200 hommes passent, de part et d'autre du colonel planté au
milieu de la route, sans s'arrêter. Le même passe sous silence la
manifestation qui a lieu dans le village ce soir-là : les hommes
s'éparpillent dans les rues, tirent des coups de fusil et de
mitrailleuses, chantent l'Internationale. Un groupe de 600 soldats se
met en marche vers Villers-Cotterêts, quelques un reviennent en
arrière. Ceux qui n'ont pas suivi sont rassemblés pour gagner
Bucy-le-Long. Dussauge les met en garde, car, prétend-il "les
lâches ont mis une mitrailleuse en batterie" à la croisée du
chemin de Saint-Pierre-Aigle. Le général Pont annonce au
commandement que le régiment est rentré dans le devoir. Il n'en est
rien.
Le mardi 3 juin les
révoltés se sont installés dans le bois du Champ-Vernaux (route de
Soucy et Villers-Cotterêts). Un émissaire, un capitaine découvre
avec surprise un caporal qui vient à sa rencontre et des sentinelles
postées pour la garde d'un cantonnement d'alerte qui l'empêchent de
passer. Il délivre un ultimatum donnant aux mutins une demi-heure
pour se rendre.
A la suite de cette entrevue les mutins
quittent le bois de Champs-Vernaut pour se diriger sur Missy aux
bois. Ils auraient emporté deux mitrailleuses. Le commandement prend
toutes les dispositions pour assurer la garde des gares de Vierzy et
de Berzy-le-Sec qu'ils craignent de voir envahie pour monter sur
Paris comme ç'avait été l'intention des mutins du 129è.
Mais, comme ils le confirmeront à un
agent de la Sûreté, puis au curé de Vauxbuin venu célébrer un
service le 6 juin, les révoltés de Coeuvres et Missy ne se voient
pas comme des révolutionnaires. Ils refusent tout simplement de
monter aux tranchées. L’échec programmé de la conférence pour
la paix les préoccupe plus que la révolution russe, accusation qui
reflète essentiellement la peur des officiers). Leur soumission
n’est pas conditionnée à l’attribution de permissions comme la
plupart des autres unités, mais à la revendication beaucoup plus
utopique (encore très scandaleuse et minoritaire chez les soldats)
d’une paix immédiate. Un autre élément assez unique apparaît
dans leurs demandes ; ils ne voient pas du tout avec soulagement
l’arrivée des Américains et arguent que « ceux-ci vont
prendre la place de nos conducteurs de poids lourds, de nos ouvriers
dans nos usines -où il y a déjà trop d’ouvriers étrangers- si
bien qu’un plus grand nombre de Français sera disponible pour
aller se faire tuer. »
Au cours de la nuit du 3 au 4, les
révoltés apprennent que le 17è R.I. s'est soulevé à Soissons.
Ils décident de le rejoindre mais la 5è brigade de cavalerie est
venue encercler le village de Missy avec consigne de tirer sur
quiconque tente d'en sortir. Aucun civil ne peut plus y rentrer non
plus. Le capitaine de la 5è brigade, Laforest rend compte au général
de la 166è DI le 6 juin: "la situation n'a pas changé depuis
hier, les mutins sont toujours encerclés dans Missy-au-Bois par des
escadrons de cavalerie (4è, 5è et 15è chasseurs à cheval)"
Exemples de lettres
saisies par le contrôle postal:
« Samedi le mouvement s'est déclenché dans mon régiment car nous devions partir dans la nuit attaquer le moulin de Laffaux et nous avions déjà l'exemple d'autres régiments qui en avaient fait autant ; nous nous sommes révoltés voilà trois jours. Je ne reçois plus tes lettres ; ne m'écris plus jusqu'à nouvel ordre; nous ne somme plus ravitaillés et souffrons un peu de la faim, mais ne t'en fais pas, c'est pour la paix que nous travaillons. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas voulu suivre comme Vergue. Cela n'est pas en son honneur, nous sommes d'un mille dans le régiment et comme revendications, nous ne voulons plus monter en ligne avant les pourparlers de paix. Nous nous défendrons jusqu'à la dernière goutte de sang ; plutôt la mort que de continuer une vie pareille. Courage c'est la délivrance. C'est pour le retour auprès de ma petite femme que nous souffrons. » (Anonyme)
Lettre de Détruit,
agent de police à Clermont-Ferrand (déjà passé en CG pour
insubordination et qui sera désigné comme l'un des meneurs, voire,
le chef)
« Depuis le 2 juin nous avons quitté le régiment, le cafard nous a pris et nous sommes partis 500 hommes ; nous mangeons très péniblement et marchons comme des gens qui ne veulent plus la guerre et réclamons la paix. Le nombre de soldats manifestant pacifiquement marche main dans la main. L'argent que tu dois m'envoyer chaque jour de paye, mets-le de côté, car je fais des dettes et il faudra que je les rembourse si par hasard on rejoint le régiment, chose qu'il faudra s'attendre, car nous ne pourrons pas vivre éternellement comme ceci... Ah tu peux croire que c'est une bonne vie : vie de chemineau, vie tranquille et campement en plein air... Alors je prends courage car ta lettre de l'émeute à l'usine m'a fait grand plaisir ; tous civils et soldats demandons la fin de ce triste et cruel fléau; assez de sang versé, notre logis et notre retour. Ne m'écris plus. »
Chaque jour un porte
parole vient parlementer avec les officiers : ils font partis de ceux
qui seront désignés comme les plus coupables. Les soldats votent
tous les matins pour déterminer s'ils se rendent ou préfèrent la
continuation du statu quo. La nourriture manque pourtant, après
l'achat d'une charrette de pain à une boulangère ambulante, le
premier jour, et ce qu'ils peuvent obtenir des habitants ils en sont
réduits à "manger l'herbe des prés". L'institutrice
franchit les lignes pour réclamer au commandant des assiégeants du
pain pour les enfants. Certains civils sont autorisés
occasionnellement à venir manger avec les soldats légitimistes aux
cuisines mobiles du régiment.
A l'intérieur du
village retranchée est placardée une affiche qui sera rapportée
par les députés de la commission d’enquête dépêchée par une
partie de la représentation nationale :
Camarades, les soldats français ne sont ni des voleurs, ni des pilleurs, ni des assassins. le premier qui sera pris à piller et à voler chez les habitants sera immédiatement passé par les armes. Signé, le commandant du bataillon.
Ils n'ont effectivement
commis aucune dégradation dans le village quand ils se rendent le 8
à quatre heure du matin. "Quand ils sortirent du bois, au
nombre de quatre cents, il étaient tous parfaitement propres, cirés
et astiqués. La reddition s'accomplit en silence. Ils étaient
rassemblés en colonne par quatre, par Cies, dans un ordre
impressionnant". (Jolinon)
Lettre saisie par le
contrôle postal, portant un faux nom, adressé à Lucien Mareschal
dans le Doubs :
« ...nous devions monter le 2 au soir pour aller attaquer au Chemin de Dames, l'endroit le plus mauvais de tout le front alors nous avons refusé de marcher, nous étions à peu près 800 pour le régiment, nous avons resté 8 jours dans un petit pays là ils nous ont empêché de nous ravitaillés nous en étions réduits à manger de l'herbe et nous étions gardés par la cavalerie... au bout de 8 jours nous nous sommes rendus, nous en étions du reste obligés par la faim, ils nous ont désarmés et ils nous ont conduit en auto dans un camp qui avait été préparé pour recevoir des boches (comme il n'y en avait pas c'est nous qui l'avons occupé) là on nous a permis d'écrire sur une carte militaire ou une lettre décachetée, quelques mots seulement pour vous donner de nos nouvelles. Pour le moment nous sommes au secret ça nous est défendu d'écrire, ils ont peur que ce mouvement là se propage, mais ils ont beau faire et beau dire que le moral est bon, l'armée n'en veut plus ; c'est la paix qu'il nous faut. »
Ils sont transportés à
Soissons et triés dans cour de la caserne Charpentier. 150 sont
emmenés par le 4è spahis au camps de Loupeigne : ils seront
embarqués des la fin juin vers l'Algérie et l'Indochine. 23 puis 31
"meneurs sont emprisonnés. Les autres sont dispersés dans des
compagnies de discipline.
Aristide Jobert, député,
: "Voici l’enquête qu'on a faite : les officiers qui n'en
menaient pas large auparavant se sont retrouvés ; lorsque la
cavalerie a ramené ces hommes (à Soissons dans la caserne
Charpentier) les commandants de Cie, sans enquête ont dit : untel et
Untel, sortez des rangs".
Il est compliqué de glaner
des informations sur les accusés et l’organisation de leur
sécession. Toutefois, la procédure en révision tardive (1925) du
dossier Pernin, apporte ces quelques précisions :
"Pernin a été incontestablement
l'un des meneurs : il n'a peut-être pas organisé par avance la
mutinerie mais il est parti des premiers en criant: "en avant!"
; il a par la suite harangué les délégués auxquels il exposait
qu'il était fatigué de la guerre et que le gouvernement en refusant
les passeports pour Stockholm "écartait tout espoir de paix"
C'est lui qui proposa la désignation de deux délégués par
compagnies et il fut élu délégué de la sienne avec Mazoyer. Il
était reconnu par tous comme le chef centralisant les vivres et
l'argent, faisant un rapport aux autres délégués, donnant des
instructions, rassemblant les mutins au moyen d'un sifflet lorsqu'il
avait une communication à leur faire. Enfin c'est lui qui avec
Mazoyer, fut désigné pour aller parlementer avec les officiers sur
les conditions de la reddition."
Et l’on suppose que c’est Mazoyer,
1er inculpé dans la procédure d’origine qui tenta
devant le conseil ce coup d’éclat rapporté par Jolinon :
« Le premier accusé pressé de questions et refusant d'y
répondre, s'avança vers les juges et dit: "Puisqu'il faut
vraiment, puisque c'est nécessaire, puisqu'il faut vraiment que cela
se paye par la mort, je m'offre au nom de tous les autres, je me
sacrifie pour tous mes camarades". »
Ce n’est pourtant pas lui qui paya.
Percevant la portée politique du dossier, Pétain fit transmettre le
dossier au président de la république, sans user de son droit de
décision. Le 4 juillet, à l'issue de la revue d'un bataillon
américain aux Invalides des députés de la côtes d'or vinrent
demander la grâce des 17 condamnés à mort. C'est ainsi que, dès
le lendemain, six peines furent commuées en 20 ans, deux en dix-huit
ans et huit en quinze ans. "Ruffier n'était pas plus coupable
qu'une centaine d'autre, mais il n'avait pas de famille pour le
pleurer" (Jolinon). Condamnés deux fois à cinq et dix ans par
le CG de la 71è DI pour refus d'obéissance, et en 1907 pour vol, il
était de par ses antécédents le mouton noir tout désigné.
Ruffier fut fusillé à Saint-Pierre-Aigle (Aisne) le 6 juillet 1917
(pas de PV). Son corps, dans un premier temps enterré sur place, fut
transporté en 1920 dans la nécropole nationale de Vauxbuin où sa
tombe porte, par erreur, la mention "Mort pour la France".
L’affaire de Coeuvres ne
s’arrête pas ici : elle va causer de nombreux remous
attestant des luttes intestines que se livrent militaires et
politiques. Le fait-même qu’il n’y ait eu, à l’issue de cette
parodie de justice, qu’une seule victime, alors que les militaires
auraient certainement préféré « tirer dans le tas »,
n’indique-t-elle pas que ces événements auraient été le
résultat d’un complot d’État, plus ou moins bien maîtrisé ?
Le résultat final est peut-être la dissolution pure et simple du
370è R.I. début novembre 1917.
On essaya évidemment de
mettre en cause des civils : un agent de la Sûreté vint ainsi
interroger le maire de Coeuvres afin de tenter de lui faire dire que
des débitants de boissons de sa commune auraient excité les
militaires, leur versant du champagne à flots en disant "Buvez,
ne vous inquiétez pas, c'est payé d'avance". La ville est
consignée deux mois avant que l'autorité militaire y cantonne à
nouveau un régiment, faisant de Missy un poste médical avancé plus
particulièrement à destination des Américains. Qu’est-il advenu
des civils qui ont été témoins de ces événements, voire y ont
collaboré ? Malgré la 2è bataille de la Marne qui vit la
destruction quasi-totale de Missy en juin 1918, la diminution
drastique de la population de Missy, pour ce qu’on en peut savoir
entre les recensements de 1911 et 1921, ne s’explique peut-être
pas uniquement par les « faits de guerre ».
Pendant la procédure
devant le CG de la 70è DI l’un défenseur (gradé) affirma
qu'avait été rapporté à Coeuvres la présence d'un soldat inconnu
au bataillon, qui, interrogé sur les propos qu'il tenait à la
sortie des débit de boissons aux soldats du 370è aurait exhibé une
carte d'agent de la sûreté. Quand l'assemblée voulut enquêter sur
les événements, il fut dit au cours du Comité secret du 2 juillet
que l'affaire de Coeuvres avait été organisée par le colonel
Delalande, chef de la sûreté de la 6è armée "qui envoyait
ses agents déguisés en colombophiles dans les unités pour délier
les langues" et "tirer les vers du nez des soldats, offrant
généreusement des boissons alcoolisées aux poilus".
Quoique s’obstinant à
nier la présence d’agents provocateurs en mai ou en juin 1917,
l’État Major fut obligé de reconnaître la présence d’un agent
de la sûreté à Coeuvres le 3 juin, muni d’un ordre de missions
lui donnant droit de circuler comme soldat colombophile. C’est à
l’issue de cette révélation que se tint un procès devant la
Haute Cour contre le ministre de l’intérieur Malvy accusé (à
tort semble-t-il) d’avoir organisé les mutineries de l’armée
française. Parmi les pièces de ce procès figurait le rapport
disparu du colonel Dussauge.
Une requête en révision du procès de
la 170è Di fut alors présentée en 1922 par les défenseurs
Damiron, Jolinon et Rolle basée sur l’argumentaire que les mutins
du 370è avaient été victimes d’agents provocateurs. Dans la même
DI des non-lieus auraient été prononcés lors de procès semblables
en vertu du fait que les paroles prononcées n’étaient que la
reproduction mot à mot de discours suggérés par des agents
provocateurs. La demande fut classée sans suite. Dans le même temps
deux autres requêtes individuelles furent présentées au nom de
Pierre Gane et d’André Pernin, qui n’avaient pu bénéficier de
la loi d’amnistie de 1921, excluant les prévenus condamnés en
tant que « meneurs ». Pernin prétendait que,
porte-parole des mutins, il avait été désigné en représailles
par le Lieutenant Feniot qu’il avait accusé publiquement d’être
un peureux. Si ces arguments ne pouvaient être pris en compte,
Pernin bénéficia contre toute attente de la remise de la totalité
du restant de sa peine, en raison de son état de santé, une lésion
pulmonaire sérieuse, lui causant une invalidité de 60 pour cent,
rendant finalement applicable la loi d’amnistie de 1921. Combien
d’autres, manipulés – à quelles fins ?- n’ont pu
bénéficier de mesures de clémence ?
(Camille)
Louis Billoir (Biloir), né le 4 mars 1896 à Paris 4è,
2è classe au 133è R.I., n’est connu que par sa fiche de décès à
l’orthographe incertaine portant « condamné à mort,
fusillé »
Absence de dossier
de procédure comme de révision (voir les cas Aubry, Hartmann,
Hatron). Cette exécution est une conséquence tardive des révoltes
du 1er au 4 juin à Ville-en-Tardenois, impliquant 2000
hommes des 23è et 133è R.I., qui auraient été caractérisées par
de graves violences envers les officiers et une tentative de marche
sur Paris. Denis Rolland, qui place -contrairement aux indications de
la fiche de décès- l’exécution à la date du 9 août mentionne
qu’âgé seulement de 21 ans, Biloir avait un lourd passé pour la
justice militaire, deux fois condamné pour outrage, et trois fois
pour abandon de poste (s’étant soustraits aux attaques les 15, 20
avril et 4 mai à Pouillon-Loivre et Chalons sur Vesles) mentionne un
PV (d’où provient-il?) qui, fait exceptionnel commenterait la mort
en ces termes : « Aucun incident, pas le moindre murmure.
Les militaires présents n’ont paru nullement émotionnés ;
le condamné avait d’ailleurs une figure des moins sympathiques. »
Biloir est exécuté
au lieu dit Les Gilsons, commune de L’Epine (Marne) le 9 juillet
1917.


Fernand Moronval,
né le 10 avril 1895 à Daint-laurent-Blangy (Pas de calais), garçon
de magasin à Arras, 2è classe au 43è R.I., 11è Cie
Tout l’intérêt
de l’affaire Moronval réside dans ce qu’elle laisse entrevoir de
l’état de misère et de détresse morale dans lesquelles vivaient
la majorité des classes populaires :
Rapport du 2 juin
1917 : « Dans la nuit du 8 au 9 avril dernier, à la faveur de
l’obscurité entre Romain et Maizy… le soldat Moronval quittait
son unité, alors que celle-ci, venant de Villers-Hagron, marchait
aux tranchées en vue de l’attaque prochaine. Retournant sur ses
pas, il couchait à Romain dans un cantonnement abandonné. Le
lendemain, 9 avril, il se rendait à Fismes, et y prenait un train
qui l’amenait à Paris dans le courant de l’après-midi. Il en
repartait vers 23 heures pour Amiens où il arrivait le 10 à 6
heures. »
Commissariat central
d’Amiens, le 31 mai 1917 : « Il est exact que le soldat
Moronval est venu chez sa mère… le 10 avril 1917, pour y voir son
frère, Henri 17 ans, atteint de tuberculose et décédé depuis, à
Amiens le 22 mai 1917. Il est arrivé à 8 heures du matin chez sa
mère et en est reparti vers 9h1/4. Il a reçu 5 fr. de sa mère, son
frère malade qui avait de petite économies, lui a donné 5 fr.
également, ainsi que 5 fr. qu’il a reçu d’une sœur :
Eugénie, 26 ans. Mme Vve Moranval, âgée de 42 ans , évacuée
d’Arras est à Amiens depuis le mois de juillet 1915, elle ne fait
que son ménage, ayant soigné son fils Henri pendant un an. Elle a
encore 4 enfants qui sont : alexandre, 28 ans, célibataire,
mobilisé au 84è R.I., en convalescence chez sa mère pour 36 jours
(venant de Serbie), Eugénie, mariée, 2 enfants, l’intéressé,
Fernand et Augustine, 20 ans célibataire, ouvrière couturière,
gagne 2fr.25 par jour, demeurant avec sa mère. La mère touche
l’allocation militaire et la fille l’allocation des Réfugiés.
Loyer : 5fr. Par semaine en garni. »
« Après avoir
fait une courte visite à sa mère… Moronval reprenait le train et
gagnait Crépy en Valois d’abord, et Lyon ensuite où il arrivait
le 11 vers midi. Il demeurait à Lyon un jour environ, et se rendait
ensuite à Chambéry où un ami, dont il ne veut pas indiquer le nom
le recevait. »
Moronval, devant le
CG de la 162è DI (6 juin 2017) : « L’ami que j’ai à
Chambéry est matelassier, il m’a fait vire pendant 2 jours, ne m’a
pas remis d’argent, ne m’a pas donné de conseils. Je ne peux pas
dire dans quelle rue il habite. »
« De Chambéry,
il gagnait Annecy par le train, en repartant à pied dans la
direction de la frontière suisse, marchait deux jours et était mis
en état d’arrestation le 14 avril vers 16 heures 30 par un
garde-frontière au moment même où il allait pénétrer en
territoire suisse. Conduit à la brigade de gendarmerie de
Saint-Julien… il finissait par déclarer qu’il s’appelait « de
la Forge »… Une enveloppe à son nom dont il ne se croyait
point porteur et qui fut trouvée sur lui, permettait cependant de
déterminer sa véritable identité. Tranféré à Annemasse, il
était de là, le 21 avril, dirigé vers Dijon sous l’escorte de
deux gendarmes. Mais en gare de Lyon, mettant à profit un arrêt du
train et un moment d’inattention du seul gendarme demeuré préposé
à sa garde, il s’évadait. Parvenant à sortir de la gare, il
échappait à toutes recherches. Il demeurait à Lyon, dit-il, 5 à 6
jours. Puis gagnant Chambéry il passait deux jours chez l’ami dont
il se refuse à dévoiler le nom, prenait ensuite le train et
descendait à Evian. Rencontré par des gendarmes, le 5 mai… alors
qu’il allait dans la direction de la Suisse, il se prétendait
permissionnaire… ramené d’evian, il s’enfuyait au moment
d’entrer dans la caserne de la gendarmerie, mais poursuivi il était
peu après rattrappé dans la rue. Il déclarait alors appartenir au
8è d’Infanterie et se nommer Deligny.
Le 22 décembre
[1916], alors qu’il était incorporé au 127è d’Infanterie, il
comparaissait devant le CG de la Division pour y répondre de tois
désertions en présence de l’ennemi, commises successivement.
Condmané à 6 ans de détention… il voyait sa peine suspendue par
le Général, et était affecté au 327è le 25 décembre. Deux jours
après, le 27, apprenant que sa Cie, alors au repos à Suippes,
devait le soir même monter aux tranchées, Moronval n’hésitait
point à déserter à nouveau et allait volontairement, le 29, se
faire arrêter à Boulogne. Il attestait ainsi son intention de
forcer le commandement par des condamnations successives à lui
laisser subir, sans en suspendre l’exécution, la peine prononcée
par le CG. Traduit le 20 février devant celui-ci… il était
condamné de ce chef, à 20 ans de détention. L’exécution de
cette nouvelle peine était encore suspendue par le Général, et
Moronval se voyait affecté au 43è R.I. où il se trouve en ce
moment. »
Recours en révision
rejeté le 18 juin 1917
Moronval est fusillé
à Quaëdypres-Bergues (Nord) le 10 juillet 1917.
René Samuel
Lévy, né le 6 avril 1891 à Paris 10è, chauffeur
d’autos à Vincennes, célibataire, chasseur de 2è classe au 3è
BMILA
Lévy qui avait
obtenu le 28 janvier 1917 une permission pour Vincennes reprit bien
le train le 6 février, à l’expiration, mais il ne rejoignit pas
son unité. Son titre de transport « constellé d’un nombre
considérable de cachets signalant son passage du 8 février au 6
mars à Crépy, Villers-Cotterets, Creil, Balagny, Liancourt, Réchy,
Saint-Rémy ».
Il revint enfin à
Paris où il fut arrêté le 17 mars par la gendarmerie. Sa
disparition était due au fait qu’il était trop malheureux au
bataillon d’Afrique et aurait cherché à rejoindre son ancien
régiment, le 151è (dont il avait déserté en août 1914). C’est
par les recherches -vaines- pour retrouver son ancien corps qu’il
explique les nombreuses étapes que porte sa permission.
Lettre adressée en
mars par l’intermédiaire de commissaire de police M.Wolf,
commissariat de police du 2è arrdt à Paris :
« Je vous
en supplie Mr. Wolf, aller prévenir ma pauvre mère, qu’elle
vienne aussitôt me rejoindre avec un avocat et si possible un
médecin près de Vitry-le-François dans la Marne ; elle
demandera la Cie de discipline des bataillons d’Afrique. Mais
qu’elle fasse vite car j’ai bien peur qu’il ne soit trop tard.
« Maman !
Ma man ! Vient vite me trouver, je t’ai fait beaucoups de
peine mais ne m’en veux pas de trop je ne sais plus ce que je fait.
Tu sais bien ma petite mère que je t’aime toujours bien. Qu’est-ce
que tu veux j’avais une idée fixe je souffrais tellement au
bataillon que je voulais à tout prix rejoindre mon ancien régiment.
Ai pitié de moi et dépêche-toi de venir. Ton malheureux fils qui
t’aime de tout son cœur et qui t’embrasse bien fort. »
Ramené le 24 mars
au Bataillon et versé dans une section de discipline, il doit monter
en ligne le 5 avril pour effectuer une corvée de transfert de
torpilles en avant de Mourmelon-le-petit. Mais un tir de barrage
disperse la section. Arrivant tout de même à destination, Lévy
demande à son supérieur d’être exempté, sous prétexte qu’une
blennorragie l’empêche de marcher (à l’instruction il parlera
d’une hernie). Comme il venait de marcher 7km sans gène,
l’officier refuse. Il prend sa place dans le boyau où s’est
organisée une chaîne de transport, mais après deux heures de
travail, le boyau est bombardé, et Lévy s’enfuit. Il est arrêté
le 24 avril à Bordeaux par un gardien de la paix.
Le rapport, parcouru
de remarques ironiques et méprisantes des plus suspectes rappelle
qu’il se serait après sa désertion d’août 1914, livré au
pillage d’une maison abandonnée. Condamné à 20 ans de réclusion
pour ce fait (peine suspendue) « il manifestait sans aucun
scrupule son horreur de la bataille, n’hésitant pas pour tenter de
se procurer un emploi loin du danger à faire une demande des plus
incorrectes directement auprès du général de division ».
CG de la 45è DI.
Recours en révision rejeté le 25 mai 1917, grâce présidentielle
rejetée le 10 juillet.
Spécificité de
l’ordre de parade : ni musique ni défilé des troupes
mentionnés. En revanche : L’aumônier catholique et
l’aumônier israéliste du G.B.D. 45 se présnteront à la prison
militaire de Trigny à 3h45. Celui des deux aumîniers que désignera
le condamné l’assistera s’il le désire. »
Lévy est fusillé à
Hermonville, près la source des Coquins (51) le 13 juillet 1917, à
4h30 en présence de deux pelotons du 1er Btn d’Afrique
et un demi peloton du 1er Tirailleurs.
Paul Antoine
Estève, né le 1er janvier 1876 à Leuc (Aude),
demeurant à carcassone, sans condamnation antérieure, capitaine au
23è R.I.C.
Le 3è CG permanent
du Gouvernement militaire de Paris (5 avril 1917, frais 436,37fr.)
ordonne le huis-clos et interdit le compte-rendu de l’affaire,
(l’autorisation étant considérée comme dangereuse pour l’ordre
public). Néanmoins le rang de l’inculpé fera beaucoup parler la
presse, qui mentionnera des informations erronées quant au régiment
d’appartenance d’Estève, et même sur la date d’exécution
(1er juillet, 17 juillet). Il règne de plus une confusion
dans les débats que reflètent les minutes du jugement (le dossier
de procédure n’étant pas accessible). Entre autre qu’une
ordonnance de non-lieu du chef d’espionnage aurait été rendue le
jour même de l’ordre de mis en jugement pour tentative
d’espionnage et trahison; que le président du CG a fait verser au
dossier 12 pièces parvenues au parquet après la clôture de
l’information ; qu’il a été posé une question trop
complexe confondant les différents chef d’inculpation :
« Le capitaine
Estève est-il coupable dans les premiers jours de 1916, à Barcelone
(Espagne) entretenu des intelligences avec l’ennemi, en demandant
par lettre une entrevue au Consul général d’Allemagne, en ayant
deux entretiens au cours desquels l’inculpé a offert pour de
l’argent ses services et enfin en envoyant audit consul un projet
de contrat tendant à entrer, sous certaines conditions, au service
de l’espionnage allemand. »
Deux voix sur 7 se
sont prononcées pour l’acquittement, ce qui revient à dire qu’il
n’existe qu’une voix de majorité permettant de prononcer la
peine capitale et d’écrire que le jugement a été rendu à
l’unanimité.
Il n’acceptait de
se battre que pour les colonies et le disait à qui voulait
l’entendre. Il fut vite surveillé par le 2e Bureau. Il passa en
Espagne le 2 janvier 1917, où il eut des contacts à Barcelone avec
les Allemands ; élément romanesque, Mata-Hari lui remit 300
francs. Il fut arrêté le 4 lors de son retour en France.
Recours en révision
rejeté le 24 avril 1917, pourvoi en cassation déclaré irrecevable,
car un militaire ne peut prétendre faire casser le jugement d’un
conseil de guerre.
Au lieu du dossier
de procédure attendu, on trouve 1300 pages d’écrits divers.
Estève y parle peu de son affaire, craignant que le justice ne
saisisse tous ses documents, c’est pourtant ce qu’elle fit.
Les derniers cahiers
sont adressés à sa famille, à sa femme Louise (épousée en
prison), à ses parents à qui il demande instamment de se réunir,
de prendre soin de l’éducation de ses deux filles, l’une d’une
union au Tonkin, (cette aventure étant l’occasion d’un plaidoyer
vibrant contre le racisme) l’autre en France d’un mariage voué à
l’échec « comme tous ceux des coloniaux et des marins ».
En filigrane se lit la critique d’une justice aveugle n’instruisant
qu’à charge -aucun témoin de la défense n’a été entendu-,
lui reprochant en vrac d’avoir été un coureur de dot, d’être
atteint d’entorses suspectes, d’avoir pris position contre des
officiers supérieurs qui abusaient des indigènes sénégalais
(obligeant leurs femmes à se prostituer pour survivre), presque
d’être la cause du naufrage du navire qui le ramenait du Maroc. Il
insiste sur le fait qu’il a dû entretenir toute sa vie durant ses
parents, paysans étranglés d’impôts, et courir après les prêts
sur sa maigre solde ; que c’est cette situation d’indigence
-organisée par l’État- qui l’a poussé à tenter d’escroquer
les Allemands : « Et, dans mon cœur, je suis innocent ».
« A-t-on considéré un seul instant toute ma vie passée, les
Services rendus ? Si on l’a fait, c’est dans l’esprit d’y
voir des fautes et de me les reprocher… Et avec ces hommes de
justice, la seule apparence est un crime, l’intention supposée
entraîne condamnation. J’ai fait une tentative désespérée
d’obtenir une somme d’argent. Mais je n’ai rien fourni. C’était
une tentative d’escroquerie à l’égard d’étrangers et rien de
plus… Nous avons marché sur les genoux notre vie durant dans les
ronces et les épines, sur les cailloux. J’ai voulu terminer cette
misère et ce calvaire avant de disparaître au front… J’avais
des papiers, des publications qui ont été l’occupation de toute
mon existence ; je voulais que tout cela ne disparut point. Je
voulais l’éditer et il fallait de l’argent. Alors dans la simple
supposition que j’aurais bien pu avoir l’intention de trahir,
j’ai été condamné. Si j’avais voulu trahir, j’aurais pu le
faire… Où est la preuve que je voulais déserter ? Et même
si j’avais déserté où est la preuve que j’allais me mettre au
service d’étrangers ?.. Que la vie est cruelle. On m’a
traité comme un turc ou un grec. »
« J’oubliais :
Que mon frère jamais au grand jamais, ne se lie à aucune fonction
d’état, il vaut mieux aller à la besace . Croyez-le !
De même ma fille… pas de fonction d’état, qu’elle garde sa
liberté et ne se marie jamais à quelqu’un lié à une fonction
d’état. Un laboureur, un épicier, cela vaut mieux…
En effet, l’écrivain
reprend la main et Estève dépassant le cadre de la lettre, s’élève
à des considérations plus générales, parfois surprenantes :
« Aujourd’hui la civilisation, les chemins de fer, les
progrès et beaucoup de belles choses ont introduit dans le monde la
souffrance et le malheur. Ah ! Les monarques, les princes
conquérants et ceux qui les soutiennent, quel Océan de malheur ils
ont déversé sur le monde. Démence de l’orgueil et de la folie…
La vie est tellement effroyable et inhumaine, qu’il y a eu en
Russie, des gens qui l’ont bien compris ; ce sont les Skopsky.
Ils se condamnent à ne pas avoir d’enfants. On les a persécutés…
Ils forment une religion à part. »
Au milieu de
fragments de journaux se glissent des brouillons de lettre de grâce
et des fragments de réquisitoire contre les différentes autorités :
« Réflexion
sur l’examen médical : La science médicale autrefois n’était
pas moins fière que celle de nos jours et se donnait pour tout aussi
sûre. Dans les procès de sorcellerie, elle reconnaissait la marque
d’un diable en enfonçant des épingles dans la peau des patients
et envoyait ces malheureux à la mort. Aujourd’hui, avec d’autres
procédés, le résultat est le même, j’en suis certain. (…)
Des 3 docteurs qui
m’ont examiné, il y avait un descendant de russe ou de polonais,
et un gentilhomme : deux hommes de passion. Ils sortaient du
cabinet du rapporteur et allaient voir « un homme pari de rien,
sans instruction » comme s’exprime l’accusation et puis qui
pêche aussi sur la question « religion » Homme de
passion, dis-je, parce que tout de satisfaction quand je déclarai
n’être pas fou, et sur la question « épilepsie »
n’avoir eu que deux crises. Hommes de passion car, ayant dû faire
une constatation d’ordre anatomique, je les vis se parler vivement
et puis s’adressant à moi : « Vous avez été
circoncis ! » Non, répondis-je je suis catholique de
naissance. Ils croyaient tenir un juif. C’eut été encore plus
beau. Voilà bien les questions de pathologie mentale :
Etes-vous circoncis ? Et quelle joie chez le docteur R. agitant
son éprouvette en criant : « Nihil ! Nihil ! »
Certains
développement des cahiers rédigés à Dinard (ces papiers qu’il
voulait publier et qui n’ont donc pas été rendus aux Estève,
jugés peut-être trop dangereux) sont étonnamment pertinents :
Page 1000 :
« Les hommes s’obstinent aux fouilles de Khamissa et au
classement de vieux papyrus au lieu de préparer l’avenir. Rien
n’annonce une organisation future de la Paix universelle. Aucun
indice, aucun symptôme, nul rayon de lumière ne montre qu’une
aube nouvelle se lèvera un jour sur le monde. Aucune voix claire,
décidée, puissante, n’a retenti au soir des domination témoignant
que la Paix universelle soit une préoccupation d’État. Les
sérénissimes pasteurs des peuples ronronnent et sommeillent tandis
que « le temps travaille pour eux » -oui, le temps
travaille pour eux, pourquoi travailleraient-ils eux-mêmes ?
Nous ne voyons rien venir et cependant les discours politiques ne
nous manquent pas, et ils ne changent pas. « Nous irons
jusqu’au bout ; il faut détruire le militarisme allemand ;
nous combattons pour le Droit et la Liberté » Mots sonores,
balançoires… est-il bien vrai qu’une fois le militarisme
allemand détruit le Droit et la Liberté règneront sur la terre ?
Voire. Régnaient-ils avant l’avènement du militarisme prussien ?
L’Europe était-elle en état d’équilibre stable, un champ
élyséen ou un champ de carnage. Cuba, Fachoda, la guerre
anglo-boer, la guerre russo-japonaise nous répondent. Je ne vois pas
ici la main de Guillaume. (…) L’Allemagne sera battue, c’est là
sa fin inévitable, sa défaite est aussi mathématiquement prévue
que le sont les éclipses. Les augures officiels le disent et les
augures officiels de se trompent pas. L’Allemagne sera battue, mais
alors il est absolument indispensable d’avoir un projet
d’organisation de ce pays nous débarrassant du militarisme
prussien. Vous qui discourez tant, y avez-vous seulement pensé ?
S’il survit à la guerre, la guerre n’est pas près de mourir.
Nous en restons au droit du loup. « Nous combattons pour de
Droit et la Liberté » M. Poincaré, M. Briand, M. Loubat
combattent pour le Droit et la Liberté. Quel droit ? Nous n’en
avons vu d’autre que le droit du plus fort ? Quelle liberté ?
En réalité, un dur esclavage sous la fiction de la souveraineté
nationale. Le droit avant 1870, avant le triomphe du Kaiserisme,
n’était-ce pas le droit du loup, le droit des bêtes des forêts ?
Alors que l’Allemagne soit vaincue ou non n’est-ce pas ce
droit-là qui continuera à régir les peuples… On nous fait
espérer, sans que le moindre indice le révèle, qu’au prochain
combat de bêtes féroces, -vers 1950 par exemple- le tigre germain
ne sera pas en état de paraître dans l’arène. Mais qu’importe
s’il doit y avoir d’autres tigres, et si le peuple de France se
voit encore obligé d’abandonner la pioche et le marteau pour
ramasser encore une fois le sabre d’esclave du gladiateur?(…)
L’anti-cannibalisme progresse, mais il ne pourra voir son triomphe
que par la disparition totale des cannibales. » Remplacez
cannibalisme par capitalisme, tout est dit. C’est tout un livre
qu’il faudrait consacrer à Paul Estève, mais on fera court :
Passant sur le front
des troupes, Estève, contrairement à ce qu’on a pu lire quelques
lignes plus haut, s’écria: « Vous serez vaincus par les Allemands
et ce sera bien fait ! A bas Poincaré ! Je suis une victime du
parti-prêtre!»
Quatre photos tout à
fait exceptionnelles par leur rareté, demeurent de l’exécution
d’Estève à Vincennes le 13 juillet 1917, à 5h03 selon le PV.


Antoine Joseph Buccala, né le 9
octobre 1881 à Bastia (Corse), collectionne déjà trois
condamnations pour vol et violence entre 1898 et 1900. C'est en
raison de ces antécédents judiciaires qu’il est incorporé au 3è
BMILA, avec lequel il sert un an en Tunisie. Passé au 122è puis
163è R.I., il est libéré de ses obligations militaires le 23
septembre 1905 avec un certificat de bonne conduite. Rendu à la vie
civile, il est à nouveau condamné par trois fois pour vol ou
violences en 1909, 1911 et 1913.
Rappelé sous les drapeaux il commence
la campagne contre l'Allemagne avec le 15è groupe spécial avant de
se retrouver à combattre avec le 40è R.I. au secteur du Mort-Homme
devant Verdun. Promu caporal le 19 août 1915, Buccala passe
successivement au 113è RIT, 114è RIT et 213è R.I. Mais dans la
nuit du 15 juillet 1917, il est abattu alors qu'il tente de
s'introduire dans le camp militaire Saint-Charles à Marseille
"pour y commettre des vols".
Albert Eugène
Chicheriez, né le 23 août 1893 à Saint-Pierre le Fort
(Guernesey), demeurant à Paris, mécanicien, engagé volontaire pour
5 ans, 2è classe au 53è R.I.C. (section disciplinaire), ni pièces
matriculaires, ni punitions notées, mais 1904, vols (confié jusqu’à
sa majorité à l’union française pour le sauvetage de l’enfance),
1912 bris de clôture, désertion avec emport d’effets, février
1916 outrages envers un homme de garde, septembre 1916 outrage envers
un supérieur, 13 novembre déserteur
CG de la 10è DIC (13 juin 1917) : « La section de
discipline de la 10è DIC à laquelle était affecté le soldat
Chicheriez, à la suite d’une condamnation en conseil de guerre,
venait d’arriver à Magneux-les-Fismes, le 5 avril 1917, venant des
tranchées de premières lignes. Des ordres, parvenus dans la
journée, lui prescrivaient de remonter immédiatement en ligne. Dans
la journée du 6 avril, Chicheriez réussissant à tromper le service
de garde, s’échappa avec plusieurs disciplinaires, du local où
ils étaient enfermés. Le 27 avril, il fut arrêté, muni d’une
fausse permission, par la police de Lyon.(…) Chicheriez est un très
mauvais soldat, mais c’est encore un malfaiteur dangereux,
véritable meneur, semant autour de lui, par ses exemples et ses
excitations, l’indiscipline, il a toujours, pour les dernières
actions criminelles dont il s’est rendu coupable, entraîné
d’autres camarades avec lui. »
Jean Saint-Etienne capitaine au 33è R.I. : « C’est le
soir-meêm, vers 18h et demi qu’a été constatée l’absence de
Chicheriez et de quatre autres disciplinaires. Ils ont évidemment
passé par l’échelle donnant accès à leur grenier, car une
visite du bâtiment ayant été faite aussitôt, nous avons pu
remarquer qu’il n’existait pas d’autre ouverture. Après de
cette échelle était une sentinelle, le soldat Sylvestre, de mon
escouade, qui a prétendu n’avoir vu passer personne. Nous avons su
depuis que cet homme avait été en prévention de CG en même temps
que Chicheriez. »
Recours
en révision rejeté le 19 juin 1917. Pas
de PV d’exécution, Chicheriez est fusillé aux Carrières
de Venel (Neuf Maisons, selon la fiche de décès) le 17 juillet à
6h.
Fernand Charles
Bulmé, né le 16 avril 1874 à Boulogne-Billancourt,
chemisier à Mexico, marié (Mexique), 20è section de secrétaires
d’état-major détaché à la Pharmacie Centrale
3è CG de Paris :
inculpé avec Sideney Antoine dit Athos, Bulmé Paul Lucien (frère
du précédent, 35è Rgt Territorial d’Infanterie, blessé par
éclats d’obus en mars 1916), Oudry Marie Honorine, Veuve Bulmé (1 an, sursis),
Roquebert Raoul (contumace) et Cholet Louis (acquitté),
d’intelligence avec l’ennemi et association de malfaiteurs (et
pour Fernand Charles, vols militaires, falsification de passeports).
Antoine Sideney, dit Athos, né
le 20 décembre 1864 à Ygorney, professeur d’éducation physique à
Paris, célibataire, soldat au 46è RI., déserteur
Athos est arrêté
le 12 septembre 1916 en pleine nuit sur un petit chemin de
contrebandier au moment où il va atteindre la frontière espagnole.
Conduit à la marie de Banyuls il présente un passeport falsifié
par grattage au nom de « Sadilett ». Il avoue qu’il se
disposait à se rendre à Barcelone pour recueillir des informations
relatives à la destruction d’usines de munitions en France. Il
explique qu’il était entré en relation avec Roquebert en juillet
1916 à Barcelone et d’un agent allemand du nom d’Otto Schultz.
Lui-même est connu de l’espionnage allemand sous le pseudonyme de
Dumas, alors que son correspondant, Raoul signe Alexandre.. En plus
de renseignements militaires qu’il doit communiquer avec chiffrage,
Roquebert lui suggère, en tant que sujet français, de se faire
engager dans une usine de munitions et d’y commettre un attentat.
Il touche une avance de 180 frs. Grâce à Bulmé, il peut réunir
des renseignements sur les envois pharmaceutiques. Le 14 août il
écrit à Raoul (Roquebert) : « je crois devoir vous
affirmer et d’une source très sûre que la Roumanie ne tardera pas
à entrer en guerre aux côtés des alliés. La raison, il part tous
les jours de Paris des quantités énormes de munitions ainsi que des
médicaments de la Pharmacie Centrale pour Bucarest ; de même
on a demandé des interprètes dont deux sont déjà partis pour la
même ville. » Ce n’était sans doute pas une grande
nouvelle, mais Sydeney aurait écrit plus de quarante lettres de
renseignements, certains fournis encore par Bulmé qui les tirait de
sa belle-sœur Berthelot mariée à un conducteur de chemin de fer.
n’ayant reçu que 100 pesetas pour ses services, Sydeney imagine
avec la complicité de Fernand Bulmé d’incendier la pharmacie
centrale des invalides et demande 150 000 francs à Raoul (lettre
qu’il aurait rédigée sous la dictée de Bulmé selon Sydeney, le
premier dément), qui répond que c’est trop, mais « qu’on
s’arrangerait ».
Le marché paraît
conclu pour 120 000, puisque Sydeney reçut fin août une coupure de
lettre saisie sur lui lors de son arrestation qui mentionnait (en code) « Venez
chercher cartouches dynamite », ce qu’il tenta de faire le
12 septembre : il semble que dans leur code Bulmé et Athos
aient parlé, en présence de relations féminines, à propos de ce
projet d’une affaire de « viande réfrigérée » qui
devait les rendre riches. Bulmé demanda alors à Sydeney de prendre
au passage à Perpignan son frère Paul pour lui faciliter le passage
en Espagne. Bulmé, après son arrestation et la perquisition qui
révèle la présence dans son appartement de 300 thermomètres
volés, explique que leur revente étaient destinée à financer la
désertion de son frère. Dans le même temps, Fernand Bulmé tente
de se faire verser un acompte en sollicitant directement Roquebert
mais il n’eut pas de réponse. « Si j’avais touché les 20
pour cent j’aurais partagé avec mon frère paul que j’avais mis
au courant de la situation ». C’est lui encore qui a falsifié
le passeport de Sideney. « A partir de ce moment [quand il se
chargea de placer les thermomètres] je suis devenu la chose de
Sideney. »
« L’instruction
établira si la rencontre de ces trois individus fut accidentelle, ou
si, au contraire, ils n’ont pas quitté le Mexique où ils
habitaient tous depuis de longues années avec des intentions
coupables. »
Paul Bulmé est
condamné à 15 ans de Travaux forcés.
Recours en révision
rejeté le 1er mai 1917 (frais 981,45 frs)
Fernand
Bulmé et Antoine Sideney sont exécutés à Vincennes le 24 juillet
1917 à 5h15
Août
Bastien Nicolas
César Frencia, né le 12 janvier 1886 à Philippeville
(dept de Constantine), boulanger à Casablanca, 2è classe au
Bataillon territorial de Chaouia, condamné plusieurs fois pour vol,
mendicité, coups et blessures volontaires
« Faux,
sournois, maniant le mensonge avec une audace cynique… c’est le
type parfait de l’individu louche, capable des pires besognes ».
(Sous-lieutenant Canal)
Le 12 mars 1917, à
El Boroudj, alors qu’il sort des cabinets où il avait l’habitude
de ses rendre à l’extinction des feux, l’adjudant Binder [Adrien
Charles Léopold Gérard] est assailli par derrière de plusieurs
coups de couteau « saisi non pas à la gorge, mais par le haut
de la veste, celle-ci tirée si violemment que les deux premiers
boutons mobiles ont été arrachés en passant, en la déchirant, à
travers la boutonnière ». « Les nombreuses blessures,
surtout la plaie de la face dont les bords sont déchiquetés,
montrent avec quelle violence et quel acharnement il a été frappé »
(docteur Pauty). L’agresseur s’enfuit mais des taches de sang sur
sa literie et son jersey dénoncent Frencia. Celui-ci donne comme
premier mobile de son acte qu’il a été victime « des
agissements injurieux et des vexations de l’adjudant à son égard,
indigné au surplus des propositions obcènes que lui auraient faites
(sic) celui-ci ». mais lors de son interrogatoire du 14 mars,
Frencia a d’abord déclaré : « Je voulais lui voler son
argent, et comme il se débattait, je l’ai frappé de mon couteau.
Depuis une semaine, sachant qu’il avait son argent sur lui dans un
porte monnaie tenu par u n lacet au cou, je voulais lui couper le
lacet pour le lui dérober. » Et il explique comment, chaussé
d’espadrilles, il a été guetter l’adjudant en se mettant dans
le premier cabinet, tandis que l’adjudant était dans le second.
Elément qui confirmerait la préméditation et le guet-apens,
Frencia a été vu « aiguisant son couteau à la meule de grès
de l’atelier ».
D : - Comment
avez-vous appris que l’adjudant Binder avait son argent au cou ?
(Binder dit que tout le monde le savait mais tous des soldats
interrogés, sauf un- répondent « J’ignorais ce détail »)
R : - Il y a
environ un mois en passant devant sa chambre, j’ai vu l’adjudant
en train de se changer et en même temps, j’ai remarqué ce qu’il
portait au cou.
Les témoignages
recueillis auprès des autres soldats du bataillon montrent que
Frencia avait certes un grand besoin d’argent, lavant les effets de
ses camarades et prenant des tours de garde à leur place -certains
le décrivent d’ailleurs comme serviable et agréable- « mais
moyennant être rétribué » . Il aurait dépensé
beaucoup en boisson et avec des prostituées, mais qu’il payait peu
de son propre aveu et selon ses plus proches camarades. Il prétendait
user d’une prochaine permission pour aller toucher un héritage en
Italie.
Frencia :
« Toutes les corvées me tombaient dessus au point que j’en
pleurais. Il allait jusqu’à m’insulter… à me traiter de
« Sale race » faisant sans doute allusion à ma
nationalité italienne… Je tiens à ajouter qu’il ne supportait
pas qu’on dise du mal de la nationalité Boche ».
« Depuis
plusieurs jours j’avais combiné mon coup pour le tuer ; parce
que je voulais tuer un boche et parce que à chaque fois que je me
rendais aux cabinets, il me suivait,pour me faire des propositions.
Plutôt que d’être commandé par un abruti pareil vaut mieux
mourir !.. Je sais que je vais chercher 12 balles mais ça m’est
égal.(…) Nous sommes en effet entrés ensemble aux cabinets, il
m’a bousculé sans me parler. L’adjudant Binder ne m’a pas
reconnu parce qu’il était saoul ; je déclare en outre que
l’adjudant ne m’a jamais fait de propositions pour m’enculer,
mais seulement il m’ennuyait, c’est pourquoi j’ai voulu le
tuer, parce que j’étais poussé à bout et que c’était un être
nuisible sur Terre.
D : - Si vos
coups avaient porté, vous auriez fait un cadavre ?
R : - La France
aurait gagné une retraite.
Binder : « Je
l’ai puni deux fois seulement. C’était un antimilitariste avéré
mais je ne lui ai jamais fait plus d’observations qu’aux
autres. » A la question « avez-vous parfois fait des
propositions contre nature à cet homme ? » Binder s’écrie
« Ah non ! Ce n’est pas dans mes habitudes, d’ailleurs
Frencia n’a rien d’un giron. »
Malgré les
dénégations obstinées de tous concernant les questions de mœurs,
ou les divers trafics, les choses sont-elles aussi transparentes ?
Une lettre énigmatique du soldat G. Lacaisse est trouvée dans la
malle de Frencia (qui contient également 20 cartouches
surnuméraires) :
« Casablanca
le 12 mars 1917, Mon cher Frencia, J’ai bien reçu ta lettre du 8
que je vais essayer de communiquer à E. [Etienne Rivière,
actuellement en prévention de CG] Tu lui a écris une lettre il y a
quelques jours dans laquelle tu luis disais que « Julot [Jules
Danton Joliat] et moi étions en permission à Casa ». Cette
lettre n’est pas parvenue à E. J’en ai eu connaissance, je ne
puis te dire par qui ici mais je te donnerai plus de détail de vive
voix. Depuis, je dois faire attention pour causer de temps en temps
avec E. Evite donc de donner des noms quand tu lui écriras. Cela
peut lui nuire et à moi aussi… Je suis toujours au D.I.M. je ne
dois retourner à l’hôpital que le 15 avril j’ai peur d’aller
passer quelques jours soit à El-Boroudj, soit à Settat… J’ai vu
Casanova il y a quelques jours, il m’a dit qu’il n’y avait rien
à faire pour toi. On nous a lu au rapport de la Place d’ici 8
jours de tôlt pour Julot. Il n’a vraiment pas de veine ; s’il
est arrivé, souhaites-lui le bonjour… Rien de nouveau ici. Je
regrette que Aubry et Ozed ne soient pas convaincus, mais c’est
cependant la vérité ; pourquoi leur aurais-je pris ce qu’ils
disent alors qu’il est si facile d’être servi au D.I.M. et neuf.
Quand je pourrais avoir ce que tu m’as demandé, ce qui est
probable, je te le ferai parvenir, mais pas par la poste par un type
qui ira là-bas mais ne dis rien. » [Frencia prétend ignorer
totalement de quoi il s’agit.]
D :- Vous vous
êtes vanté à plusieurs reprises devant vos camarades, d’avoir
commis des actes de pédérastie sur votre camarade Lacaisse.
R : - Ce sont
des mensonges. (…)
1er CG
permanent des troupes d’occupation du Maroc occidental
Recours en révision
rejeté le 20 juin 1917, grâce rejetée le 31 juillet
Frencia est fusillé
au lieu dit El Hank près de Casablanca (Maroc) le 2 août 1917 à
six heures.
Sylvain Jules
Lacherade, né le 19 octobre 1888 à
Saint-Léger-le-Guérétois (Creuse), cultivateur à Guéret,
célibataire, 2è classe au 5è BMILA, six condamnations antérieures.
CG du détachement
du Sud tunisien (Minutes uniquement) 22 mai 1917. Jugé avec Lucien
Marius Fabre (condamné à mort par contumace pour le même crime aux
même lieu et date), cocher à Brignolles, célibataire.
Le soldat Lachérade
est-il coupable, d’avoir, sur territoire en état de siège, le 12
décembre 1916, à Déhirat, abandonné son poste, étant de garde ?
Cet abandon a-t-il été commis en présence de rebelles armés.
Recours en révision
rejeté le 1er juin 1917
Lachérade est
fusillé au Champ de manœuvres de Médenine (Tunisie) le 3 août
1917 à 6h.
Auguste Eugène
Chemardin, né le 25 février 1884 à Paris 20è,
cordonnier puis polisseur sur métaux, célibataire, soldat au Régt
d’Inf Colonial du Maroc, plusieurs condamnations civiles, outrages
à supérieur et désertion. Le relevé de punition interminable
semble suggérer que Chemardin accumulait toutes les insolences
possibles pour se faire punir, semant la zizanie parmi les autre
punis, se présentant régulièrement à la visite pour tenter de se
faire exempter (ayant même emmené à l’occasion 34 de ses
camarades à se présenter à la visite), et animé d’un inlassable
esprit de contradiction, mettait la plus mauvaise volonté à
exécuter les taches prescrites.
Chemardin a de plus
la tête de l’emploi, ou plutôt le corps, susceptible
d’impressionner par sa taille 1,72m. Tatouages : poitrine ;
une tête représentant la lune coiffée d’un chapeau, une tête
d’arabe, une tête de femme. Dos ; une cavalier représentant
Napoléon Ier, une tête de juif, une mouquère portant une
gargoulette, trois têtes de femmes, six groupes hommes et femmes
dans des positions obscènes, une petite envie couleur café au lait.
Epaule gauche ; un couple dans une position obscène, une
rosace, le mot « militaire » en grosses lettres, Tête de
clown, une pensée (A.P. L.V.), une grosse tête d’homme, 1 tête
de femme (nombreux autres tatouages divers) Avant-bras gauche ;
cinq clowns, un mousquetaire, un collégien. Epaule droite ;
nombreux tatouages, une femme à cheval sur un porc, cinq têtes
d’hommes, la lune qui décroit, à la base un mandoliniste.
Avant-bra droit : un gros bouquet de roses. Côtes, au-dessous
du sein gauche. Cinq têtes de femmes accolées. Cicatrices de
coupure à l’aine droite et sue la cuisse gauche près du genou.
Les lettres L.G. au mollet gauche.
Condamné le 24
juillet 1916 par le 2è CG de Paris pour désertion à l’intérieur,
Chemardin est affecté après suspension de peine au RICM, qu’il
rejoint le 5 août dans la Meuse. Deux jours plus tard dans la nuit
du 7 au 8 août, il quitte sa Cie à Contrisson, alors qu’elle va
remonter en ligne. Des officiers témoignent l’avoir entendu dire
devant ses camarades « Je ne monterai pas au rifle, il faudra
que je me débine avant » et « j’ai déposé une
permission pour aller voir mon frère mais je partirai même si cete
permission ne m’est pas accordée ». Il est arrêté à Paris
dans la nuit du 8 au 9 août, sur la réquisition de deux jeunes
filles sur la personne desquelles il se serait livré à des
violences et à un attentat à la pudeur. Chemardin accuse le
camarade qui l’avait emmené boire d’avoir giflé les deux filles
et ajoute « Qu’est-ce que je risque ? Je reournerai
là-bas ! ». Attendu qu’ils ont été commis pendant une
désertion, ces faits ne relèvent pas de la compétence du conseil
de guerre.
Pendant
l’instruction de cette première affaire, Chemardin est évacué
par le médecin chef de la divison (bronchite chronique et
antéricolite, suspiscion de tuberculose et dysentrie), au début
mars 1917 sur l’ambulance de Chateau-Thierry. A peine arrivé à
cet hôpital, Chemardin s’évade dans la nuit du 9 au 10 mars et se
rend de nouveau à Paris. Il y est arrêté le 29 mars porteur d’un
couteau à cran d’arrêt, deux étoupilles chargée servant au tir
des canons, d’un sachet de cyanure de potassium et d’une
attestation de levée d’écrou d’un certain Besse, relâché le 8
mars 1916. « Il prétend comme toujours être parti de
l’hôpital de Chateau-Thierry parce qu’il était malade et qu’on
ne le soignait pas » Il est ramené au début d’avril à la
prévôté de la 38è DI. La division se dirige alors vers le front
de l’Aisne pour prendre part à l’offensive du 16 avril, qui va
durer plus d’un mois. Sur décision du générfal, Chemardin est
ramené à sa compagnie, alors en ligne, le 24 avril 1917, sur le
font du Chemin des Dames. Il y reste deux jours. Dans la nuit du 26
au 27 avril, sa Cie est relevée des premières lignes et descend aux
Creutes (grottes) de la Somme [carrière souterraine de Cuissy ou
Vassogne?] où elle demeure en réserve et en état d’alerte.
Chemardin s’évade des Creutes de la Somme dans la matinée du 27
avril. Il se rend toujours à Paris, est arrêté le 2 mai à
Suresnes chez un nommé Annoni à qui il était venu demander du
travail, porteur d’un brassard d’ouvrier mobilisé d’usine et
d’un livret militaire falsifié, au nom de Latournerie Louis,
réformé, objets qu’il prétend avoir trouvé dans la rue.
Giovanni Annoni et son fils Bruno étaient surveillés par la police,
soupçonnés d’être en relation avec un cambrioleur auteur de vols
qualifiés au préjudice d’industriels de Puteau. C’est ce
personnage, Louis Girardon, (alias Mourot) connu sous le pseudonyme
de « Gédé » qui, rencontré à la prison du
Cherche-Midi lors de son escapade du 29 mars, lui aurait donné
l’adresse d’Annoni, tout en lui faisant part de son intention de
déserter.
Chemardin qui se dit
irresponsable demande à subir un examen mental (il écrit même
directement au général de division pour l’obtenir), qui lui est
refusé, un précédent expert ayant conclu à Paris qu’il simulait
et était pleinement responsable de ses actes.
Appréciation du
sous-Lt Verlaque (septembre 1916) : « L’impression
produite par Chemardin pendant son court passage à l’unité fut
mauvaise ; cet homme se vantait de ses condamnations et
punitions comme de fait d’armes. » Eh oui ! Chacun sa
guerre !
Appréciation du
commandant de section, Lt Mazeau : « n’a été qu’un
embarras pendant les deux jours qu’il a resté à la Cie. »
chef de bataillon : « Vieux cheval de retour qui se joue
de la discipline et de la justice, ment avec virtuosité et qui,
circonstance plus grave, fait du prosélytisme. Sujet extrêmement
dangereux pour la troupe qu’il cherche à contaminer et dans
laquelle il ne doit plus reparaître. »
CG de la 38è DI
Recours en révision
rejeté le 12 juin 1917. Recours en grâce rejeté le 12 juin 1917
Candor (Oise) le 4
août 1917
Romain Burgan (Gers), suicidé
Né le 31 août 1884 à Moncassin,
Romain Burgan est boulanger en 1914. Mobilisé dès les premiers
jours de la guerre, il est blessé le 8 septembre 1914. Le 8 août
1915, il passe au 14e Bataillon de Chasseurs à pied où il est
décoré de la Croix de guerre et deux étoiles de bronze et cité
deux fois à l’ordre du bataillon pour s’être "particulièrement
distingué au cours de l’assaut du 1er septembre" en montrant
"le plus bel exemple à ses camarades". La seconde citation
salue "son courage dans tous les combats auxquels il a pris part
et particulièrement le 20 juillet 1916". Ce soldat gersois
aurait mis fin à ses jours le 12 août 1917 dans la Meuse.
Les "suicidés" représentent
entre 3828 et 5000 hommes (soit 4,2 % des 93325 soldats inscrits dans
le fichier des Non Morts pour la France) soit 90 par mois et 1080 par
an. Ces chiffres ne prennent pas en compte ceux qui s’exposent
volontairement à la mort en abandonnant toutes les précautions
élémentaires à la survie au combat.
La constitution d’un gigantesque
fichier fut entreprise à partir de 1920 par le ministère des
pensions. Il devait conduire à la réalisation d’un « Livre d’Or
» qui ne vit jamais le jour faute de crédits et à cause du second
conflit mondial. Il reste de ce travail considérable deux fichiers.
L’un contient 1 325 291 fiches de militaires "morts pour la
France" L’autre comporte 93 325 fiches : 62 867 fiches vertes
de combattant qui n’ont pas eu droit à la mention "Mort pour
la France" et 30 458 cas "non statués". Conformément
à la loi, ces fichiers couvrent la période qui va du 2 août 1914
au 24 octobre 1919. Les soldats inscrits dans ce fichiers sont
considérés comme "non morts pour la France": fusillés,
morts de maladie non contractée en service, victimes d'accident, de
rixes, suicidés sont également mentionnés dans ce fichier.
A
tout hasard toutes les dispositions ont été prises afin d’interdire
aux officiers d’État civil, d’inscrire sur leurs registres les
décès résultant de « mort violente ». Non seulement la
justice militaire est ainsi protégée (elle rechigne vingt ans après
la fin du conflit à avouer ses crimes et ne cesse d’en minimiser
l’étendue, rejetant quasiment tous les procès en révision quand
le pourvoi est susceptible d’être introduit par des membres
survivants de la famille) mais aussi la justice expéditive,
maquillant certains meurtres en « suicide », préféré à
la mention « tué à l’ennemi » qui pouvait ouvrir
droit à pensions et dédommagements.
Charles Eugène James,
né le 26 août 1895 à Essonnes, lamineur à Levallois-Perret,
célibataire; grenadier de 2è classe au 403è R.I. Jamais condamné
au civil.
Relevé de punition peu
important, mais peut être significatif ce motif du 18 février
1916 : « Pendant la marche de nuit ayant reçu plusieurs
fois l’ordre de se taire, a continué à prononcer, à très haute
voix, des paroles déplacées qui ont causé pendant un certain temps
du désordre dans la section.
D : - A la date du 11 mai
1917, le 1er Bataillon du 403è R.I. cantonné à
Champfleury est remonté aux tranchées. Pendant le trajet vous vous
êtes esquivé de votre section. Vous vous êtes présenté le 20 mai
au Commissariat de Police du quartier des Enfant-Rouges à Paris et
vous avez été ramené au corps par la gendarmerie le 25 mai vers
14h ?
R : - … Je demande à
réparer ma faute et à partir pour Salonique où je pourrai me
soustraire plus facilement à l’attrait des permissions.
Léon Lasalle, sergent-major
au 403è : « Le soldat James, manquant à l’appel du 11
mars 1917, a été ramené au TC du 403è R.I. le 25 mai 1917 vers 14
heures. Pendant que je touchais le ravitaillement de la Cie James
profitait de cette absence pour s’esquiver. Il n’a reparu que le
7 juin 1917 sous escorte de la gendarmerie. »
James s’est volontairement
rendu à la gendarmerie de Noisy-le-sec, le 6 juin, après une
absence de 12 jours.
CG de la 151è DI. (3 juillet
1917)
James : « J’ai
quitté la Cie par cafard ; je n’avais pas la frousse. Puis
j’étais découragé. Mon capitaine m’avait puni deux fois pour
avoir tiré dans la direction des lignes allemandes. Je trouvais que
c’était injuste. D’ailleurs, depuis que je suis à la 1ère Cie,
je suis continuellement puni, à la 4è, je ne l’étais jamais. »
Recours en révision rejeté
le 10 juillet 1917 : recours en grâce rejeté le 11 août.
Notes de service ; « Pour
éviter toute divulgation de la cérémonie d’exécution du soldat
James, les lieu et heure d’exécution seront tenus secrets et
l’ordre de mise en mouvement de la troupe sera donné par
alerte...lieu de l’exécution, Champ de blé fauché, (les épis
réunis en meules) sur le chemin à un trait allant fr Courville aux
Petites Chezelles (Ferme), 400m à l’ouest de Courville. »
Y avait-il quelque agitation à
redouter ?
James est fusillé le 13 août
1917 à 6h.
André René Ozouf, né le 5 septembre 1896 à Saint-Hélier (Île de Jersey, Royaume-Uni), mort le 19 août 1917 à Aïn-Leuh (...), "tué par un indigène en rébellion", Soldat de 2e classe, 2e Bataillon d’infanterie légère d’Afrique, Matricule n° 5.400, classe 1916, n° 1.406 au recrutement de Cherboug [Acte transcrit à Cherbourg (Manche), le 2 janv. 1918].
Jules
Frédéric Poignant, né le 10 juin 1872 à Oëlleville
(Vosges), cultivateur à Charmes, veuf, 2è classe au 43è RIT
Condamné dès avant
la guerre pour insoumission, Poignant n’a pas rejoint son corps à
la mobilisation. Arrêté le 8 mars 1915, il est à nouveau jugé par
un CG en juillet et août 1916 pour abandon de poste et désertion à
l’intérieur, peine suspendue, CG de la 12è DI :
Le 4 juillet 1917,
le soldat Poignant, qui avait été maintenu en ligne , bien qu’il
fût en prévention de CG, faisait partie de la section de réserve
du point d’appui 651. Depuis le matin, il avait été occupé avec
quatre de ses camarades à préparer, sous la surveillance du caporal
Garnier, des bobines de fil de fer, en vue de poser pendant la nuit
des réseaux le long des premières lignes françaises. Le travail
est interrompu par la pluie et les hommes regagnent leur gourbi vers
quinze heures. Un peu plus tard dans l’après-midi, des guetteurs
du 43è R.I. aperçoivent un soldat français qui au-delà du réseau,
erre le long des tranchées allemandes. Ils menacent de tirer,
l’homme gesticule, se dissimule à la lisière d’un bois. Une
patrouille est lancée pour aller le chercher. Le soldat Bonnin
témoigne : «Un peu avant que je n’atteigne Poignat, une
grenade éclata entre les réseaux. A ce momnet là, le lieutenant
Pfliger tira avec un fusil mitrailleur. J’entendis également les
boches qui ciraient : « Kommt ». Juste avant d’être
saisi par les hommes du 43è, ceux-ci voient Poignant jeter une
paquet dans la tranchée allemande. Ils réussissent à le ramener
dans les lignes françaises en le bousculant. Après avoir été
appréhendé il maugrée : « Je sais bien ce que cela va
me coûter », puis se mure dans le silence. Il donne ensuite
pour excuse qu’il ne souvient de rien, étant sous l’influence de
la boisson. « Poignant avait l’air de ne pas être tout à
fait de sang froid ; il chantait près des réseaux boches. »
(Bonnin) Personne ne parvient à lui faire dire ce qu’il a jeté
dans la tranchée allemande.
Cherchant à établir
la préméditation, le rapporteur rappelle que le caporal Garnier a
affirmé que quelques jours avant sa fuite, Poignant, apprenant qu’il
avait été retiré de la corvée de soupe déclarait : « Ils
ne veulent plus que j’aille à la soupe, ils ont probablement peur
que je me sauve, mais si je voulais m’en aller, j’aurais bien
d’autres moyens de le faire ». Quelques instants avant de
s’en aller, Poignant a dit au sergent André : « J‘ai
peur de mourir ce soir » et il a pris soin de s’élancer
dans le réseau de fils de fer français sans arme ni équipement,
autre qu’une canne qu’il s’était taillée le matin-même.
Pourvoi en révision
rejeté le 26 juillet 1917
Poignant est exécuté
à Marzelay, commune de Saint-Dié-Des-Vosges le 20 août 1917 à
4h45.
Antoine Fouchez,
né le 13 novembre 1892 à Arras, journalier à Harnes, 2è classe au
162è RI.
Condamné le 18
janvier 1917 par le CG de la 69è DI pour désertion à l’intérieur
(4 ans de TF, sursis) illettré, déclare à la gendarmerie lors de
son arrestation le 16 avril ne connaître ni l’orthographe de son
nom, ni sa date de naissance ; relevé de punition vierge.
Fouchez ignore la
date à laquelle il est parti. Son absence est constatée à
l’arrivée aux tranchées de première ligne le 14 avril 1917. Il
est porté disparu. Il est ramené le 9 mai au Corps par les
gendarmes : « J’ai quitté la Cie vers 20 heures entre
Bouffignereux et Blanc Bois. J’ai déposé mes armes et mon
équipement sur un chariot de mitrailleuses, puis je me suis rendu à
Jonchery où j’ai pris le train à 5 heures à destination de Paris
où je suis arrivé vers 17h. Je me suis promené le reste de la
journée et le lendemain jusqu’à 15h40, heure à laquelle j’étais
arrêté, Place de la république, par les Gardes républicains et
conduit en prison. »
Avis du colonel,
commandant le Régiment : « Le soldat Fouchez a abandonné
la Cie au moment où elle entrait dans un secteur d’attaque. La
région entre Bouffignereux et le Blanc Bois recevait suffisamment
d’obus pour y constituer la présence de l’ennemi. En
conséquence, le soldat Fouchez récidiviste de l’abandon de ses
drapeaux, doit être traduit devant un conseil de guerre, et mérite
d’être fusillé devant ses camarades qu’il a abandonnés ».
CG de la 69è DI (12
juillet 1917) :
Fouchez : »Je
suis des pays envahis ; je suis sans nouvelles de mes parents.
Je suis parti parce que je suis sans nouvelles et que j’étais
désespéré ». Recours en révision rejeté le 18 juillet
1917, recours en grâce rejeté le 24 août :Fouchez est fusillé
à Haudainville (55) le 26 août 1917 à 5h.
Raymond Albert
Pingault, né le 26 avril 1888 à Paris 4è, charretier, célibataire,
soldat au 1er RIC, déjà condamné le 17 mai 1917 pour refus
d’obéissance et désertion à l’étranger (1 an avec sursis),
jamais condamné au civil . A l’instruction : « J’ai
fait la blague, ma foi, tant pis ! Je n’avais qu’à ne pas
refuser d’obéir. »
CG de la 17è DIC
(16 juin 1917). Pingault « J’ai refusé d’obéir parce que
je ne veux pas aller aux tranchées ; faits de moi ce que vous
voudrez, mais c’est inutile, je comprends que l’on se moque de
moi. »
Rapport bâclé
destiné à accompagner la demande de grâce : « Le 29 mai
1917, à Haprès (Serbie), le sous-lieutenant Andrieux, du me corps
lui donnait l’ordre de monter aux tranchées de 1ère ligne
établies en face de l’ennemi. Il refusa formellement. Son attitude
à l’audience a été scandaleuse. Pingault, qui a essayé sans
succès de se faire passer pour un déséquilibré afin d’excuser
sa lâcheté est un récidiviste du refus d’obéissance. Il a
commis un crime d’autant plus impardonnable qu’il a déclaré ne
pas le regretter et être disposé à le renouveler si l’occasion
s’en présentait. Sa condamnation à la peine de mort, prononcée à
l’unanimité, a été approuvée par tous ses camarades présents
et une commutation de peine serait du plus déplorable effet dans la
Division. »
recours en révision
rejeté le 26 juin 1917, rejet de grâce présidentielle le 27août
Pingault est fusillé
dans le ravin est du camp de Mortreuil près d’Iven (Serbie) le 28
août 1917 en présence des troupes à 6h 15.
Septembre
Gustave Charles
Marie Camus, né le 5 décembre 1885 à Chaumont
(Haute-Marne), marbrier à Thil (Aube) marié, un enfant, 2è classe
au 54è RIC, condamné le 21 juillet 1915 par le CG de la 71è DI
pour refus d’obéissance (5 ans)et le 30 septembre pour abandon de
poste et port illégal d’insignes (5 ans), relevé de punition
chargé (232 jours de prison, 59 de cellule) essentiellement pour
ivresse et absence illégale.
Il n’y a pas de
véritable rapport au dossier, ni d’interrogatoire, Camus ayant
refusé de s’expliquer devant le substitut du
Commissaire-rapporteur (celui désigné ayant été évacué). Une
« note explicative » expose les motifs de son
incarcération, demandant qu’il soit placé au poste de police en
attente du jugement « étant d’un exemple déplorable pour la
Cie » :
Le 8 mai 1917, le
soldat Camus s’est présenté à la visite du médecin à Brnik et
a été exempté de sac. Son sac devant être porté par un mulet du
bataillon, le soldat Camus reçut l’ordre d’accompagner le mulet
pour pouvoir prendre son sac dès son arrivée en ligne. Arrivé à
la tranchée nord du Rocher Mazoyer à minuit, son chef d’escouade
le portait manquant. »
CG de la 17è DIC :
« J’étais ivre, je me suis couché derrière les rochers
puis je suis parti pour Salonique m’amuser un peu. »
Selon ses
déclarations aux gendarmes de Salonique, il ne s’est réveillé
que le lendemain matin, sa Cie étant partie. Le sur-lendemain, il
est monté sur un camion automobile et après être passé par
diverses gares, couchant dans des tranchées abandonnées, il est
arrivé à Salonique où il ne se souvient pas de grand-chose, étant
ivre la plupart du temps, sinon avoir été réveillé parce qu’un
individu revêtu d’un uniforme de soldat russe lui faisait les
poches, emportant ses papiers personnels, des photographies et de la
correspondance.
Recours en révision
rejeté le 14 juillet 1917, recours en grâce rejeté le 5 septembre
1917.
Camus est fusillé
au même endroit que le précédent, près d’Iven (Serbie) le 10
septembre à 6h 15.
Inventaire des
objets laissés à la Prison de la prévôté, dressé le 14
septembre : une bague en aluminium, 17 lettres, une liste de
différentes adresses, une feuille (mémoires du décédé), 10
enveloppes télégrammes, un portefeuille en drap.
Konan Bo,
né vers 1885 à Foto-Bo (Côte d’Ivoire), cultivateur, marié, 2
enfants, soldat au 68è Btn de Tirailleurs sénégalais
CG de la 10è DIC
(14 août 1917)
Déposition du
Lieutenant Merguy : « Le 1er août, Konan-Bo ayant fait
une absence irrégulière à Baccarat, avait étét arrêté et
ramené à sa Cie le 2 août. Je voulus le faire venir pour lui
signifier une punition. Il refusa et s’armant de son fusil
mitrailleur s’opposa à toute tentative de contrainte. Il m’a
même mis en joue. Et présence de son état d’excitation, et étant
donné que c’est un très bon tirailleur, je n’ai pas voulu le
contraindre à l’obéissance sans en avoir référé au Commandant
du Bataillon. Le Commandant estima préférable d’attendre que
Konan-Bo soit calmé. Aussi se borna-t-on à la faire surceiller par
des tirailleurs, sur sa promesse qu’il ne bougerait pas. Il partit
néanmoins et deux patrouilles lancées à sa poursuite ne réussirent
pas à le rejoindre. »
Konan-Bo : - Le
lieutenant m’a menacé de me faire tuer.
Merguy : -
C’est faux.
Déposition de
Marcel Marchal : « Nous revenions de Bertrichamps :
je marchais à 20m environ en avant de Mme Baderot ; derrière
elle, à une certaine distance venait mon père. J’ai entendu Mme
Baderot crier « au secours » puis deux coups de feu ont
retenti. Je me suis retourné et j’ai vu Mme Baderot courir. Je me
suis sauvé et j’ai entendu trois nouveaux coups de fusil. Les
coups de fusil étaient tirés derrière Mme Baderot. Il pleuvait. »
Déposition du
soldat Paul Paoli : « Nous allions en détachement de
Badonviller à Bertrichamps rentrant des travaux. On a tiré sur nous
du bois avec un fusil mitrailleur. Nous avons vu alors un sénégalais
derrière nous et à gauche. Nous avions nos fusils sans cartouches.
Mon camarade Morisseau a été blessé. Le sénégalais a tiré quand
nous avons été passés.
Le soldat Branucci
précise : « En passant à Neufmaisons, des habitants nous
avaient prévenu de la présence dans les bois d’un sénégalais
qui avait tué une femme... »
Déposition du
soldat Bert : « Nous allion de Bertrichamps à
Vacqueville, mon camarade Deshayes et moi : 1400 mètres environ
avant d’arriver à Veney, deux coups de feu ont été tirés sur
nous. Mon camarade a été blessé. Il a tiré sur nous toutes les
cartouches d’un chargeur : il a tiré sur nous, en arrière et
à droite. Nous étions passés quand il a tiré. C’était un
nègre : mais je ne pourrais le reconnaître.
Konan-Bo : -
Tout cela est arrivé parce que le Lieutenant voulait me faire tuer.
Le président :
- Quelle était la position de la femme par rapport à vous ?
Konan-Bo : - il
y avait du brouillard, j’étais caché dans le feuillage, je ne
l’ai pas bien vue. J’ai entendu des pas ; j’ai cru que
c’était des soldats qui venaient m’arrêter.
Le Président :
- Pourquoi, le lendemain, avez-vous tiré par derrière sur des
soldats ?
Konan-Bo :
Voyant des soldats en armes, j’ai cru qu’ils venaient m’arrêter,
car ils s’étaient retournés et m’avaient vu au moment où
j’étais allé boire de l’eau : c’est pourquoi j’ai tiré
sur eux.
Le Président :
- Pourquoi avez-vous tiré sur un deuxième groupe de soldats.
Konan-Bo : - Je
n’ai pas tiré sur eux.
Epilogue : Dans
la nuit du 4 au 5 août, souffrant de la faim et du froid, Konan-Bo
se rendait au poste de police de Baccarat. « J’avais passé
par les bois le long du chemin de fer. Je savais bien que si on
m’avait pris, on m’aurai conduit au Lieutenant qui m’aurait
fait tuer. J’ai mieux aimé me rendre à Baccarat plutôt que de me
laisser prendre dans les bois. »
Pas de pourvoi en
révision ni de demande de grâce. Konan Bo est fusillé au champ de
tir de Neuvilles le 12 septembre à 5h30.
Keita Birama,
né en 1892 à Sarifrran (Soudan), commerçant, tirailleur de 2è
classe au 61è Btn de Tirailleurs sénégalais
Le 29 avril 1917, le
89è BTS est consigné dans son cantonnement de Clermont, près de
Nanteuril-les-Meaux, les hommes affectés à des travaux de propreté
et de fabrication de râteliers d’armes. Enfreignant les ordres,
Birama sort du cantonnement et part se promener dans le village
voisin. Il finit par y rencontrer le sergent de jour Raynaud qui fait
sa ronde. Fâché d’être interpellé sur son identité et son
numéro de Cie Birama « injuria le sergent et s’avança
menaçant vers lui ». Alertés par le bruit l’adjudant du
poste de police intervient et parvient avec difficulté à ramener
Birama. Arrivé au poste celui-ci se couche et s’endort. Mais vers
16 heures quand il se réveille, sa colère revient et il décide de
tuer l’adjudant Raymond. Trompant la surveillance, il sort et se
dirige vers son cantonnement pour aller chercher son fusil. Il
aperçoit Raymond discutant avec une dame et un autre sous-officier.
Il continue son chemin, charge son arme et revient à l’endroit où
il a vu son chef ; se mettant à genoux, il tire froidement deux
coups de fusil. Le premier atteint le sergent Raymond qui s’effondre
et meurt quelques instants après. Le second atteint le caporal Simon
qui meurt des suites de ses blessures à l’hôpital de Meaux le
premier mai. Au bruit des détonations surgissent, accompagnés de
quelques tirailleurs, les sergents Chrétien et Bonal. Birama tente
de retourner sa baïonnette contre le premier, mais il est maîtrisé
et ligoté. Ecroué le 15 juillet [seulement?] à la prison de la
prévôté, Birama reconnaît les faits mais explique qu’il a réagi
à la provocation et que le sergent Raynaud lui aurait donné trois
gifles devant témoin.
« Dans son
rapport, le commandant de Cie déclare que le sergent Raynaud était
très doux avec les indigènes, qu’il n’avait jamais punis depuis
trois mois qu’il était au corps : c’était un excellent
serviteur, plein de zèle ; par contre, les renseignements
donnés sur le compte de l’inculpé lui sont très défavorables :
paresseux, sournois, très vaniteux, il use de tous les moyens pour
se soustraire au service… détestant les européens et ne voulant
pas être commandé par des blancs ».
Derrière les
relents de racisme qui pointent dans les témoignages de
l’encadrement européen, on peut se demander par la simple
constatation de la date des faits, s’il n’y aurait pas eu un
règlement de compte envers un agitateur susceptible d’entraîner
d’autres tirailleurs dans un mouvement d’opposition au
commandement, car le gentil Raynaud n’était peut-être pas aussi
bienveillant que ses égaux veulent le souligner.
Interrogatoire
Birama : « dans la rue j’ai été arrêté par un
sergent que je connais très bien parce qu’il est de ma Cie. Il m’a
arrêté et m’a demandé mon nom. Je lui ai dit « tu me
connais, je suis de ta Cie » Le sergent m’a dit de me mettre
au garde-à-vous, je l’ai fait, puis il m’a demandé ma plaque,
je lui ai dit que je n’en avais pas. Le sergent m’a attrapé le
poignet et relevé ma manche pour voir si j’avais une plaque.
Aussitôt il m’a traité de cochon et de salaud et m’a donné
trois gifles. Je suis resté au garde-à-vous et je lui ai dit
merci. »
Un médecin qui
passait par là revenant d’une promenade à cheval, donna les
premiers soins au caporal Simon. Il ajoute incidemment : « De
plus j’allais voir l’assassin qui se plaignait de douleurs à la
face. Je constatais que les contusions de la face étaient sans
gravité ». Sans gravité peut-être, néanmoins ces contusions
sont visibles… Il se pourrait qu’elles soient dues à
l’intervention du sergent Bonal qui frappa le tirailleur après que
Chrétien l’eut désarmé.
Toute cette affaire
est d’autant plus suspecte qu’aussitôt donné l’ordre
d’informer, le CG de la Viè armée se désépaissit (le 22 mai),
« et renvoie le dossier devant le CG dont dépendent les
éléments du 89è Bataillon de tirailleurs sénégalais, dissout,
versés dans le Unités du 1er C.A.C. »
CG de la 3è DIC (18
août 1917). Recours en révision rejeté le 21 août 1917
Birama est fusillé
à Baslieux-Lès-Fismes (51) le 12 septembre 1917
Hébert Georges,
médecin aide major des troupes coloniales : « Après le
feu de salve du peloton d’exécution le condamné n’était pas
mort. J’ai dit alors au Sergent Stuber de donner le coup de grâce
dans l’oreille du condamné. Ce coup de grâce n’ayant encore pas
déterminé la mort j’ai fait tirer un second coup de revolver dans
la région temporale gauche de Birama Keita qui s’est alors
affaissé mort. Après le défilé des troupes j’ai examiné le
cadavre sur lequel j’ai constaté onze orifices d’entrées de
balle situés respectivement, un au-dessus de la base du sternum à
deux centimètre environ, un dans la région sous-claviculaire
droite, un au-dessus (1cm du mamelon droit, trois le long du bord
droit su sternum, un au niveau du bord gauche du sternum à
l’insertion du cartilage de la 5è côte gauche, quatre dans la
région abdominale à droite de la ligne médiane. Les orifices de
sortie de ces balles étaient situés dans la région lombaire et
dans la région dorsale. »
Sa fiche de décès
portant « genre de mort : Inconnu » il est déclaré
Mort pour la France.
Louis Émile
Martinel, né le 13 décembre 1894 à Dombasle (Meurthe et
Moselle), manœuvre, chasseur de 2è classe au 3è BMILA, condamné
6 fois pour vol, pèche et chasse, et le 31 mai 1917 pour pour
désertion (3 ans). Blessé à Nieuport et évacué sur l’hôpital
de Zuydkoote (sic) le 1er janvier 1917.
Martinel quitta son
régiment qui montait d’Hermonville aux tranchées dans la nuit du
9 juin 1917. Il était deuxième pourvoyeur de fusil mitrailleur et
transportait un havresac de 384 cartouches qui ne fut pas retrouvé.
Il fut arrêté le 17 juin au Muy (Var) par la gendarmerie, après
être passé par Dombasle, et Marseille, tentant de rallier à pied
Saint-raphaël. Rapport : « il dit avoir agi par dégoût
n’en voulant plus de la guerre »(sic) ; « J’ai
fait cela à raison d’une affaire de famille très triste... Depuis
deux ans et demi que je n’ai pas pu obtenir de permission, j’ai
décidé de me rendre chez moi sans titre d’absence. » Ramené
au corps le 25 juin et mis à la section spéciale (disciplinaire),
Martinel faisait partie d’une corvée de transport de matériel de
Cauroy aux première ligne dans la nuit du 27 au 28 juin. Il profite
de la confusion de nombreuses corvées de ravitaillement pour se
faufiler parmi elles et s’évade : il fut arrêté à la gare
de Contrexéville le 30 juin 1917. Retourné à son corps par la
prévôté du Bourget le 14 juillet.
CG de la 45è DI.
Pourvoi en révision rejeté le 13 août (absence de moyen), recours
en grâce rejeté le 11 septembre 1917. Fusillé à 300m au nord de
la bifurcation du château de Neuville avec le chemin de Sainte-Gemme
(Marne) à Goussancourt et en bordure de la route, le 13 septembre à
6h, en présence de 4 pelotons du 1er BMILA, 4 du 3è, 2 du 1er RMT
Gustave Georges
Renold Colnion, né le 14 novembre 1896 à Maubeuge, 2è classe au
43è R.I.
CG de la XIIè
région. Minutes du procès, question :
On apprend encore
des Minutes du procès que deux flacons de cyanure de potassiuem
furent présentés comme pièces de conviction, et que le cousin de
Colion, Edouard fut appelé à témoigner en vertu des pouvoirs
discrétionnaires du président (on ignore la teneur de ses propos).
Pourvoi en
révision : annulation partielle sans renvoi, concernant la
seule « dégradation militaire »
« Attendu
qu’il résulte… que les faits reprochés à Colnion ont été
commis par lui à Maubeuge du mois d’août au commencement du mois
de novembre 1915 ; Que le 5 novembre 1915, il a franchi la
frontière hollandaise avec l’aide des autorités allemandes, a été
dirigé de la Hollande sur l’Angleterre, puis en France où il a
été incorporé le 19 novembre 1915 au 43è R.I. à Limoges et que
les faits à raison desquels il a été poursuivi sont tous
antérieurs à son incorporation... »
Limoges, le 13
septembre à 6h30
Entrefilet du Midi
socialiste (daté 15 septembre 1917)
Carnets de guerre
d’Henri Camus, le 28 juillet 1917 : « On a appris
aujourd’hui que le fils de Colnion, le pharmacien de Louvroil,
avait été fusillé à Limoges pour trahison et correspondance avec
l’ennemi. Le même sort l’attendait à Maubeuge après la
guerre. »
26 octobre 1937 :
« Le ministre
de la défense Nationale et de la guerre au Commissaire du
gouvernement près le tribunal militaire de Bordeaux. En vue de
l’obtention de la médaille de la Reconnaissance Française, le
sieur Hannecart, Marceau, demeurant à Valenciennes, sollicite la
délivrance d’un certificat établissant sa qualité de
dénonciateur d’un individu du nom de Colignon, qui aurait été
passé par les armes à Limoges vers le mois d’août 1916.
En réponse à votre
dépêche du 26 octobre 1937, j’ai l’honneur de vous rendre
compte que, malgré les recherches effectuées dans les archives du
Conseil de guerre de la 12è région, aucune affaire Colignon n’a
pu être découverte. Toutefois, à la date du 19 juillet 1917, ce CG
a condamné à la peine de mort le soldat Colnion Gustave… pour
avoir, en 1915, à Maubeuge, entretenu des intelligences avec
l’ennemi et plus spécialement avec le Capitaine Kirkerklein [von
Kirchenheim], chef de bureau de la police secrète allemande de la
komandantur de Maubeuge. Colnion a été fusillé le 13 septembre
1917. Mais le dossier de cette affaire envoyé le 2 avril 1919 au CG
de la 10è armée n ‘a pu être retrouvé malgré les
recherches effectuées à la suite de plusieurs demandes faites par
le Commissaire du Gouvernement de Limoges... »
Le dénonciateur n'obtiendra pas sa médaille.
A lire les dossiers
officiels de septembre, on remarque qu’il n’y est plus question
que de quelques abandons de poste ou d’affaires criminelles. La
dernière révolte officiellement recensée est celle du 191è R.I. à
Senoncourt. Si ce mois de Septembre semble calme, il s’y déroule
en réalité le plus effroyable des crimes de guerre, nié par les
autorités qui appliquent la tactique médiévale expérimentée à
Coeuvres et Missy en exterminant les soldats russes emprisonnés au
camp de La courtine.
Lucien Joseph
Émile Lefranc, né le 13 février 1889 à
Fontaine-Notre-Dame (Aisne), célibataire, terrassier, soldat au 166è
R.I.
Alfred Stock,
né le 29 mars 1885 à Dizy (Marne), célibataire, chauffeur à
Magenta, déserteur du 13 juillet 1916 au 29 juin 1917, où il est
arrêté dans l’Aisne au hameau Le Sart, gréviste du 22 juillet.
CG de la 132è DI
audience du 4 août 1917 : Minutes uniquement, ce qui n’est
pas étonnant puisqu’il s’agit de la répression des mutins du
166è R.I. accusés d’abandon de poste et/ou de refus d’obéissance
de façon à déguiser des faits sur lesquels demeurent très peu
d’information, mais dont on sait que le point culminant fut atteint
le 22 juillet près de Mourmelon, caractérisé par le refus de
s’équiper pour monter aux tranchées d’une centaine de soldats.
Ces « incidents » avaient été précédés à partir de
la mi-mai par un grand nombre de désertions, dont celles au 19
juin.
Liste des autres
inculpés
Caporal Marcel
Alexandre Roger, 25 ans, boucher, jamais condamné, abandon de poste
EPE, désertion EPE, refus d’obéissance pour marcher à l’ennemi
(22 juillet)
Caporal Magloire,
Alexandre Leloup, 29 ans, marié, 3 enfants, employé de commerce,
jamais condamné, AP et désertion EPE, ROME (19 juin, Mourmelon et
22 juillet)
Clairon Marcel
Lucien Lécrivain, 23 ans, célibataire, charcutier, jamais condamné,
AP et désertion EPE, ROME, (27 mai au 4 juin , Vaudemange et
tranchée d’Erfuhrt, et 22 juillet)
Gaston Peugnet, 30
ans, marié 1 enfant, mineur, désertion EPE, ROME (27 mai
Billy-le-Grand, et 22 juillet)
Charles Louis
Mathieu, 24 ans, célibataire, manœuvre, désertion à l’intérieur,
ROME (17 juin 1917 Troyes et 22 juillet)
Charles Frappart, 30
ans, marié 1 enfant, journalier, jamais condamné, désertion EPE,
ROME (12 juin Mont Cornillet, arrêté à Paris le 25 juin, et 22
juillet)
Ernest Joseph
Duhamel, 23 ans, célibataire, employé de commerce, AP et désertion
EPE, ROME (19 juin et 22 juillet)
Alphonse This, 43
ans, marié, découpeur, AP et désertion EPE, ROME (19 juin tranchée
d’Erfuhrt au Mont-Blond et 22 juillet)
Denis Rolland :
Le 22 juillet, malgré les injonctions du lieutenant Chaub et du capitaine Cuburu, les hommes refusent de s'équiper pour se rendre aux tranchées du Mont-Blond. Dix d'entre eux sont arrêtés, ils étaient déjà tous coupables d'abandon de poste ou de désertion... Deux d'entre eux ont un passé particulièrement chargé. Lefranc a déserté du 28 mai au 6 juin, puis du 17 au 23 juin. Dans la nuit du 9 au 10 juillet, il a quitté la prison mais il est revenu de lui-même. Stock a déserté le 16 juillet 1916 et a été arrêté le 29 juin 1917. Le 4 août, les sanctions du conseil de guerre de la 132è DI sont très lourdes : cinq hommes sont condamnés à mort à l'unanimité : Lefranc lucien, Stock Alfred, Frappart Charles, Duhamel Ernest et Roger Marcel. Quatre autres écopent de vingt ans de travaux forcés et un de cinq ans de prion. Le président de la république commue la peine de trois des condamnés à mort.
Le lieutenant Chaub,
malade, n’a pu assister au conseil.
Lefranc qui n’est
inculpé que de Refus d’obéissance, pour la révolte du 22
juillet, a forcément été considéré comme meneur, puisque de
grade moins élevé que deux des condamnés à mort graciés, il a
tout de même été envoyé au poteau.
Pourvoi en révision
rejeté le 13 août 1917. Recours en grâce rejeté.
Lefranc et Stock
sont fusillés à Soulanges le 22 septembre 1917 à 6h30.
Konaté Ibrahima,
né en 1890 à Gangan (KanKan, Guinée), cultivateur, marié,
tirailleur de 1ère classe au 95è BTS
Le 28 août 1917 à
Iven en Serbie, Konaté Ibrahima, seprécipite avec son fusil et un
coupe-coupe vers l’abri aménagé le matin-même sous un rocher
pour le repos des officiers Gallo et Roussel durant les heures
chaudes. Ceux-ci sont assoupis. Il tire un coup de fusil qui ricoche
sur la roche, Gallo, réveillé par le bruit, tente de le désarmé
et reçoit un coup de coupe-coupe en plein front. Roussel cire :
« Au secours, on tue Gallo », ce à quoi Gallo répond,
« Fuyez, il va vous tuer » Ils roulent dans le ravin,
continuant la lutte. Gallo est frappé par l’arme blanche à la
tête, puis dans le dos. Il s’évanouit. Ibrahima remonte et tire
deux coups de fusil sur le sous-lieutenant Roussel qui s’effondre
mort.
Ottari Joseph,
cultivateur à Bastilica (Corse), soldat au 95è BTS : « J’étais
avec Géraldi vers 13h30 sur un rocher dominant l’endroit àù le
sous-lieutenant Roussel et le sergent major Gallo reposaient. Nous
avons tout-à coup entendu le bruit d’un coup de fusil et des cris.
Je vis le sergent-major Gallo aux prises avec un tirailleur qui avait
le coupe-coups à la main. Le sergent-major roula au bas du rocher.
Je descendis précipitamment avec l’intention de porter secours au
sergent-major mais étant tombé en cours de route, je perdis du
temps. Quand je me relevai, le tirailleur me mit en joue mais ne tira
pas. Je le vis ensuite s’enfuir, pénéter dans la tente du Caporal
Teillard pour lui tirer deux coups de fusil et donner plusieurs coups
de coupe-coupe. Je suis allé ensuite prendre mon fusil et j’ai
tiré trois balles sur le tirailleur meurtrier qui s’enfuyait dans
la direction de l’Infirmerie. »
Ibrahima dit que le
sous-lieutenant Roussel, le « taquinait » déjà à
Saint-Tropez, et qu’il avait décidé de le tuer par vengeance. Les
témoins décrivent Roussel comme un chef bon « et très
doux ».
Notes d’audiences
du CG de la 17 DI (8 sept 1917) :
D : - Pourquoi
avez-vous tué votre lieutenant ?
R : - Je l’ai
tué parce qu’il me détestait.
D : - Et le
capitaine Teillard ?
R : - J’étais
ensuite excité, je voulais tuer tout le monde, je veux dire tous les
européens !
D : -
Regrettez-vous au moins ?
R : - Non, je
suis content d’avoir tué mon lieutenant !
D : - Vous
savez que les crimes que vous avez commis vous exposent à être
fusillé vous-même ?
R : - Oui, je
dois être fusillé. Moi tuer… moi fusillé, il y a bon !
D : - Avez-vous
encore quelque chose à dire ?
R : - Je suis
content, je voulais tuer tous les Français.
Devant la limpidité
et l’intransigeance d’un tel discours, on ne peut que s’incliner.
Rejet de grâce
présidentielle le 18 septembre.
Camp Mortreuil à
Iven (Serbie) le 24 septembre à 6h30. Grande parade (3 Cies, section
dartillerie, section du Génie)
Basile Théodule
Buttard, né le 24 février 1896 à Albiez-la-Jeune
(Savoie), à 7 ans ramoneur, à 16 ans garçon vacher au Parc de la
Tête d’or à Lyon, cultivateur, sapeur-mineur au 2è Rgt du Génie
« s’étant dit René. Le prétendu René a sur la poitrine un
tatouage représentant une tête et un buste de femme. Il a un autre
tatouage, un petit croissant entre les deux sourcils », selon
d’autres une hirondelle, à l’avant-bras gauche un vase de fleurs
avec l’inscripion à ma mère, Enfant de malheur» et une pensée.
Taille 1,72 à 1, 75m, visage allongé couvert petits boutons rouges,
joufflu, moustache rasée, sans barbe, nez petit, allongé
rectiligne. Condamné le 14 décembre 1915 pour coups sur gardiens de
prison militaire.
Le 7 février 1917,
le commissaire de police du 3è arrdt à Montpellier fut appelé à
constater le décès de la fille Alice Aubert, âgée de 26 ans,
vivant de ses charmes. Une blessure à hauteur du coeur faite avec un
couteau avait déterminé la mort. Une chemise d’homme était
encore sur le lit, une tirelire avait été brisée. L’enquête
montre que le crime a eu lieu dans la nuit du 5 au 6, et « que
parmi les derniers hommes aperçus au domicile de la défunte se
trouvait un soldat qui depuis peu de temps, se montrait assidu chez
Alice. », « que des objets divers, de toilette ou de
vêtements on été venus dans le quartier interlope de la rue de la
Méditerranée par les soins de femmes complaisantes et de militaires
qui étaient leurs compagnons momentanés. C’est grâce à ce
trafic, opéré sur des chaussures, des fourrures, un manchon, de la
lingerie – aux dates des 6 et 7 février – que l’on put
identifier les personnages mêlés de près ou de loin à l’affaire
criminelle.
Un certain Eugène
Ferrandi, qui devait épouser Alice et exploiter avec un fond de
commerce dont elle avait fait l’achat (une « maison à gros
numéro ») dresse ainsi la liste des possessions de sa future :
deux paires de boucles d’oreilles or, une bague marquise avec
brillants, une alliance, sic chemises trois pantalons de lingerie,
sept serviettes nid d’abeille, un porte monnaie, un parapluie, dont
quelques unités furent retrouvées ultérieurement à Marseille au
domicile de la fille soumise (pensionnaire de « maison »)
Aline Hennechell, à savoir : un sac à main de cuir, un
panrtalon de femme en coton mauve, une serviette éponge, un manchon
de fourrure noire, une fourrure noire à deux têtes, un parapluie
noir. Elle déclare que le manchon, la fourrure, les bottines lui ont
été données par son amant le soldat Buttard parti pour Salonique à
la date du 10 février 1917. « Cette fille Hennechel était
venue [de Cette] à Montpellier fin Janvier 1917, y avait pris le nom
de Fernande Agussol [car elle était recherchée pour plusieurs faits
d’entôlage] et avait et avait fait la connaissance du soldat
Buttard dans les premiers jours de février, grâce à l’entremise
de la nommée Jeanne Grégoire et du soldat, amant de celle-ci. »
Selon la fille Hennechel toujours les objets lui auraient été remis
en une fois, le 6 février vers 23h30, dans sa chambre, après une
séance de cinéma à laquelle Buttard l’avait conviée. Il serait
retournée chercher les vêtements de prix, n’ayant emporté le
matin du crime qu’une bague à laquelle il attachait la valeur
sentimentale d’un souvenir. l’expédition nocturne aurait eu lieu
avec l’assistance d’un soldat du nom de Caillou, vainement
recherché.
Buttard :
« Aline et moi avons passé une partie de la soirée au cinéma
Pathé. Nous sommes revenus au domicile d’Aline. Cette femme m’a
déclaré de nouveau qu’elle voulait me suivre à Marseille. Je
l’ai quittée pour rejoindre mon détachement à la caserne. Aline
se trouvait dans le train qui devait nous emporter. Je suis monté
dans son compartiment et nous avons voyagé ensemble jusqu’à
Marseille où nous sommes arrivés le vendredi 9 vers 9 ou 10 heures
du matin. Le détachement est entré au Dépôt près de la gare.
Aline m’a fait appeler vers midi et demi, nous avons déjeuné
ensemble et nous avons loué une chambre à l’Hôtel du Sport, rue
du Petit saint-Jean. »
La bague fut mise en
gage par Buttard à Marseille le 9 février, veille de son départ
pour Salonique.
Buttard nie le
crime, et en rend responsable un mystérieux civil. Mais le 6 février
au restaurant Paparel, Buttard commet l’imprudence de dire au
soldat Joseph Nicolle : « On s’apercevra bientôt qu’une
femme a été tuée. C’est moi qui ai fait le coup. » Ce
Joseph Nicolle du 44è chasseur est probablement l’amant de Jeanne
Grégoire, à qui il écrit à de multiples reprises, des lettres
signées Lulu, car il se fait appeler Léon et non Joseph.
CG de la XVIè
région de Corps d’Armée (31 juillet 1917)
- Avez-vous autre
chose à dire ?
L’inculpé se met
à rire, répond : La Messe »
Recours en révision
rejeté le 11 août 1917, rejet en grâce le 26 septembre
Buttard est fusillé
dans l’enceinte de la Citradelle de Montpellier le 28 septembre à
6h30.
(Plus)
(Plus)
Octobre
Alfred
Janin, né le 28 octobre 1885 à Plainpalais (canton de
Genève), boulanger à Lyon, célibataire, 2è classe au 30è R.I.,
6è Cie, condamné en mai 1905 pour désertion en temps de paix,
relevé de punition : 239 jours de prison, 47 de cellule,
affecté à la Section de Discipline de Biskra le 6 septembre 1906.
Alfred Janin
abandonne son unité le 12 juillet 1916 à 6h au camp de la Béholle
(Meuse) alors qu’elle doit monter en première ligne. Il est
atteint de tremblements nerveux incontrôlables. « je ne peux
supporter aucun coup de fusil ou de canon.Je ne regrette pas cet acte
puisque mon état de santé ne me permet pas de supporter les
fatigues de la guerre ».Il se rend à Dugny où il séjourne
quatre mois, survivant en vendant des journaux aux troupes de passage
et en travaillant au champs. Le 15 novembre 1916, il quitte la région
en prenant un train de permissionnaires et se rend à Lyon, où il
travaille comme boulanger chez une dizaine de patrons différents. Le
25 février 1917, il décide de sen rendre à Rumilly chez ses
parents, mais il est arrêté le lendemain par la gendarmerie à St
Marcel-Bel-Accueil. Reconduit à son corps il est dirigé sur
Fignières le 3 mars, mais au lieu de rejoindre son unité, il gagne
Creil, traverse Paris et revient à lyon le 6 mars 1917. Excerçant
toujours son métier de boulanger, il y vit jusqu’au 6 juillet
1917, date à laquelle il est arrêté par des agents de la brigade
cycliste. Les expertises médicales attestent de sa pleine
responsabilité et de l’absence de « maladie nerveuse ».
CG de la 28è DI,
recours en grâce présidentielle rejeté le 30 septembre 1917 :
Janin est fusillé à
l’ouest de Chavigny (Aisne), route de Villers-la-Fosse « chemin
de terre à gauche après avoir passé la voie métrique » le
1er octobre 1917 à 6h30
« Je soussigné
Meunier Camille… déclare avoir constaté l’existence de 7
orifices de balles situées dans la région thoracique antérieure au
voisinage du cœur, au cou et l’une à la face. Comme il paraissait
respirer faiblement j’ai jugé le coups de grâce nécessaire et le
lui ai fait donner. »
Théophile
Bouveur, né le 18 juillet 1890 à Avallon (Yonne),
tailleur en confection à Paris, célibataire, tirailleur de 2è
classe au 2è RMT ; 1,68m blond aux yeux gris, un tatouage
représentant une médaille tête de mort sur le sein gauche, une
pensée à l’avant-bras gauche, une mosquée (?) bras gauche, une
rose avant bras droit une caricature d’officier bras droit, une
colombe épaule droite, MAROC sur l’épaule droite, buste de femme
sur l’omoplate droite. Blessé à la cuisse gauche le 8 juin 1916
à Bettancourt et commotion cérébrale le 15 décembre 1916 au ravin
du Helly (Verdun). Condamné qu Maroc pour « sommeil en faction
en présence de l’ennemi »(1913). Prétendument caporal deux
fois cassé.
L’abandon de poste
reproché à Bouveur aurait eu lieu le 19 juillet 1917 : Bouveur
aurait accompagné un camarade zouave partant en permission avec qui
il déjeune à Nancy. Il est « arrêté » par la police à
la gare qui le laisse repartir. Il arrive à Champenoux où cantonne
son régiment le même jour à 19h, et couche dans le Bois des
Cent-Chênes, n’ayant pas le mot de passe pour regagner le
cantonnement. Le lendemain matin, à 8 heures, il est de retour à
son poste.
Le 9 août 1917,
alors qu’il est ramené à Bruley sous garde de police (en
prévention de CG) Bouveur voit maltraiter le tirailleur Zoli, qui
aurait devant la population du village accourue pour voir le défilé,
fait du scandale et insulté le sous-lieutenant Darbelet. S’avançant
vers cet officier, Bouveur s’écrie : » Que de bons
coups de trique se perdent ! Heureusement qu’ils ont du galon
sur les bras ! » Comme Darbelet lui intime de se taire, il
le saisit à la gorge et le frappe d’un coup de poing au visage. Le
sous-lieutenant Bacquès se porte au secours du gradé et frappe
Bouveur de sa canne. Bouveur lâche Darbelet et se jette sur Bacquès
avec qui il roule à terre. Un officier survient, revolver au poing.
Bacquès a finalement le dessus et fait enfermer Bouveur aux
quartiers disciplinaires.
CG de la 37è DI.
(30 août 1917) jugé avec Emile Zoli, accusé de voies de faits et
outrages envers supérieurs (à quoi s’adjoint l’abandon de poste
pour Bouveur)
Zoli (à
l’audience) : « A l’arrivée au cantonnement, j’ai
demandé à l’adjudant Vermeille pourquoi il enfermait les punis
alors que le capitaine adjoint avait dit au cours de l’étape qu’on
les ramenait à leurs compagnies respectives. Mes camarades m’ont
soutenu dans mes réclamations. A ce moment j’ai reçu un coup de
bâton. Puis le sous-lieutenant Darbelet est arrivé pour m’imposer
silence. Je lui ai répété qu’on devait nous renvoyer à nos
compagnies. Il a levé alors son sabre en me menaçant et comme je
continuais à parler, il m’en a frappé. C’est d’ailleurs
fréquent aux tirailleurs que les officiers frappent les hommes.Après
avoir été frappé j’ai crié tout haut : « C’est
honteux de traiter ainsi des soldats français » On s’est
alors jeté sur moi, il y a eu bagarre et on m’a emmené aux locaux
disciplinaires. J’avais la tête en sang et l’on a refusé malgré
ma demande de me faire conduire à l’infirmerie. » (Voilà ce
qui lui vaudra seulement dix ans de TF)
Bouveur : « Je
suis intervenu quand j’ai vu le sous-lieutenant Darbelet frapper
mon camarade Zoli. Je me suis précipité en avant en disant tout
haut : « C’est honteux de frapper des soldats
français ». Immédiatement je recevais sur la tête un coup de
fourreau de sabre que me donna le sous-lt Darbelet. Je me suis alors
jeté sur lui, l’ai saisi par le cou et nous avons roulé sur le
sol. Un officier que j’ai su après être le s/lt Bacqès est
intervenu et m’a asséné un coup de canne sur la tête ; je
me suis retourné contre lui et nous nous sommes battus. Quand ce fut
fini, j’étais couvert de sang et on m’a emmené à l’infirmerie.
Je n’aurais jamais frappé mon officier si je n’avais été
frappé le premier. Je suis intervenu parce que mon camarade Zoli
était frappé et avait sur lui trois personnes.
Darbelet : « [En
arrivant] Au cantonnement de Bruley je vois un rassemblement devant
la remise qui devait êtrele local disciplinaire. Zoli discutait
violemment avec l’adjudant Vermeille. Je veux le faire taire. Il me
dit : « Tu es trop jeune, enlève ta veste et nous
verrons ». Je réponds « Jen’ai pas à enlever ma
veste, je vous ordonne de vous taire ». Il se tourne vers
lepublic, civil et militaire, et dit : « Vous comment
comment aux tirailleurs on traite des français ». De nouveau
je lui ordonne de se taire. Il s’avance vers moi. Je lève mon
sabre au-dessus de mon épaule. Il se précipite pour saisir le
fourreau. A ce moment le caporal Schmidt l’empoigne et avec l’aide
d’autres gradés on l’emmène aux locaux disciplinaires ».
- L’intervention de Bouveur paraît racontée de façon moins
mensongère- : « [Bouveur et Bacquès] roulèrent ensemble
sur le sol et le Lt Reymond allait faire feu sur Bouveur quand le Lt
Bacquès ayant réussi à maîtrise ce dernier arrêta le geste du Lt
Reymond ». Personne parmi les témoins ne prend le risque
d’affirmer qui a frappé le premier, ils n’ont vu que de loin
l’altercation, ayant été rapidement dispersés par des
sous-officiers.
Après le procès,
deux juges signent une recours en grâce présidentielle, et, fait
inhabituel, le commissaire rapporteur recommande la commutation de
peine. Sur le même rapport l’appréciation du général Duplessis
commandant la 17è DI est au contraire : « Il n’y a pas
que la lâcheté à réprimer. Il y a, et plus que jamais,
l’indiscipline grave et la rébellion contre l’autorité. Je
demande avec la dernière insistance, que le tirailleur Bouveur soit
exécuté et qu’une décision rapide intervienne, les lenteurs
habituelles ayant les plus fâcheux inconvénients ». Deux
autres généraux lui emboîtent le pas.
La désignation de
« meneur » étant utilisée au rapport, on peut se
demandant -en relisant l’appréciation des généraux- s’il ne
s’est pas agit en réalité de mater une révolte de plus grande
ampleur dans la crainte d’une « contagion »
d’indiscipline. De l’aveu du Lt reymond, la garde de police n’est
pas intervenue car elle se trouvait entourée par les hommes
finissant l’aménagement du cantonnement.
Lorsqu’on lui
demande au cours de l’interrogatoire, s’il n’a rien à ajouter
à ses déclarations, Zoli laisse échapper cette phrase :
« non. J’ignore complètement l’origine de la mutinerie
dons les punis sont les auteurs. Pour mon compte personnel, je n’ai
rien dit ou fait qui puisse les inciter à commettre des actes
d’indisciplines. »
A quelles sanctions
sanctions s’exposait le commissaire-rapporteur pour avoir émis un
avis réservé sur l’application de la peine de mort ?
Recours en révision
rejeté le 4 septembre 1917
Bouveur est fusillé
à Fains (55) le 1er octobre 1917 à 8h
Attien-Bobé,
né vers 1893 à Diakodiokro (Côte d’Ivoire), cultivateur, 51è
BTS
« Attien-Bobé
était employé comme aide-cuisinier à la popote des sous-officiers
européens de la 3è Cie [du 51è bataillon de tirailleurs
sénégalais] ; il travaillait sous la direction du cuisinier
Dumesnil. Le trois août vers 17 heures, [au cantonnement de
Ciry-Salsogne], il était occupé à éplucher des pommes de terre
dans le local servant de cuisine. Dumesnil était à côté de lui.
Brusquement, sans explication, il sortit et disparut. Quelques
instants après son départ, Dumesnil dit au sergent de jour
Chartoire qu’Attien-Bobé avait disparu et qu’il avait besoin de
lui pour son travail. Le sergent Chartoire se dirigea vers la cave
qui servait de cantonnement à Attien-Bobé et à un groupe de
sénégalais. Il l’appela de la cour et ne le voyant pas venir, il
descendit quatre des marches de l’escalier et aperçut Attien-Bobé
qui se dissimulait dans l’ouverture de la porte donnant accès à
une seconde cave. Chartoire lui dit : « Viens, Dumesnil a
besoin de toi » A cet instant Attien-Bobé sortit de sa
cachette et braqua dans sa direction un fusil dont il manœuvra la
gachette. Le coup ne partit pas. Chartoire, croyant que le sénégalais
s’amusait lui dit : « laisse ton fusil et viens. »
Attien-Bobé manœuvra alors la culasse de l’arme et en éjecta une
cartouche qui venait de rater. Chartoire devinant alors les
intentions du noir s’enfuit en criant : « Attention,
Attien-Bobé est fou ». Le prévenu sortit dans la cour
derrière le sergent. Il s’avança de quelques pas dans la
direction de la cuisine. Sur une terrasse servant de chambre à four,
à 2,50m de l’entrée de la cuisine.
Le sergent Lecalard
et les caporaux Gérault et Brindejoue sciaient du bois. Attien-Bobé
tira un coup de feu sur ce groupe. Les deux caporaux se couchèrent
immédiatement à terre derrière un petit mur clôturant la chambre
à four et le sergent Lecalard au contraire, au bruit du coup se
dressa, voulut se précipiter dans la cuisine, mais au même instant
il fut atteint par une balle et s’écroula en travers de la porte.
Le caporal Gérault bondit alors sur Attien-Bobé, toujours armé et
menaçant ; il le maîtrisa et le désarma lorqu’il cherchait
à recharger son arme, dont le chargeur était vide de ses trois
cartouches. On découvrit dans une poche d’Attien-Bobé une
quinzaine de cartouches. Le sergent Lecalard fu atteint par le
deuxième coup d’Attien-Bobé, à la base du cou, du côté droit à
un demi-centimètre en arrière de la carotide. La balle qui le
traversa de part en part sortit à la pointe de l’omoplate gauche…
Dans son trajet la balle a occasionné une lésion de la moelle
épinière, la blessure était ainsi mortelle… Attien-Bobé prétend
n’avoir pas tué volontairement sa victime. D’après lui, il
aurait prémédité de tuer le cuisinier Dumesnil auquel il reproche
de ne pas lui donner à manger et de le faire littéralement mourir
de faim. Le trois août il tenta de mettre à exécution le projet
qu’il nourrissait depuis trois jours… Attien-Bobé avoue avoir
quitté Dumesnil dans la cuisine pour préparer son assassinat… Il
allait sortir pour commettre son crime lorsqu’il s’entendit
appeler par le sergent Chartoire dont il reconnut la voix… Lorsque
ce sous-officier fut à deux mètres de lui environ, il sortit de sa
cachette et à bout portant tira sur lui ; le coup rata ;
c’est à ce hasard seul que Chatoire doit la vie… Les témoins
sont formels pour dire que le témoin a visé le groupe [Lecalard,
Gérault, Brindejoue] : il n’a aps pu apercevoir Dumesnil. Ce
témoin affirme en effet avoir été occupé pendant le drame, à
hacher de la viande sur la table de la cuisine à l’extrémité
opposée de l’entrée... Il est hors de doute que le prévenu ait
voulu tuer Dumesnil et qu’il avait prémédité son acte. Mais il
était décidé aussi à faire disparaître tous les obstacles qui
pourraient entraver son projet. »
Albert Baptiste
Pestre, commandant la 3è Cie : « Attien-Bobé profitant
du désarroi général s’enfuit et fut arrêté à une centaine de
mètres de là par un conducteur auquel il ne fit aucune résistance.
J’interrogeais Attien-Bobé qui se refusa alors à me faire aucune
espèce de déclaration. Il se contenta de me dire ; « moi
y en a content de faire mort tout de suite ». Il se rendait
compte de ce qu’il venait de faire, mais n’en était nullement
impressionné. Dans sa mentalité de sénégalais il savait avoir
mérité le châtiment suprême et il s’attendait à être fusillé
séance tenante… Je n’avais pas à me plaindre de ce tirailleur ;
il était en général doux comme tous les sénégalais ; il est
de race « Baoulé » tout à fait primitif, rancunier et
n’extériorisant jamais les sentiments pour ou contre quelqu’un.
Les accidents de ce genre se produisent quelquefois ; d’habitude
la répression suit immédiatement l’acte, car en principe le
tirailleur s’enfuit avec ses armes et on est obligé de l’abattre
pour en venir à bout… Dumesnil est un récupéré, il donne
l’impression d’un faible et d’une intelligence très ordinaire.
Il est possible qu’il ait fait une réflexion à Attien-Bobé du
genre de celle dont ce dernier se plaint. Je ne crois pas que le
tirailleur n’ait pas pu manger avec les restes des européens,
d’ailleurs il ne m’a jamais été rendu compte de quoi que ce
soit de ce point de vue.
CG de la 87è DI ,
29 août 1917 : notes d’audience
Attien-Bobé :
« J’ai tiré sur Dumesnil parce que j’étais resté 3 jours
sans manger. Je ne voulais pas tirer sur le sergent Lecalard, mais
sur Dumesnil. Après la scène je n’ai pasdit qu’on devrait me
tuer tout de suite. Je n’ai appris la mort de Lecalard qu’il y a
deux jours. Dumesnil m’avait dit qu’on me fusillerait si je ne
travaillais pas.
Lt Pestre, 1er
témoin : « Attien restait 3 mois à la popote. Ne s’est
jamais plaint de ne pas manger à sa faim…
Caporal Gérault :
« avant la scène il a dit à table devant tout le monde qu’il
y avait 3 jours qu’il n’avait rien eu à manger. »
Sergent Brindejoue :
Souvent Lecalard disait à Attien de manger. Il répondait toujours :
moi y en a plein.
Le sergent Lecalard,
décédé à l’hôpital 52 le 3 août 1917 à 22h15, est déclaré
Mort pour la France à Mont Notre-Dame (Aisne) par suite de blessures
de guerre.
Recours en révision
rejeté le 3 septembre 1917
Attien-Bobé est
fusillé Au passage à niveau de Jumencourt (Aisne) le 2 octobre 1917
à 8h10 en présence de 3 section du 51è BTS.
Ben Salah Ben
M'Bareck Hassen, dit « Jougar » né en 1890 à
Djebibina (Tunisie), journalier agricole, célibataire, tirailleur au
8è RMT
« L’inculpé,
-bien qu’ayant encouru peu de punitions – est noté comme brutal
et n’obéissant qu’à la force. Il est un bon grenadier et a été
cité en 1916 à l’ordre du régiment. » Croix de guerre.
Ce tirailleur
d’après divers renseignements aurait été condamné dans la vie
civile et sortait du pénitencier sz Gougar (Tunisie) d’où le
surnom qui lui était donné à la Cie.
CG de la 38è DI (25
août 1917) : Le 23 juin 1917, à Lhuys, [le caporal Doulcet]
mangeait sa soupe au cantonnement avec plusieurs camarades dont le
caporal Darmendrail. Il a vu tout à coup le tirailleur Hassen ben
Salah -l’accusé- descendre de la grange avec son fusil à la main,
poursuivant un autre tirailleur. L’accusé était très surexcité :
le caporal Darmendrail, voyant qu’il allait faire un malheur, s’est
précipiter sur lui pour le désarmer, pendant que l’autre
tirailleur s’enfuyait. L’accusé s’est retourné contre le
caporal Darmendrail en disant « Lachez-moi » ; puis
il a tiré un coup de fusil à bout portant sur le caporal
Darmendrail et l’a tué net. Le caporal Darmendrail est tombé en
criant : « A moi Doulcet » et il est mort
immédiatement. L’accusé s’est enfui ; une patrouille a été
chargée de le ramener.
Quand il a entendu
un coup de feu, le sergent fourrier Ferro s’est précipité pour
voir ce qui se passait. Il est arrivé juste comme le caporal
Darmendrail tombait et il a vu s’enfuir un grand tirailleur. Le
témoin a été commandé pour aller à la recherche de l’accusé
avec une Patrouille en armes. La Patrouille commandée par lui a
recherché l’accusé aux environs et a fini par l’apercevoir dans
un champs de blé. Le témoin l’a sommé de jeter son fusil et de
se rendre. L’accusé s’est couché et a tiré six balles sur la
patrouille ; le témoin avait fait coucher ses hommes. Il a bien
entendu les balles siffler autour de lui. Personne n’a été
atteint mais le témoin affirme que l’accusé a bien tiré sur la
patrouille. Il ajoute que l’accusé a tiré une 7è balle sur
lui-même et s’est blessé [à l’abdomen] L’accusé a fini par
crier au témoin [en arabe] : « tu peux venir, je n’ai
plus de cartouches ». La première parole de l’accusé au
témoin a été pour lui demander si le caporal Darmendrail était
mort…
Le tirailleur Salah
ben Ayed -serment prêté sur le Coran- déclare qu’il jouait aux
cartes avec d’autres tirailleurs et que Hassen nettoyait son fusil.
Tout d’un coup il descendit de la grange avec son fusil,
poursuivant le témoin qui ne sait pas pourquoi l’accusé l’a
ainsi poursuivi. Il affirme n’avoir eu avec l’accusé aucune
relation immorale. Le témoin a vu le caporal Darmentrail
s’interposer…-puis un coup de feu a été tiré et le témoin a
vu le caporal Darmentrail tomber.
Le témoin Salah ben
Béchir était à l’infirmerie le 23 juin 1917 au soir quand on a
amené le tirailleur Hassen sur un brancard… L’accusé à ce
moment a reconnu avoir voulu tuer un tirailleur qui lui servait de
femme [-déchirure du papier- par jalousie parce que le pre]mier
l’avait trompé avec un autre ; qu’il l’avait poursuivi
avec son fusil et qu’il avait tiré sur le caporal qui s’était
interposé. L’accusé a dit avoir tiré en l’air au moment où il
était poursuivi par la patrouille. Il a déclaré enfin qu’il
avait tenté de se tuer.
L’inculpé
interrogé à la suite de chacune de ces dépositions persiste à
nier tout ce qui lui est reproché.
Rapport :
« Personne n’a pu nous confirmer les faits d’immoralité
qui ont été la cause de ce drame ; les deux tirailleurs Salah
ben Ayed et Ramdan Bendalah ont nié avoir jamais eu de relations
immorales, le premier avec l’inculpé, et Ramdan avec Salah. Mais
il résulte de la déposition de l’infirmier Salah ben Béchir que
l’inculpé a avoué lui-même avoir voulu tuer Salah ben Ayed parce
qu’il le trompait avec Ramdan... Après avoir été en traitement à
l’hôpital pour la blessure qu’il s’était faite, [Hassen] a
été ramené au corps puis incarcéré. »
24 juin, première
déclaration d’Hassen au corps avant rétractation : « Depuis
longtemps mon camarade Salah ben Mahmoud me servait de femme ;
au début du ramadan il refusa de continuer ses relations, malgré
les grosses sommes d’argent que je lui avais données. Trouvant
drôle ce refus, je le surveillais et m’aperçus qu’il
entretenait des relations avec un autre tirailleur Ramdan. Je résolus
de le tuer, et pris de jalousie, je ne ma rendis pas compte de ce que
je faisais, atteignant le caporal qui voulait nous séparer. Je
partis ensuite avec l’intention de me tuer. Je n’avais pas
l’intention de tuer le caporal et je regrette qu’il ait été
atteint. »
Recours en révision
rejeté le 30 août 1917. Recours en grâce rejeté ce même jour.
Hassen est fusillé
à Droisy (Aisne) le 5 octobre 1917 à7h, coup de grâce dans la
tempe droite.
Malek M’Hammed
Ould, né en 1886 dans la région d’Oran, soldat au 2è RMTA
est décédé à Bezonvaux (Meuse) le 11 octobre 1917. Aucun
renseignement n’étant connu ni même sa fiche de décès, d’où
provient l’information ?
Embarek
Kaddour-Ould, présumé né en 1897 à
Ouled-Chani (Maroc), berger à Bergent, célibataire, chauve,
cicatrice à l’épaule droite, 2è Régiment de Spahis, 5è
escadron, condamné en juin 1916 par le CG d’Ortan pour dissipation
d’effets militaires à lui confiés pour le service et en mars 1917
pour désertion à l’ennemi et abus de confiance. Au moment des
faits Kaddour subit une peine de 60 jours de prison pour être entré
en brisant une vitre dans une maison particulière au cantonnement à
Ménil vers 22h, non pour voler mais pour une affaire de femme.
CG de la 15è DI C
(11 septembre 1917) : Faits survenues le 30 août 1917 vers 11
heures à Doncières (Vosges) sur la route de Rambervillers.
Kaddour : Je
reconnais avoir tué et violé la dame [Berthe
Blaise, 32 ans, 3
enfants, épouse]Morel.
Je suis allé sans penser à quoi que ce soit me promener. j’ai
rencontré cette femme. Je lui ai fait des propositions, elle n’a
pas voulu, elle s’est défendue ; je l’ai terrassées en
l’attrapant par le cou. Je ne lui ai pas tenu les mains. Je lui ai
donné un coup de poing. Je l’ai violée. Je ne me souviens pas si
c’est complètement. Je n’en suis pas sûr. Je me rappelle avoir
satisfait mes besoins. Je lui ai relevé les jupes et je lui ai
introduit mon membre viril. Quand je l’ai violée elle n’était
pas encore morte. Je l’ai violée dans le bois après l’avoir
étourdie sur le chemin. Quand elle a perdu connaissance, je l’ai
traîénée dans le bois où je l’ai violée puis je l’ai achevée
en l’étranglant avec les deux mains. Je suis sûr de l’avoir
étranglée avec les deux mains. Je m’en souviens très bien. Je
suis sûr de n’avoir pas mis de fichu au cou de la femme. Quand je
suis parti la femme ne bougeait plus du tout. Je n’ai pas pris son
porte-monnaie. Si je l’avais pris, je l’aurais dit. j’ai eu
peur qu’elle me dénonce c’est pourquoi je l’ai achevée. Je ne
lui avais jamais parlé avant. Je n’avais rien entendu dire sur
elle...J’aurais avoué depuis le début si deux de mes camarades ne
m’avaient pas conseillé de nier. »
3è brigadier
Demouché : « Le lendemain matin, j’ai fait l’appel
des hommes ; il s’est levé et à ce moment j’ai remarqué
des égratignures sur son visage : il m’a dit qu’il s’était
battu avec un camarade spahi ».
Kaddour :
« C’est à midi seulement que je lui ai dit que j’étais
monté dans un arbre »
« le conseil
condamne Kaddour à 4 voix contre une à la peine de mort ».
Camp de Tremblay,
près d’Haudainville (Meuse) le 13 octobre 1917 à 6h30 :
« trois balles au coeur et 5 autres dans la poitrine et au
ventre. La mort a été instantanée. »
Mort pour la France,
la fiche portant comme seule mention du genre de mort « Disparu »
Jean Garret, né le 12 avril 1888 à Nohanent,
près de Clermont, soldat au 38è R.I.
En juin 1911, alors qu'il effectuait son service
militaire à Roanne depuis 18 mois, il a déserté ; cinq jours après, il
fut arrêté puis condamné par le Conseil de guerre permanent du 13e C.A.
de Clermont-Ferrand, à un an de prison avec sursis. Au moment du
conseil de révision, il s'était déclaré cultivateur et mesurait 1,71 m. De retour à la vie civile, il est condamné en 1912 à Riom pour "outrages publics à la pudeur",
puis le 5 septembre 1914, à Bourges, pour vols à trois mois et un jour
de prison ; il ne rejoint pas son régiment au moment de sa mobilisation
en janvier 1915 ; en avril 1915, il est condamné pour vol par le
tribunal de Riom, puis en juillet par celui de Limoges pour le même
motif ; il est affecté au Groupe spécial du 92e RI,
rassemblant à l'arrière, les mobilisables ayant un casier judiciaire ;
en mars 1917, il est condamné par la Cour d'appel de Nîmes pour "coups et blessures, port d'arme prohibée, usurpation d'identité"
à deux ans de prison ; il subit une nouvelle condamnation en juin 1917 à
Riom pour vols : il est relégué (c'est-à-dire désigné pour aller dans
une section d'exclus métropolitains) ; Jean est finalement déclaré « déserteur »
le 22 septembre 1917 ; le 18 octobre, il est tué à Chamalières, à 29
ans, lors d'un échange de coups de feu avec les agents de la police
mobile de Clermont-Ferrand.
Louis Raphaël
Pérenin, né le 15 juillet 1886 à Rennes, peintre en bâtiment,
résidant à Sèvres chez ses parents, puis à Castelsarrazin,
célibataire, 2è classe au 3è BMILA
Motif de punition,
le 17 février 1913 : « Chargé de faire une réparation
dans une chambre inoccupée, a été trouvé brodant un mouchoir »
(8 jours)
« Le 10 mai
1917, le chasseur Pérenin quittait sans autorisation , à Marseille,
le détachement de renfort dont il faisait partie, et restait en
absence illégale jusqu’au 20 mai, date à laquelle il était
arrêté, à Paris, par la garde républicaine. Ramené à son corps…
Pérenin s’enfuyait de la section spéciale, qui se trouvait alors,
en ligne, dans la tranchée dite « Ouvrage des russes ».
Il abandonnait son poste en présence de l’ennemi, dans la nuit du
10 au 11 juin, au cours d’une corvée de transport de matériel, et
gagnait l’arrière. Il était arrêté par la gendarmerie, le 21
juin 1917, dans le Calvados. Conduit à Caen et écroué dans les
locaux disciplinaires, il parvenait à s’évader dans la nuit du 23
au 24 juin, en descellant deux barreaux d’une fenêtre. Il était
arrêté de nouveau, au Havre, le 7 août 1917. Il avait, en résumé,
en moins de trois mois, abandonné son poste en présence de
l’ennemi, déserté deux fois à l’intérieur, et une fois en
présence de l’ennemi.
Pérenin est un
détestable soldat dont toute la conduite prouve qu’il est
absolument décidé à ne pas remplir ses devoirs militaires ;
pendant la guerre, il n’a passé en tout, que deux mois au front ;
c’est un véritable professionnel de la désertion, puisqu’il a
déjà été condamné trois fois pour ce délit, en 1908, 1910 et
1914 ; dès qu’il est renvoyé au front, il déserte, de
nouveau, pour ne pas aller se battre, et, au total, depuis qu’il
est soldat, on relève à sa charge six désertions et un abandon de
poste. »
En juin, Pérenin
déclare être parti, vers 3 heures du matin, alors que la corvée
était terminée en compagnie de deux camarades, voire trois :
les chasseurs Cornet de sa section, Lebailly et Clausse s’étant
joint à eux. Les officiers se renvoient la balle, invoquant des
heures différentes, mais ne peuvent nier finalement que 4 hommes se
soient évadés. Ils ont pris le train de Fismes à Paris. Il se
présente chez sa mère à Sèvres, avec deux camarades, où ils
déjeunent avant de s’en aller et de laisser sa famille sans
nouvelles. « Puis, je suis allé en Normandie où j’ai
travaillé comme peintre dans la journée et le soir comme artiste
dramatique… J’ai été arrêté le 21 juin à Condé sur Noireau
et conduit de là à Caen où on m’a enfermé avec mes camarades
Cornet et Lebailly dans la salle de police de la caserne d’infanterie
au rez-de-chaussée. Nous avons sauté par la fenêtre, puis nous
nous sommes séparés. Je suis allé au Havre où j’ai continué à
exercer ma profession ». ».
CG de la 45è DI,
recours en révision rejeté le 17 septembre 1917, recours en grâce
rejeté le 17 octobre.
Pérenin est fusillé
au Champ de tir à 300m au nord-est de Cramant (Marne), près du
cimetière, le 19 octobre 1917, 6h, en présence de 10 pelotons de
chasseurs et tirailleurs.
Cyrille Florimond
Bizard, né le 30 mai 1884 à Avesnes-lès-Bapaume (Pas de
Calais), soldat au 1er régiment de Zouaves
Décédé à
Graffigny (Haute Marne) le 23 octobre 1917 « tué par un
tirailleur alors qu’il cherchait à s’évader du camp
disciplinaire ».
Novembre
Jean
Claude Gallet, né le 28 avril 1894 à Chambéry,
charbonnier, célibataire, 2è classe au 30è R.I., 2è Cie, n’a
encouru aucune punition militaire.
Il ressort de
l’instruction que les faits de refus d’obéissance en présence
de l’ennemi le 11 mars ne sont pas établis ; mais Gallet est
accusé d’avoir
- à Lignières le
12 mars 1917, abandonné son poste pour n’avoir pas rejoint sa Cie
aux tranchées de première ligne,
- entre le 20 et le
25 mai 1917 [sans autre précision, tous les gradés de l’époque
qui auraient pu en témoigner ont été soient tués, soit faits
prisonniers, soit portés disparus] à la tranchée d’Amiens,
secteur de Cerny, abandonné son poste pour n’avoir pas suivi ses
camarades qui se rendaient au travail en première ligne,
- déserté à
l’intérieur pour s’être absenté de son corps cantonné dans un
secteur de Meuse (camp de la Béhole), du 30 septembre au 3 octobre
1916, date de son arrestation à Paris, [c’est ensuite qu’il
travaille environ cinq mois à l’usine d’aluminium à Chambéry ;
il s’en enfuit redoutant une arrestation imminente ;après
avoir été appréhendé à Lyon [ce dont aucun PV ne témoigne, mais
Gallet avoue une 6è désertion non décomptée, faute de preuve. Il
se serait rendu à Marseille, - pour voir une marraine, dit-il une
seule fois, pour se promener laisse-t-il échapper ensuite - ]
- déserté à
l’intérieur en temps de guerre pour s’être absenté de son
corps cantonné dans un secteur de Somme, jusqu’ au 5 février
1917, date de son arrestation à Tarascon [où Gallet ment aux
gendarmes prétendant n’être en fuite que depuis le 1er
février]
- déserté à
l’intérieur pour s’être absenté de son corps cantonné à
Villers (Somme) du 28 février au 5 mars 1917, date de son
arrestation par la gendarmerie à Lyon,
-déserté à
l’intérieur pour s’être absenté de son corps, en ligne dans un
secteur de Somme du 12 mars 1917 au 12 mai 1917, date de son
arrestation par la gendarmerie de Chambéry,
- déserté à
l’intérieur au Chemin des Dames, du 23 mai 1917 au 15 juin 1917,
date de son arrestation par le commissaire spécial des gares à
Lyon,
- le 12 mai 1917, à
Chambéry, porté publiquement le costume de soldat au 3è Régiment
de Zouaves sans en avoir le droit,
- en 1917, à Paris
et à Chambéry, fait sciemment usage d’une feuille de route
fabriquée ou falsifiée.
D’une certaine
façon Gallet a réussi à défier la logique militaire, puisqu’il
a fallu plusieurs ordres d’informer avant d’arriver à un
résultat judiciaire quelconque et qu’une grande partie de ses
activités pendant sa plus longue absence demeure obscure, ne
reposant que sur ce qu’il consent à en avouer et dont personne ne
peut évaluer la véracité.
Jules Delétraz, le
caporal que Gallet trompa en montant de Lignières à Marquivillers
le 12 mars : « Le soldat Gallet en est à sa 3è
désertion. A chacun de ses retours, ce militaire avait manifesté
hautement son intention de déserter et au besoin de passer à
l’ennemi disant qu’il ne resterait jamais en première ligne. Il
cherchait par ses propos à démoraliser ses camarades et était gêné
par leur mépris ».
CG de la 28è DI (13
septembre 1917) :
Gallet : « Si
j’ai commis toutes les désertions qui me sont reprochées, c’est
que je n’avais pas revu mon frère depuis le début de la guerre,
ni mon père, et que ma mère est âgée et infirme. Comme il n’y
avait personne à la maison qui puisse travailler, j’ai voulu venir
en aide à ma mère. C’est pourquoi je suis allé notamment
m’embaucher à l’usine d’aluminium de Chambéry. En ce qui
concerne l’abandon de poste du 12 mars 1917, voici ce que j’ai à
dire : on est venu me chercher à Lignières pour aller à
Marquivillers. On m’avait dit que mes camarades étaient en ligne à
Dancourt. En cours de route j’ai faussé compagnie au caporal qui
m’accompagnait, sous prétexte d’aller aux feuillées. Je
reconnais que j’ai quitté ma Cie en mai 1917, à Cerny, au lieu
d’aller au travail en ligne. Si j’ai agi ainsi, c’est que
j’étais fatigué. Je dois ajouter que pendant mon séjour à
Chambéry, j’ai rencontré un zouave. Nous avons changé
d’uniforme. Je pensais être ainsi moins facilement reconnaissable.
Il m’a donné un titre de permission en blanc qu’il a établi à
mon nom. Je ne le connaissais pas. J’ai passé une journée avec
lui. J’assume la pleine responsabilité de mes actes. »
Avis du général
Graziani commandant le 28è DI (15 septembre 1917) : « Le
soldat Gallet a été condamné à la peine de mort à l’unanimité
des voix. A l’issue de l’audience, l’avocat a présenté en
faveur du condamné un recours en grâce que deux des juges ont
signé. Je ne vois, à la rigueur, comme considérations pouvant
militer en faveur de Gallet que sa situation de famille… Par
contre, après avoir subi une condamnation pour vol avant son
incorporation, il a abandonné 2 fois son poste et déserté 5 fois,
prouvant ainsi qu’il était décidé, ainsi qu’il l’a déclaré
lui-même, à ne pas se battre, en ayant assez de la guerre. Dans ces
conditions, je ne puis m’associer à la demande de recours en grâce
en faveur du soldat Gallet. »
Gallet, 30 août
1917 : « Je n’ai rien à dire pour ma défense, si ce
n’est que je ne veux pas me battre »
Recours en grâce
rejeté le 30 octobre 1917.
Gallet est fusillé
à la sortie nord de Juvigny (Aisne) le 2 novembre 1917 à 6h30.
Maguinguiny né
en 1894 à Kirhine (Ouralou, Sénégal), cultivateur, marié, deux
enfants, tirailleur au 81è bataillon sénégalais
Le 8
septembre 1917, à l’armée d’orient, , le sergent indigène
Toumani Bakaïro, ayant à commander une corvée de ravitaillement se
rendit à la tente où couchaient les tirailleurs Maguiguiny et
Mohama-Lia. Celui-ci ne sortit de la tente qu’après plusieurs
injonctions, et comme il apportait une grande mauvaise volonté à
exécuter l’ordre donné, le sergent le poussa de la main pour le
faire aller plus vite. A cet instant Maguinguiny, arrivant par
derrière, gifla le sergent. Un caporal indigène surgit pour
l’empêcher de continuer. Il fut lui-même attaqué par derrière
par le tirailleur Maï qui lavait du linge non loin de là.
L’adjudant Ferrou arriva sur les lieux et ordonna à Maguinguiny et
Maï de le suivre. Maguinguiny le repoussa brutalement, puis il se
retourna contre le sergent européen Riol qui survenait à son tour.
Il décocha à ce sous-officier un coup de poing qui fit tomber son
casque. Le rapporteur présente Maï comme le plus dangereux des
deux, Maguinguiny subissant son influence. Selon Maguinguiny, il
n’aurait levé la main que pour saluer et aurait été giflé deux
fois par deux des gradés. Malheureusement pour eux, de nombreux
témoins, tant européens que sénégalais disent avoir vu les voies
de fait, et Maï lui-même frapper deux des gradés. On s’étonne
que ce dernier n’ait pas été inculpé avec son camarade ; de
fait il n’avait frappé que le caporal indigène. Maguinguiny,
selon les gradés de la 3è Cie aurait été le meneur des
tirailleurs Haoussas du bataillon.
CG de
la 17è DIC (16 octobre 1917)
Adjudant-chef
Mouthon (qui aurait été frappé par Maï à la 3è Cie, avant
que Maguinguiny et lui ne soient déplacés à la 2è) : « Le
tirailleur Maguinguiny de même que Maï sont des mauvais sujets et
des meneurs dangereux, très écoutés de leurs camarades. Ils ont
réussi à deux reprises à mettre en état de révolte plusieurs de
leurs camarades ».
Pas de pourvoi en
révision, grâce présidentielle rejeté le 7 novembre 1917
Maguinguiny est fusillé àIven (Serbie) Camp
de Mortreuil le 12 novembre 1917 à 7h30
Adolphe Rémi Victorien Coudre, né à Canchy (Somme) le 8 mai
1894, cultivateur à Gaillon (Eure), 2è classe au 84e R.I. Le 5
novembre 1908, Adolphe Coudre est condamné pour vol ; acquitté
pour avoir agi sans discernement, il est envoyé dans une colonie
pénitentiaire jusqu’à sa majorité. En 1912, à Mantes il est à
nouveau condamné à trois mois de prison pour vol. Relevé de
punition : au 166è R.I. « s’est rendu coupable d’un
vol de harengs saurs (24 environ) à la gare de Lessay dans
l’après-midi du 26 décembre 1916. Le 6 septembre 1917 :
« n’a pas pris part à la relève avec sa section qui montait
en 1ère ligne, s’est réfugié toute la nuit dans un abri de
l’arrière. S’est présenté à la visite le lendemain et a
obtenue la mention « Consultation insuffisamment motivée ».
Rapport du chef de Bataillon Marminia : « Le 11 septembre
1917, dans la matinée, un vol de 85 francs a été commis au
préjudice du soldat Lis, de la Cie Hors-rang du 284è R.I. dans les
conditions suivantes : depuis 2 ou 3 jours, un soldat ne
portant pas de numéro de régiment venait passer une grande partie
de la journée dans le bivouac de le C.H.R. Il allait de cuisine en
cuisine, causiat aux cuisiniers, mais s’attachait plus volontiers
au soldat Lis, cuisinier des téléphonistes. Lis, croyant avoir
affaire à un camarade du régiment voisin l’accueillit aimablement
et le fit entrer dans son abri. D’ailleurs cet homme ne paraissait
pas avoir une allure suspecte. Il s’était nommé, Coudre Adolphe,
actuellement en traitement à l’infirmerie du 84è, situé à 400m
de là. Il était tenu, disait-il de se présenter deux fois par
jour, à 8h et à 15h à la visite médicale. Il quittait en effet un
peu avant les heures indiquées son camarade lis et était de retour
auprès de lui, une heure après environ. Le 11 septembre, de retour
de la visite médicale vers 9h30, Coudre, porteur d’un certain
nombre de paquets de cigarettes Bastos s’offrit à céder plusieurs
paquets au soldat Lis. Au moment où ce dernier entrait dans son abri
pour y prendre son portefeuille afin d’en régler le montant,
Coudre disparaissait subitement. Le portefeuille, dont Coudre
connaissait sans doute l’emplacement était vide. D’après les
déclarations du soldat Lis, son portefeuille devait contenir la
somme de 85 francs… Fouillé en présence du sous-lieutenant
Rabache, des soldats Lis, réal, Deguin, Coude a été trouvé
porteur de 7 paquets de cigarettes bastos et dans la poche intérieure
gauche de sa veste d’une enveloppe cachetée contenant la somme de
70 francs, dont il ne peut indiquer la provenance… le billet
légèrement déchiré reconnu par le soldat Lis [auquel] l’argent
a été restitué. »
Le 11 septembre vers 14h30 le commandant de la 9è Cie reçut le
message téléphoné suivant : « Le soldat Coudre a été
retrouvé ce marin à la C.H.R. du 284è, en était d’ivresse et a
de plus volé un portefeuille contenant 85 francs. » ce même
jour le commandant de la 9è Cie infligea à Coudre une punition de 5
jours au motif « abandon
de poste en présence de l’ennemi pendant la période du 30 août à
1h45 au 31 août à 6h, et désertion en présence de l’ennemi du 8
septembre à 19 heures au 11 septembre à 12 heures ».
CG de la 122è DI (audience du 3 octobre 1917)
Fernand Roux, caporal à la 9è Cie : « Je suis le chef
d’escouade de Coudre. Dans la nuit du 30 [dans la région de Szka
di Legen (Grèce)], vers 1h30 on a rassemblé la section pour aller
en renfort de la 10è Cie. On a fait l’appel des hommes. Coudre se
trouvait à sa place lors du départ. Mais tout de suite après, je
me suis aperçu qu’il manquait. Il n’a pas prit part à l’attaque
avec nous. Dans la nuit du 5 au 6 septembre, alors que nous marchions
pour une contre-attaque il disparut encore se disant malade. Le
lendemain désigné pour remplacer deux guetteurs tués, il refusait
d’y aller, se disant malade.
Sur demande : En toutes circonstances Coudre est froussard, il
se défile à chaque fois qu’il y a du danger. »
Coudre est fusillé le 18 novembre 1917 à 7h45 au « Ravin de
la source » d'Izvor (Macédoine).
Eugène
Tirard-Guy, né le 9 janvier 1883, à Saint Bueil. Tisseur,
chasseur de 2è classe au 1er BMILA. Engagé volontaire (par 3 fois).
" A reçu un certificat de bonne conduite ". Déjà
condamné au civil 4 fois pour vol, grivèlerie, filouterie
d’aliments et à 10 ans de travaux publics pour désertion,l e 7
avril 1916, par le CG de la 16ème DIC.
Le 23 juin 1917,
sa Cie étant en ligne Tirard quitte la corvée de ravitaillement une
fois arrivé aux cuisines et s’enfuit vers l’arrière. Il
séjourne environ trois semaines à Brest avant de partir pour
l’Isère. Arrêté le 20 juillet à St Germain des Fossés dans
l’Allier il donne une fausse identité. Mis en prévention de CG,
il s’évade de la section spéciale du G.B.A. dans la nuit du 16 au
17 août. Il prétexte des coliques. Quand il s’enfuit la
sentinelle tire sur lui sans le toucher. Peu connu à la Cie où il
n’était arrivé que le 2 juin « mais ce court délai a suffi
pour qu’il s’y fasse, d’après son commandant, une réputation
redoutable de meneur ». Condamné pour vol au civil et le 7
avril 1916, à 10 ans de détention pour désertion en présence de
l’ennemi, il venait de voler le porte-monnaie d’un civil qui lui
avait offert à dîner quand il a été arrêté. C’est d’ailleurs
la plainte de ce dernier que Tirard a été appréhendé à Vaisne
dans l’Isère le 28 août.
Tirard est
ondamné à mort par le CG de la 45ème DI, le 28 septembre 1917,
pour abandon de poste et désertion en présence de l’ennemi.
Tirard, le 10
octobre au Commissaire du gouvernement : « Je viens
solicité de votre haute bienveillance de bien vouloir par pitié
avoir la grande bonté de m’apyer ma lettre auprès de M. le
Président de la République pour que mon recour en grâce soit
accepter car je vous jure du fond du coeur que je regrette
sincèremants les fautes que j’ai commis. Je vous en prie donc s’il
vous plaît… accorder moi quelques indulgences je vous en suplie
faite le pour mon pauvre père et pour moi ancien soldat de carrière
ainsi que pour mon frère tué pour nôtre plus grande Patrie. Je
viens aussi vous avoué que j’ai agit dans des moments de
faiblesses d’oublie et principalement par l’entrainement dont
j’en suis la victime je vous le jure il y avait exactement 7
ans que je n’avait pas vu mon pauvre père aveugle et ancien
Retraité qui était si
heureux de me voir poursuivre ma carrière militaire c’est pour lui
faire plaisir que j’ai passé toute ma jeunesse en servant mon
Drapaux avec honneur et fidélité que ce soit en France et
principalement aux Colonies sous les maladies. Et les colonies dont
j’ai fait parties puisque j’arrive à rassemblé 13 année de
service dont 16 campagnes de guerre Coloniales dont 3 décorations
commémoratives. Je vous jure que je l’est fait de très bon coeur
et une très bonne conduite au Début mais malheureusement que
l’entrainement ma entrainer à faire toutes c’est maudites fautes
dont je regrette amèrement croyez-le... »
Le 16 et le 18 septembre
Tirard au même dans les même termes pour tenter d’obtenir des
circonstances atténuantes, la seule différence étant qu’il
invoque les séquelles des maladies coloniales comme mobile à son
« moment d’oubli ».
Le recours en
révision rejeté le 3 octobre 1917, rejet de grâce présidentielle
le 16 novembre 1917.
Fusillé le 19
novembre 1917, au « Réduit de Chenay » à Merfy (Marne)
en présence de 4 peloton du 1er BMILA, 4 pelotons du 3è,
2 pelotons du 1er RMT
Pascal Virgile
Damien Fabre, né le 4 janvier 1917 à La Verdière (Var),
113è R.I.
« Tué par une
sentinelle ; avait contrevenu aux consignes pour sortir du
camp » le 21 novembre 1917 au Souk El Tleta (Maroc) le 21
novembre
Décembre
René Gaston Robert
Minangoin, né le 7 août 1884 à Sétif (Algérie), adjudant du 19è
escadron du train des équipages militaires, détaché à
l’inspection des forges de Paris.
Le rapport
dactylographié sur l’affaire Minangoin occupe plus de 24 pages,
dans lesquelles le rapporteur (Bouchardon lui-même) rivalise avec
Zola dont il cite explicitement le roman Thérèse Raquin comme
source d’inspiration du scénario échafaudé par le criminel.
« Le 24 avril
1909, Minangoin, alors dessinateur au chemin de fer de l’État,
épousait sa cousine, Yvonne Peignez, fille d’un chef de bureau en
retraite à la même Compagnie. « Je n’ai jamais eu de lune
de miel, » dira plus tard d’elle-même Mme Minangoin à sa
parente, Mme Leplat. »
Son mari se révèle
très vite autoritaire et violent. La naissance de leurs deux enfant,
Gaston et Odette ne font qu’accentuer ses défauts. Il les
terrorise et les bat sous les prétextes les plus futiles. A
l’extérieur au contraire, pour les concierges et les voisins, il
joue une comédie de père aimant, ne manquant jamais une occasion
d’embrasser sa femme en public, de proférer des cajoleries et de
la couvrir de toutes les prévenances qu’aurait un véritable
amoureux. Mobilisé à Villiers en août 1914, il profite de cet
éloignement pour prendre pour maîtresse une fille publique.
Lorsqu’il est rappelé à l’usine Bellanger de Neuilly, il tombe
soudain follement amoureux d’une jeune aide-contrôleuse de 21 ans,
Germaine Ferlay. Cette dernière lui permet certaines privautés,
tutoiement, promenades en commun, baisers sur la bouche, tendres
appellations, mais rien de plus. Elle ne cesse de lui rappeler qu’il
n’est pas libre, et refuse de devenir sa maîtresse, quoique tous
le personnel de l’usine soit convaincu du contraire. Il lui glisse
des billets au travail, tel celui-ci : « Ma petite
Maimaine, je t’aime éperdument. Pourquoi trouves-tu que mon amour
est de la folie ? Il faut absolument que tu sois à moi, que
nous vivions ensemble et ne nous séparions jamais ». Rien n’y
fait. La vie conjugale avec Yvonne devient un véritable enfer, dont
celle-ci s’ouvre par lettre à ses parents et à sa cousine. Ne
pouvant subvenir aux besoins de ses enfants, elle reste au domicile,
songeant maintes fois à fuit, mais refusant toujours d’accorder le
divorce à Robert qui enrage. Le jeudi 3 mai au matin, elle écrit à
ses parents : « J’ai tant souffert et mes enfants ont
tellement besoin de leur mère qu’il faut que je reprenne courage…
Pour qu’il ne puisse déjà faire des projets avec la contrôleuse
qui lui est si chère, je lui ai simplement demandé s’il voulait
que nous allions vous voir pendant les quatre jours qu’il va avoir
le 15 mai, sans lui dire mon intention de rester ».
débarcadère de la maison Maréchal
Le 3 mai dans
l’après-midi, Minangoin, habillé de vêtements civils conduit sa
femme et ses enfants à Vilennes et s’embarque sur un bateau plat
loué au restaurateur Maréchal ; la promenade s’est décidée
tard car Mme Minangoin, qui n’aime pas le canotage, aurait préféré
répondre à l’invitation de sa cousine d’Asnières. Vers 19
heures, la barque n‘étant pas revenue, Maréchal se lance en
exploration et découvre le bateau à 350m en amont du restaurant,
amarré à un arbre qui surplombe la berge escarpée, haute de plus
de 3 mètres en cet endroit. Cette nuit-là Minangoin rentre seul à
son domicile à La Garrenne-Colombes. Dès le lendemain il dit à une
des vérificatrices de l’atelier où il travaille : « Ma
femme m’a quitté pour aller avec les enfants chez ses parents, aux
Mureaux » et il fait remarquer à une des contrôleuses qu’il
ne porte plus son alliance : »Vous voyez, je suis libre,
je ne suis plus marié. » Le 7 mai, Minangoin se rend chez sa
voisine Mme Pascal, et lui raconte qu’elle l’a quittée. Il la
prie d’écrire aux Mureaux afin de plaider sa cause et de lui
demander de revenir. Il lui raconte qu’il vient d’acheter une
bouteille de vin fortifiant pour que sa femme anémique reprenne des
forces dès qu’elle sera rentrée, et dit qu’il a rangé toute la
maison pour satisfaire au coût de l’ordre d’Yvonne. Il repasse
tous les soirs quémandant une potentielle réponse. Le 8 mai il
envoie une lettre antidatée du 6 à se beaux-parents qui se trouvent
à Saint-Gervais dans laquelle il explique que pendant la promenade
en barque a éclaté une scène terrible qui l’a obligé à
descendre du bateau et à rentrer seul : »Elle devait,
m’a-t-elle dit, continuer sa soirée avec les enfants et rentrer le
soir aux Mureaux… Je viens d’aller voir sa seule et sincère amie
Mme Pascal, pour lui demander de lui écrire, de la prier de revenir.
Mme Pascal est convaincue qu’elle a dû partir le lendemain à
Saint-Gervais ». Le 13 mai, Minangoin expédie à la gare des
Vallées et à destination des Mureaux, une grande malle contenant le
linge et les vêtements des siens, afin que ces êtres chers ne
manquent de rien. Quelques jours plus tard il retourne à Villennes,
au restaurant Maréchal sous prétexte de payer la location du 3 mai
et demande avec insistance au patron de reconnaître par écrit que
le soin de ramener l’embarcation incombait à Mme Minangoin. A quoi
aréchal répond : « Allez-vous en, monsieur, tout cela me
semble très louche. »
Durant la même
semaine, il redouble de prévenances envers Germaine Perlay, mais
exclusivement en dehors de l’usine où il tente de convaincre ses
pairs qu’il n’y a jamais rien eu entre eux. Plusieurs soirs de
suite il donne des leçons de bicyclette à Germaine au bois de
Boulogne, utilisant le propre vélo de sa femme.
Le 14 mai, Henri
Peignez, frère d’Yvonne s’inquiète de ce qu’il est advenu de
sa sœur. Il se rend à Villeines et comprend que jamais sa sœur
n’aurait pu amarrer seule la barque à l’endroit où elle a été
retrouvée. Le 16 il parle de faire insérer un avis de recherche
dans les journaux, ce à quoi Minangoin s’oppose redoutant qu’une
telle publicité n’entache sa belle réputation. Le 18 mai, les
journaux rapportent que le corps d’un petit garçon a été
retrouvé le 9 mai dans la Seine en aval du barrage de Sandraucourt.
Le 11 c’est le corps d’une fillette qui a été trouvé à
Vaux-sur Seine, enlisé dans un amas de branchages entre une péniche
et la rive. Le 17 mai, les gendarmes de Mantes retirent de la Seine,
au lieu dit « les Crochis », commune de Limay, une noyée
dont l’alliance porte intérieurement l’inscription « Robert
à Yvonne, 24 avril 1909. Le même 18 mai, monsieur Peignez père se
rend à Vaux et reconnaît formellement en la personne de la fillette
noyée sa petite-fille Odette. Minangoin dit à son beau-frère :
« Tu vois, ça ba bien, on les retrouve tous. C’est un
accident, un simple bain de pieds. Ils ont vu un soldat qui en
faisait autent. Ils auront voulu l’imiter après mon départ. »
Le 21 mai, Minangoin
se présente spontanément au juge d’instrucvtion chargé
d’instruire contre X, et lui raconte les faits à sa manière :
« J’ai cru tout d’abord à un suicide, mais d’après les
constatations faites et les conversations que m’auraient rapporté
Mme Pascal, j’écarte cette hypothèse et je ne puis songer qu’à
un accident provoqué peut-être par ce fameux bain de pieds auquel
ma femme paraissait tenir, les trois cadavres ont été retrouvés nu
pieds. » Il oublie que, dans la malle expédiée de 13 mai aux
Mureaux se trouvaient les bas des trois disparus et les chaussures
que portaient les enfants le 3 mai précédent.
Le 23 mai, Le
commissaire de police Gabrielli obtient des aveux que Minangoin
renouvelle devant le juge d’instruction de Versailles qu’il
avauit visité deux jours plus tôt : « Ma femme et mes
enfants étaient assis sur le rebord du bateau, les pieds dans l’eau
d’un côté, je m’étais placé de l’autre pour faire
contre-poids. Je me remis d’un bond debout dans la barque derrière
eux et, dans un mouvement de folie, par simple poussée facilitée
par le déséquilibre du bateau, je jetai à la fois ma femme et mes
enfants dans l’eau. Le courant les emporta et je les vis plonger et
disparaître avant même que j’ai pu songer à essayer de les
repêcher et de les sauver. Ils poussèrent quelques cris étouffés.
Je restai quelques instants comme hébété, puis je regagnait la
rive en prenant leurs bas et leurs souliers ».
la barque occupe le lieu où l'assinat aurait été commis
« De remords,
il n’en a point eu. Quand on l’a ramené devant les lieux où
avaient disparu, dans quelque scène atroce dont il garde le secret,
trois créatures humaines, sa femme et ses deux enfants, pas une
larme n’a coulé de ses yeux, pas un cri de désespoir ne s’est
échappé de ses lèvres. Tous ses sentiments affectifs, il les a
gardés pour Germaine Ferlay. Ses pensées ne sont allées qu’à
elle, et nous n’en voulons d’autre preuve qu’une lettre qu’il
a tenté d’envoyer en cachette de la prison de Versailles. »
3è CG de Paris 4
septembre 1917
Recours en révision
rejeté le 3 octobre 1917
L’adjudant
Minangoin est fusillé à Vincennes le 5 décembre 1917.
Charles Rastello,
né le 26 juillet 1894 à Romans, ouvrier boulanger, chasseur de 2è
classe au 1er BMILA, cumule 9 condamnations civiles pour vol,
escroquerie, infraction à la police des chemins de fer.
Arrivé au 1er
BMILA le 22 mai 1917, par suite d’une désertion antérieure (peine
remise), Rastello quitta le 19 juin vers 4h du matin sa compagnie en
première ligne dans la tranchée Watier (àgauche du boyau de
Seichamps) au moment où approchait son tour de faction. Il est
arrêté dans l’Isère le 25 juin. Le 28 juin, alors qu’on le
ramène au corps, Rastello échappe aux gendarmes en sautant du train
en marche (il s’est foulé le poignet gauche mais travaille comme
cultivateur). Arrêté de nouveau à Romans le 12 juillet, il s’évade
le lendemain à Lyon. Il est rattrapé à Bourg de Péage dans la
Drôme le 23 juillet. Ramené à son corps, il est placé à la
section de discipline qui se trouve alors en ligne. Le 30 juillet,
dans la nuit, il profite d’une corvée de transport de matériel
pour s’enfuir à nouveau. Il est arrêté le 7 août à Mours dans
la Drôme à la suite d’un vol de chevaux. Rastello est ramené à
la 45è DI le 21 septembre 1917. Il est incarcéré et interrogé,
dit qu’il désire racheter ses fautes en combattant. Le soir-même
à 23h30, il s’enfuit avec six autres détenus (Eugène Doremus,
Clovis Binaud, Antoine Lavieille, René Lebailly, Jules Clausse et
Louis Chatelain), en pratiquant un trou dans le mur du local où il
était enfermé.
« Je ne suis
pour rien dans le percement du mur de la prison. Quand je suis
arrivé... le trou était déjà commencé, mais les détenus
replaçait les pierres devant le trou quand les gendarmes faisaient
des rondes ». Soupçonné de s’être dirigé vers Reims dans
l’espoir de passer à l’ennemi, Rastello répond qu’il voulait
y contracter un engagement dans la Légion Etrangère.
Sa dernière
arrestation a lieu le 2 octobre à Villers-Cotterêts, après qu’il
ait donné diverses identités, se prétendant d’abord Steiner, né
en Allemagne. Il argue pour sa défense qu’il a toujours été
entraîné par ses camarades, faisant valoir, sans en apporter la
preuve qu’il a appartenu à la légion garibaldienne.
« Toutes mes
évasions ont eu pour cause la crainte du conseil de guerre. »
CG de la 45è DI,
recours en révision rejeté le 22 octobre 1917
Rastello est fusillé
à la Redoute de Chenay le 11 décembre 1917 à 6h45.
Antoine Laurent
Martinetti, né le 27 janvier 1893 à Petreto-Bicchisano
(Corse), journalier à Ajaccio, célibataire, 5è BMILA, deux
condamnations antérieures
CG du détachement
du sud tunisien (12 septembre 1917) : (Minutes seules) jugé
avec Ferdinand Roux (mort commuée en perpétuité le 18 décembre
1917, commuée en 15 ans de TF en 1925, échappé du pénitencier de
Saint-Laurent en 1926, prescription de la peine le 10 avril 1952)
Clément Eugène Joseph Michel (peine de mort commuée en
perpétuité), Joseph Clément Suty (20 ans de TF), tous du même
régiment.
Le 27 mars 1917, à
Tataouine, Martinetti outrage par paroles et menaces son supérieur
le caporal Masson, avec la complicité de Roux. La nuit suivante,
Martinetti tue le caporal Masson.
recours en révision
rejeté le 18 septembre 1917
Médenine (Tunisie) 7h
Jean Marie Cario, né le 17 mai
1887 à Saint-Tugdual (Morbihan). 2È classe au 4è BMILA. Détenu au
camp de Souk-Arhas (Algérie), il est tué le 21 décembre 1917 au
cours d'une évasion.
Civils
espion fusillé à Reims
(1917?)
Bernardin Paulus
Adrianus Hoefnagel, né le 31 mai 1863 à Amsterdam.
CG du gouvernement
militaire de Paris. Questions du procès tenu à huis-clos :
1- Le nommé
Hoefnagel, sujet hollandais, arrêté à Lyon, le 9 octobre 1916
est-il coupable d’avoir à Clèves (Allemagne) du 31août au 2
septembre 1916, entretenu des intelligences avec l’ennemi en la
personne d’un agent du service d’espionnage fonctionnant dans
cette ville, dans le but de favoriser les entreprises de l’Allemagne…
2- Est-il coupable
d’avoir, le 26 septembre 1916 à Lyon, adressé au moyen d’un
écrit à encre invisible, à un individu qui lui avait été désigné
par l’agent du service de Clèves comme correspondant d’espionnage,
des informations d’ordre militaire …
3- Est-il coupable
d’avoir, du 24 septembre 1916 au 9 octobre 1916 de Paris à Lyon,
tenté de procurer à l’Allemagne des renseignements susceptibles
de nuire à la sécurité des Places, en expédiant à un
correspondant d’espionnage, trois lettres en écriture invisible
contenant des renseignements d’ordre militaire, tels que les
directions prises dans les gares de Dôle, Dijon et Lyon par des
détachements des armées françaises et britanniques ; le
passage d’un train d’artillerie en gare de Laroche, les numéros
d’un certain nombre de bataillons de chasseurs et l’emplacement
de diverses usines de munitions.
Recours
en révision rejeté le 17 avril 1917, pourvoi en cassation rejeté
le 10 mai.
Hoefnagel
est fusillé à Vincennes le 2 juillet à 5h.
Mohammed Ben Saïd
Ammouche, né en 1883 à Douar Chender (Algérie), marié,
cultivateur,vol qualifié et meurtre concomitant
Mohammed Ben
Slimane Hammoun, né en 1886 à Oued-Chender
(Hausonvillers), marié, journalier, vol qualifié, vol simple et
meurtre et vol qualifié concomitants
Slimane Ben Ameur
Bouchelaghem, né en 1890 à Oued-Chender, célibataire,
cultivateur, 4 vols qualifiés, assassinat et menaces verbales de
mort sous conditions
autres inculpés
Hamadène Saïd ben Yahia, Hamadène Hocine ben Yaia, Hammoum
Mohammed ben Slimane, Herbouci Ali ben Ameur, Hammami Ahmed ben
Hocine, Ben Gana Ramdane ben Slimane, Sekkaï Boussad ben Hocine,
Boughias Saïd ben Smaïl, Manseur Mohammed Saïd ben Mohammed, Safar
Omar ben Ahmed et 8 autres, tous inculpés d’association de
malfaiteurs (6828,65fr dont indemnités accordées aux témoins
civils et militaires 6417,20)
De cette procédure
extrêmement longue et complexe devant le CG de la division militaire
d’Oran , on choisit de retenir la question initiale posée durant
l’interrogatoire de Bouchelaghem et des autres condamnés à mort,
sans se pencher sur les affaires de banditisme annexes.
« Le vendredi
14 mai 1915, vers 23h, pendant que deux malfaiteurs armés de fusils
faisaeint le guet devant la maison du nommé Faté Amar ben Mouloud,
au village de Kerboucha, commune de Mirabeau, quatre autres pénétrant
dans la pièce où cet indigène se trouvait en compagnie de sa femme
Tassadit bent Ahmed. Deux de ces derniers entraînèrent Fati Amar
dans une pièce voisine et le tinrent là sous la menace de elrus
fusils, tandis que les autres, après avoir frappé Tassadit pour
l’empêcher de crier, fouillaient la maison. Les bandits ne se
retirèrent qu’après s’être emparés d’une somme de 50
francs, d’une paire d’agrafes en argent, d’une sacoche, de
trois burnous et de divers autres effets. De plus il emmenaient une
vache laitière avec un veau, qui, abandonnée par eux, rentra d’elle
même le lendemain. »
Recours en révision
rejeté le 17 avril 1917.
Ammouche,
Hammoum, et Bouchelaghem sont fussilés à Bordj-Menaïel (Algérie)
le 5 juillet, 5h.
Evanghelos
Christo Dopsinopoulos, né en 1887 à German (Albanie),
cultivateur
« Le nommé
Dopsinopoulos, habitant le village de German a été dénoncé à la
police de sûreté de l’Armée Française d’Orient par un
indicateur, le sieur Doïnides (Michaêl), garde-champêtre de
German, comme étant un comitadji avéré ayant porté les armes
contre nous et nos alliés et se livrant à l’espionnage dans les
lignes françaises, à Sterbovo. » Poursuivi en vain durant
vingt jours dans la montagne, Dopsinopoulos, déserteur de l’armée
grecque est arrêté sur la dénonciation de sa femme qui révèle
l’emplacement d’une cachette contenant des fusils de guerre
bulgares, tachés de sang. Guide d’une bande, il aurait fait
l’assaut d’un poste de gendarmerie grecque et fait déporter
gendarmes et civils dans un camp de concentration en Bulgarie ;
après la retraite de l’armée, il continue à fournir des
renseignements d’espionnage.
Le CG de la 156è DI
le condamne à mort le 28 juin 1917. Il est exécuté à Lubjana
(Serbie) le 21 juillet 1917, 5h.
Ben Mahamed Tahar
Ben Messaoud Bousetta, né en 1882 à Ouled Djellal,
Biskra (Algérie), cultivateur, veuf, 3 enfants, sans condamnation
antérieure
Dans la tribu de
Doucen Ouled Djellal, vivaient sous la même tente une jeune fille de
13 ans, Mebarka bent Belgacem, son beau-père et le frère de ce
dernier, l’accusé Bousetta. Un ancien cheikh, Amor ben Messaoud,
cousin de la jeune fille voulait donner celle-ci en mariage à son
fils quand elle aurait atteint l’âge. Bousetta étant tombé
amoureux de Mébarka, il la déflora afin de contrarier ces projets.
A la suite d’un procès devant le Cadi, la jeune fille fut confiée
à la garde de sa grand-mère, et le vieil Amor obtint de cette
dernière l’autorisation d’emmener sa cousine à Doucen afin de
la soustraire à la cohabitation honteuse qu’elle subissait. Le 2
décembre 1916, ils prirent la route, lui monté sur un âne, elle à
ses côtés, à pied. Après six kilomètres de route, ils virent
fondre sur eux Bousetta, armé d’un fusil, qui tira deux coups sur
Amar, le blessant à la cuisse avant de le tuer. Il s’acharna
ensuite sur Mebarka qui l’implorait et lui baisait les mains, et la
tua à son tour de coups de pierre à la nuque.
CG de la division
militaire de Constantine
Recours en révision
rejeté le 30 mai 1917, « jugement exécutoire le 4 août 1917,
jour où le condamné a été fusillé. »
Ben Ali Ben Dib
Douim, né en 1896, Tribu de Messaôba, Fraction des
Azizla (département de Constantine), berger, célibataire
Dans le courant de
décembre 1915, un indigène d’Ouargla est assassiné sur le
territoire de l’annexe d’El Oued. Les faits ne parviennent à la
connaissance du commandant militaire des Oasis que le 13 mars 1916 ;
les recherches mettent à jour le cadavre de Salem ben Mohammed ben
Miloud, employé de Mebarek ben Amor ben Hachifa. La victime s’était
rendue momentanément à Ourgla en compagnie d’un autre berger,
l’inculpé Douim, qui l’avait assassiné en cours de route en
l’attirant dans un guet-apens, parce qu’il convitait les cinq
chèvres laissées par Salem dans le troupeau de son patron. Douim
fit des aveux complets, désignant des complices qui furent
acquittés.
CG de la division
militaire de Constantine. Recours en révision rejeté le 26 juin
1917
Douim est fusillé
le 21 août 1917 « au lever du jour au champ de tir de la
garnison » (polygone de Constantine).
A Zélénik (Serbie)
le 25 août 1917 (18h30) sont fusillés
Ehmaz
Eumer, né à Galbrda en 1892, cultivateur à Podgarié
Abdul Haidar,
né à Podgarié, cultivateur, célibataire
Chakir Halid,
né à Podgarié en 1887, cultivateur, marié, 3 enfants
Ibrahim
Bey Hodo, né à Poloska en 1872, cultivateur, marié 2
enfants
condamnés pour
avoir sur le territoire d’Albanie recelé ou fait receler l’espion
Bakalbatchich :
Le 12 avril 1917,
Osman Bakalbatchich, arrêté chez Ibrahim Hodo à Poloska, est
condamné à mort par le CG de la 156è DI. Il fait alors des
révélations sur l’organisation de l’espionnage, et ses voyages,
à fin de renseigner sur les routes et les numéros des unités qu’il
croisait, livrant le nom d’agents à la solde des Autrichiens et
des Bulgares.
Mehmet Ibrahim,
né à Mavrovo en 1881, instituteur à Krupusta, marié, 1 enfant
Chaouch Mehmet,
né à Halarup en 1885, cultivateur, marié, 1 enfant
Marko Natcho
Gaki, né à Starovo en 1894, commerçant à Koritza,
célibataire
Vessel Baki,
né à Halarup en 1887, cultivateur, marié, 2 enfants
Suleiman Bessim,
né à Verican en 1884, épicier, marié, 4 enfants
Illia
Christo (alias Polena), né à Polena en 1857, commerçant
(banquier) à Koritza, marié, 8 enfants, désigné comme le chef du
réseau
Intelligence avec
l’ennemi entre autres en lui fournissant des secours en argent au
moyen de la contrebande de l’or échangé contre du papier monnaie
jugés
par le CG de la 57è DI avec Kerim Abedin Biniako, lt de gendarmerie
albanaise à Kontza, Adam Bekir, négociant à Kontza, Rakeb Ibrahim,
Ismail ibrahim, Kiazim Hassan, Osman Salih,(tous condamnées à 20
ans de TF) Helene Andonitza, Catherine Athanas (acquittées)
Biniako
est présenté comme un agent retourné par le contre-espionnage
français. Il ressort de son témoignage qu’il a assité à une
rencontre entre Sali Boutka (chef des comitadji albanais au
service des bulgares) et Themistokli, « préfet » de
police de Koritza où régnait un seigneur de guerre français, le
colonel Descoins (ancien officier de cavalerie d’Afrique). Sous
leur administration, il avait été convenu que le territoire de
Koritza, majoritairement peuplé d’albanais, revendiquerait cette
nationalité sous protection française, le contre-espionnage
français restant persuadé que Themistokli jouait double jeu. Adem
Bekir par ses avouant qu’il servait de facteur pour transmettre les
courriers de Themistokli aux responsables de l’espionnage
germano-bulgare, fournira la preuve qui aboutira à l’arrestation
de Themistokli. (voir 8 novembre)
Vassil Christo,
né en 1858 à Piskupige (Serbie), pope, marié, 5 enfants.
Surveillé de longue
date pas la sûreté, le pope Christo est soupçonné d’entretenir
des relations avec l’évèque d’Okeida, agent ennemi. Sa
persistance à allumer des feux nuitamment à son domicile situé à
deux km des lignes françaises (alors qu’a été prescrit par l’AFO
l’extinction des lumières) le rend suspect de transmettre des
messages par signaux optiques. Enfin en juillet 1917, les Français
trouvent un motif pour l’incriminer directement dans le fait qu’il
encourage les habitants de Piskupige à garder armes et munitions,
alors qu’a été promulgué le décret que tout civil trouvé en
possession d’armes serait fusillé sur le champ. « Vassil
Christo conseilla énergiquement la résistance ». Cinq
personnes ont été fusillées sans procès (sans qu’on sache si on
peut les confondre avec celles évoquées dans le cas suivant).
D : - Comment
se fait-il, puisque vous avez manifesté votre satisfaction de
l’intervention de l’intervention française en orient, que vous
ayez permis à votre fils Théodore de se mettre au service des
Bulgares, quand ils étaient à Piskupige et de les suivre pour
s’enrôler dans leur armée, quand ils ont évacué le village ?
R : - Mon fils
n’a pas volontairement suivi les Bulgares ; il a été emmené
par eux. Depuis son départ je suis sans nouvelles de lui… Je suis
accusé à tort par ceux qui veulent dégager leur responsabilité.
Maxout Husseim,
né en 1882 à Bratomir, cultivateur
A deux reprises au
moins en décembre 1916 et début Janvier 1917, Husseim est accusé
d’avoir franchi les lignes ennemies pour fournir des rensignements
susceptibles de nuire à l’armée française. Il s’est abouché à
Tordora avec un nommé Koyo, qu’il savait être chef de bande à la
solde des Autrichiens, l’encourageant à tenter un coup de main du
côté de Bratomir, « sur l’assurance que la population lui
apporterait secours et assistance. » Il a obtenu de son
beau-père à Plaça, des informations sur l’emplacement exact du
centre de ravitaillement français, lequel fut bombardé peu après.
« Il est à dire que l’accusé n’a pas agi isolément, il a
procédé en compagnie de divers individus, comme lui au service de
Bekir Abdullah, le chef de l’espionnage ennemi, et probablement en
concert avec eux Quatre des individus associés à ces massacres ont
été fusillés [sommairement exécutés] pour avoir contrevenu aux
prescriptions militaires en dissimulant des armes et des munitions
qui ont été trouvées en leur possession. »
CG de la 76è DI, en
tant que sujets civils le droit à révision n’est pas accordé.
Vassil
christo et Maxout Husseim sont fusillés à Bukovo (Serbie) Monastère
de Kristofor le 11 septembre à 5h30.
Julio Roman Sedano
y Leguizano, né le 9 juin 1866 à Pachuca (Mexique),
représentant de commerce (Les historiens voient en lui le fils
illégitime qu’aurait eu Maximilien, Empereur du Mexique –
lui-même parfois désigné comme le fils de l’Aiglon- avec Maria
Anna Leguizamo. Si toutes ces légendes étaient fondées, les
français auraient alors fusillé l’arrière-petit-fils de Napoléon
Ier).
Le dossier de
procédure contenant plus de 1000 pages, on sera amené à survoler
l’affaire :
Rapport : Le 28
décembre 1916, le sieur Sedano, sujet mexicain, jeta une lettre dans
la boîte au bureau de poste situé 121 bd Hausmann, et monta ensuite
dans le premier tramway qui passait. Des inspecteurs de la police
judiciaire qui épiaient ses faits et gestes depuis le 19 décembre
précédent, date à laquelle il avait été signalé par la Sûreté
générale comme espion au service de l’Allemagne, se firent
aussitôt remettre cette correspondance [adressée à] M. Pedro
Garcia, 8 et 6 puerta del Angel, Barcelone. Des réactifs appropriés
révélèrent, au-dessus du texte en clair de la lettre, un texte
secret qui ne laissait aucun doute sur le genre de métier auquel se
livrait Sedano. L’inculpé parlait de détruire à la mélinite la
tour Eiffel. Il invoquait la difficulté de se procurer des
explosifs, son fournisseur, in sergent du 4è d’Infanterie venant
de se tuer en maniant imprudemment une grenade, et il réclamait de
l’argent « encore mille francs ». Peut-être tout cela
n’était-il que du bluff, mais la suite de la lettre renfermait des
renseignements singulièrement précis. Sedano indiquait très
exactement les abréviations par initiales usitées dans notre armée
et il écrivait en propres termes : « Les aéroplanes
français de 200 HP augmentent tous les jours, on peut calculer à 10
par jour. Les Anglais avancent et construisent des avions de 200 et
300 HP. En France et en Angleterre, on continue la construction des
75 et des 155. Les premiers et les seconds, de marine à longue
distance, ce sont ceux qu’on use avec abondance maintenant… Je
continuerai à vous envoyer des listes des hommes sur le front et les
noms des villes où se trouvent les secteurs. J’attends le retour
d’amis qui me donnent des informations, sans se douter que jesuis
un agent spécial et entreprenant, parce que je sais que quand on les
invite et on leur fait des cadeaux… » L’inspecteur Priolet
se transporta au 2 rue de Liège au domicile de Sedano. Au cours
d’une minutieuse perquisition, il découvrti notamment, un flacon
d’encre sympathique portant, sans doute pour dissimuler l’origine
du produit, une étiquette de la parfumerie Piver… un carnet noir
garni sur sept pages et demi, de noms de militaires, avec
l’indication de leurs corps, de leur compagnie ou escadron et, pour
14 d’entre eux, de leur secteur postal. Sedano avoua sans
difficulté qu’il était un agent au service de l’Allemagne…
Mais tout d’abord,
qu’est-ce que Sedano ?
Un rastaquouère,
dans toute la force du terme. La barbe et la chevelure soigneusement
peignées, toujours tiré à quatre épingles, portant beau, il se
donne des allures de galantin, et dans son jargon réel ou affecté,
il ne cesse de décocher des compliments aux femmes qu’il comble
par ailleurs de prévenances et de menus cadeaux. Veuf au Mexique,
marié à Paris depuis 1897 avec une fille de concierge dont il a
commencé à subtiliser les petites économies, il a fait un peu tous
les métiers. Tantôt commis de librairie, tantôt employé dans les
consulats des républiques sud-américaines, tantôt s’occupant
d’expositions et de propagande commerciale, il a été longtemps
guide pour riches étrangers dans les établissements de nuit…
Devenue secrétaire du poète américain Ruben Dario, il passa en
Espagne au moment de la guerre actuelle et il a laissé à Barcelone
les plus tristes souvenirs… C’est là qu’en septembre 1916, un
agent recruteur de l’espionnage allemand vint faire appel à ses
services… Le portrait que l’inculpé a tracé de l’agent
recruteur correspond trait pour trait à celui de Fritz Dispecker,
trésorier du club allemand « Germania » et l’un des
émissaires les plus actifs du Consul général d’Allemagne à
Barcelone…
Par la lettre mise à
la poste le 28 décembre, on peut juger de toutes les autres, et
Sedano… avoua en avoir expédié dix-neuf. D’ailleurs l’Allemagne
n’a jamais cessé d’être satisfaite de son agent, puisque, après
lui avoir fait remettre 400 francs, elle lui a successivement servi
par l’intermédiaire de la banque del Rio de la Plata, le 12
octobre 1916, 305 francs, le 4 novembre 490, 75 fr, le 8 novembre 326
fr… Voilà donc en trois mois et demi près de 2000 francs
déboursés par l’espionnage allemand… Le galant Sedano
n’hésitait pas à mettre à contribution les femmes qui touchaient
à quelque service de la guerre ou avaient un mari sur le front... »
Parvenant à
s’introduire partout, Sedano voyage à Marselle, visite des usines
militaires à Lyon, arrache des renseignement à un de ses
ex-secrétaire qui a travaillé chez Renault.
3è CG permanent du
gouvernement militaire de Paris , sous la présidence du bientôt
très célèbre Bouchardon... En
savoir plus
En attente de la
décision de révision, Sedano ne reste pas inactif dans sa cellule.
Il va produire une impressionnante correspondance destinée à des
personnages influents (Ambassades, Consulats etc…), pour tenter de
trouver de l’aide, estimant qu’il n’a commis aucun délit. Il
demande la liberté provisoire ou le rapatriement immédiat dans son
pays. Il contacte, entre autres personnalités, Porfirio Diaz, fils
de feu l’ancien président de la République Mexicaine lequel « se
désintéresse complètement de cet individu… ayant appris que
c’était un aventurier. »
Sedano
submerge le Capitaine Bouchardon de lettres-fleuve (plus de 20
opuscules) tendant à nier, puis à minimiser sa responsabilité pour
finalement conclure qu’il a œuvré pour le bien de la France.
« La calomnie est un serpent qui répand son venin dans les cœurs », écrit-il le 26 juin 1917.
Ne doutant de rien, il propose de s’occuper de la censure militaire, il va même jusqu’à suggérer au juge un autre modèle de circulaire pour les interrogatoires .
Il assure être Français de cœur :
« Je faisais toujours attention de ne rien envoyer qui portât atteinte à la défense nationale… (C’était) …exclusivement pour gagner de l’argent dont j’avais un urgent besoin, tant pour mes dépenses personnelles que pour mes nobles entreprises. »
« Je pensais d’ailleurs rembourser les sommes d’argent quand les circonstances me l’auraient permis en les distribuant à des œuvres de bienfaisance et m’acquitter ainsi vis-à-vis de ma conscience » (le 23 janvier 917)
« La calomnie est un serpent qui répand son venin dans les cœurs », écrit-il le 26 juin 1917.
Ne doutant de rien, il propose de s’occuper de la censure militaire, il va même jusqu’à suggérer au juge un autre modèle de circulaire pour les interrogatoires .
Il assure être Français de cœur :
« Je faisais toujours attention de ne rien envoyer qui portât atteinte à la défense nationale… (C’était) …exclusivement pour gagner de l’argent dont j’avais un urgent besoin, tant pour mes dépenses personnelles que pour mes nobles entreprises. »
« Je pensais d’ailleurs rembourser les sommes d’argent quand les circonstances me l’auraient permis en les distribuant à des œuvres de bienfaisance et m’acquitter ainsi vis-à-vis de ma conscience » (le 23 janvier 917)
Quand
il se voit définitivement perdu, il entreprend la rédaction d’un
testament qu’il charge son fils Ignacio de publier en 6000
exemplaires qu’il envisage de commercialiser au prix de 2,50frs, ce
qui devrait rapporter 30 000 frs à la succession.
La
première partie de cette Historia de mi vida « Pensées
libres », est composée de principes moraux qui ont, dit-il,
dirigé son parcours de vie. Il aimerait que ces pensées soient
l’objet de leçons de morale dans les collèges, et qu’elles
soient traduites en diverses langues.
Il désire être incinéré et souhaite que ses cendres reposent « loin de ce peuple français que j’ai tant aimé lui sacrifiant les meilleures années de ma vie ». Il aimerait reposer près de son père, à côté du maître autel dans l’église de Jésus, à Mexico.
Il désire être incinéré et souhaite que ses cendres reposent « loin de ce peuple français que j’ai tant aimé lui sacrifiant les meilleures années de ma vie ». Il aimerait reposer près de son père, à côté du maître autel dans l’église de Jésus, à Mexico.
La
seconde partie, intitulée « Annexe », prévoit les
dispositions financières :
Il
lègue 100 frs aux soldats qui le fusilleront, faisant de lui un
martyr, ainsi qu’au gardien de sa cellule.
« Je suis victime d’une erreur » conclut-il. en français,
« Je suis victime d’une erreur » conclut-il. en français,
Recours en grâce
rejeté le 7 octobre 1917
Sedano est fusillé
à Vincennes le 10 octobre 1917, 6h05
Conséquence
de l’interdiction de rendre compte faite à la presse, le Journal
de La Meurthe et des Vosges du 13 octobre annonce l’exécution
d’un espion brésilien.
Née en 1876 aux Pays-Bas,
Margaretha Geertruida Zelle grandit auprès d'un père
attentionné.
Belle jeune fille au teint basané,
Gritje est assez tôt poursuivie par le scandale. Placée par son
oncle dans un pensionnat huppé de Leiden où elle suis des études
pour devenir institutrice, elle est compromise dans une liaison qui
provoque son renvoi et celui du directeur de l’école. A 18 ans,
elle épouse, sur annonce, un capitaine de dix-neuf ans son aîné,
qui l'emmène vivre aux Indes néerlandaises. Elle y apprend la danse
javanaise. Ils ont deux enfants, qui seront empoisonnés en juin 1899
: seule sa fille survit. De retour en Europe en 1903, Margaretha
divorce du capitaine McLeod, violent et porté sur le rhum. Elle
gagne Paris où elle fait ses débuts comme danseuse de charme sous
les apparences d'une princesse javanaise dénommée Mata Hari
(L'oeil de l'Aurore) au «Musée des études
orientales», le 13 mars 1905 sur l’invitation d’Emile
Guimet en personne. Le spectacle connaît le succès et la troupe se
produit bientôt à Madrid, Monte Carlo, Berlin, La Haye, Vienne et
même Le Caire. En 1905 alors quelle se produit à l’Olympia elle
gagne 10 000 francs par soirée. Mais en 1907 elle arrête sa
carrière pour vivre à Berlin avec le lieutenant Allemand Alfred
Kiepert, ce qui entrave durablement sa carrière ; endettée
elle en est même réduite à faire des passes dans les maisons
closes. Ayant retrouvé le succès, mais pas sa fortune antérieure,
Mata Hari, qui parle plusieurs langues et vient d'un pays neutre,
voyage de nouveau librement à travers l'Europe.
En 1915, elle vend son hôtel luxueux de
Neuilly et s’installe dans une maison modeste à La Haye. C’est
là qu’elle est approchée par le consul allemand Karl H. Cramer
qui lui propose de retourner à Paris faire du renseignement en
échange du remboursement de ses dettes.
À Paris, elle mène grand train au
Grand Hôtel où les uniformes chamarrés abondent. Les
pilotes de chasse jouissent en particulier d'un prestige
irrésistible. C'est ainsi que la belle s'éprend fin 1916 d'un
capitaine russe au service de la France dénommé Vadim Maslov, fils
d'amiral, couvert de dettes. Il a 21 ans. Maslov est abattu au front,
en plein vol, et perd l’œil gauche par suite d’intoxication aux
gaz. Il est soigné dans un hôpital de campagne, du côté de
Vittel.
Mata-hari et Maslov en 1915
Mata
Hari aurait elle même dessiné le cache-oeil sur cette photographie
Pour l’obtention d’un laisser passer
afin daller le voir, elle entre en contacte avec Georges ladoux,
chef du contre espionnage français qui lui propose d'aller
espionner le Kronprinz (le prince héritier de l'Empire
allemand), qui fut son amant, moyennant une rétribution considérable
(1 million de francs : Ladoux accepte mais la somme en sera
jamais versée et les faits gardés secrets afin de ne pas
compromettre les services français).
Elle se rend alors en Espagne neutre
pour prendre un bateau à destination de la Hollande et gagner
l'Empire allemand.
Pour éviter les combats, elle compte rejoindre la Belgique via
l'Espagne. Elle est interrogée lors d'une escale involontaire à
Falmouth par Basil Thomson du MI-5 (services britanniques) à qui
elle reconnaît son appartenance aux services secrets français. On
ne sait pas si elle ment à cette occasion, croyant que cette
histoire la rendrait plus intrigante, ou si les services français se
servent effectivement d'elle sans le reconnaître, en raison des
réactions internationales que cette révélation aurait suscitées.
Après un séjour en Belgique où elle aurait reçu une formation au
centre de renseignements allemand d'Anvers par Fräulein Doktor
Elsbeth Schragmüller, elle embarque finalement le 24 mai 1916 pour
l'Espagne, où elle fréquente dans la capitale de nombreux membres
des services secrets, comme Marthe Richard, toutes les deux étant
sous le commandement du colonel Denvignes alors sur place. Elle y est
courtisée par de nombreux officiers alliés.
En janvier 1917, l'attaché militaire allemand à Madrid, le major
Kalle que Mata Hari avait tenté de séduire en se faisant passer (ou
en étant réellement ?) comme l'espion allemand de nom de code
H-21, transmet un message radio à Berlin, décrivant les activités
de H-21. Les services secrets français interceptent le message et
sont capables d'identifier H-21 comme étant Mata Hari. Aussi étrange
que cela puisse paraître, les Allemands chiffrent le message avec un
code qu'ils savaient pertinemment connu des Français et avec des
informations suffisamment précises pour désigner sans peine Mata
Hari (nom de sa gouvernante, adresse), laissant les historiens penser
que le but du message était que, si elle travaillait effectivement
pour les Français, ceux-ci pourraient démasquer sa double identité
et la neutraliser. En tout état de cause Mata Hari se retrouve au
milieu de services secrets en pleines manœuvres de manipulation et
d'intoxication de part et d'autre.
Le 15 janvier 1917 [au capitaine Ladoux]Mon capitaine,Je vous serais très reconnaissante, si vous pouvez faire cesser la filature qu’on me fait depuis que je suis ici.Je m’en suis aperçue. J’ai été avertie et ceux qui en sont chargés le font d’une façon telle que tout l’hôtel le voit et me regarde comme une bête curieuse. C’est complètement inutile.Mes relations à Paris sont des plus connues, mes lettres à qui que ce soit ne contiennent jamais ce qui ne doit pas y être.Faut-il que je vous répète, que je sais très bien ce que Mata Hari doit à Paris. Je n’oublierai jamais le bonheur que j’y ai eu et j’espère en avoir encore.Depuis le jour où je vous ai donné ma parole, je me suis considérée à votre service et je vous en ai donné les preuves. Je vous répète que je ferai pour vous tout ce qui sera dans ma puissance et dans mon pouvoir, mais je me servirai des moyens que je juge en harmonie avec mon caractère et ma façon de voir la vie. Je n’admettrai jamais les « petits moyens là où on doit se servir des grands ».Je n’ai pas besoin de connaître les vôtres. Je ne veux même pas connaître vos intermédiaires. Dites-moi ce que vous désirez et laissez-moi faire.Que je demande que ces services me soient payés, c’est légitime. Dans la vie, on n’a rien pour rien. Dites-moi donc, mon capitaine, si vous désirez continuer oui ou non et recevez l’expression de mes sentiments les meilleurs.Marguerite Zelle Mac Leod.
Six semaines après son retour en France pour rejoindre son amant
Vadim Maslov, le contre-espionnage français elle est arrêtée le 13
février à l'hôtel Élysée Palace sur les Champs-Élysées. Elle
sort nue de la salle de bains et, s'étant rhabillée, présente aux
gardes venus l'arrêter des chocolats dans un casque allemand (cadeau
de son amant Maslov). La perquisition dans sa chambre d’hôtel ne
permet pas de trouver de preuve incontestable, mais le sac à main
contient deux produits pharmaceutiques. Elle déclare que l'un de ces
produits est un contraceptif, mais il entre aussi dans la composition
de l'encre sympathique. Des télégrammes chiffrés interceptés
établissent (et elle le reconnaît) que le consul allemand aux
Pays-Bas lui avait versé 20 000 francs. « Pour prix de mes
faveurs », précise-t-elle. Pour des « renseignements »,
selon ses juges, sans préciser lesquels.
photo de l'Identité judiciaire
Accusée d'espionnage au profit de l'Allemagne dans le cadre d'une
enquête sommaire, Mata Hari passe du statut d'idole à celui de
coupable idéale. Son avocat et ancien amant Édouard
Clunet n'a le droit d'assister qu'aux premiers et derniers
interrogatoires. Son procès dure trois jours sans apporter de
nouveaux éléments. Elle est même, abandonnée par son amoureux
Vadim Maslov qui la qualifie tout simplement « d'aventurière ».
Elle est condamnée à mort pour intelligence avec l'ennemi en temps
de guerre et sa grâce rejetée par le président Raymond Poincaré,
qui laisse la justice suivre son cours. Son exécution a lieu le 15
octobre 1917 par fusillade, au polygone de tir de Vincennes : :
coiffée d'un grand canotier et vêtue d'une robe élégante garnie
de fourrures, avec un manteau jeté sur les épaules, elle refuse
d'être attachée au poteau et le bandeau qu'on lui propose. Elle
aurait lancé un dernier baiser aux soldats de son peloton
d'exécution 723, formé de douze zouaves. Alors que les soldats la
mettent en joue, Mata Hari s'écrie : « Quelle étrange
coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ! »
Sa famille ne réclame pas le corps, qui est confié à la faculté
de médecine de Paris : deux professeurs dissèquent la morte,
déterminant que la balle mortelle a traversé le cœur de part en
part alors qu'une autre balle, celle du coup de grâce, l'a
défigurée. Durant cette autopsie, on vole plusieurs de ses organes
comme souvenirs, comme reliques.
Mata-Hari est en
quelque sorte la victime expiatoire de l’offensive du Chemin des
Dames du 16 avril. Sa mise en cause, entourée du mystère voulu, met
à l’abri les militaires et les politiques qui ont livré,
volontairement ou non, les plans d’attaque aux allemands.. Elle
permet, en détournant l’attention de l’opinion publique vers le
spectacle (n’était-ce pas son métier?) d’étouffer le génocide
des russes et des albanais.
Thomas Théodore
Djara, né en 1888 (le PV d’exécution porte « présumé
en 15871) à Bobochista, tailleur à Korytza, marié, trois enfants
CG de la 11è DI (30
octobre 1917) : jugé avec Anastasios (Tasco) Moula (10 ans de
TF), Antonios Lazaros (Andon) Gounaris (10 ans de TF) et Yoannis
Gounaris (5 ans de TF) pour manœuvres en vue de fournir aux ennemis
des secours en argent au moyen de la contrebande de l’or et
manœuvres en vue de favoriser les progrès des armes des ennemis
contre les forces françaises ou alliées (ce qui constitue des faits
d’espionnage).
En 1928, une demande
en révision de Yoannis Gounaris est rejetée en l’absence de faits
nouveau.
Kanina (Serbie) le
1er novembre 1917 : toutefois ayant purgé sa peine et étant
exempté de l’obligation de résider aux colonies (depuis 1923),
Yoannis Gounaris est légalement autorisé à rentrer en France, s’il
le désire, une partie des sommes saisies à l’époque étant
supposées lui avoir été rendues dès 1918. A cet occasion le
commissaire du gouvernement près du CG de Marseille, saisi de la
demande, produit un résumé de l’affaire à destination du service
du contentieux du Ministère des affaires étrangères : « En
avril 1926 [coquille pour 1916], un albanais, Pazli, vient se fixer à
Korytsa. Il entre en relations avec Djara Thomas et lui demande de
lui procurer de l’or contre du papier monnaie autrichien. Djara
accepte et s’adresse à Moula, négociant à Florina. Celui-ci à
son tour, se tourne vers Gounaris Jean, qui, en association avec son
frère est banquier, marchand de tabacs, et autres. Gounaris Jean,
quoique sachant que l’or serait envoyé à Koritza, accepte
l’affaire, et, partant pour Salonique, laisse son frère terminer
l’opération. Celle-ci porte sur 126440 couronnes autrichiennes qui
furent échangées contre 200 livres sterling, 1500 livres turques,
et 800 pièces de 20 francs. La découverte de cette transaction
amena l’arrestation de Djara, de deux de ses frères, et de
Gounaris Antoine. Moula fut également arrêté. Gounaris jean,
revendiqua de Salonique, par lettres, sa part de responsabilité dans
l’affaire. Poursuivi à son tour, il avoua avoir emmanché
l’échange avec Moula. Il n’ignorait pas que l’or était
destiné à Korytza, mais il n’a vu dans cette affaire qu’une
opération avantageuse, absolument licite : ces échanges se
faisant couramment à Salonique où ils étaient même autorisés.
Cependant, un ordre général du 13 mars 1917 avait formellement
interdit la sortie de l’or de la zone occupée par les troupes
françaises… »
L’argumentation
juridique patauge sur cette question de nationalité des sujets grecs
en Albanie, sur laquelle police et commandement armé peinent à
s’entendre. Le 10 août 1917, le commissaire de police Benoist,
chef du service de sûreté de l’A.F.O. fait pression sur les
juges : « Le chef de la sûreté croit devoir faire
remarquer qu’un acquittement ou un non-lieu dans cette affaire
serait reconnaître le droit à la contrebande de l’or transporté
en territoire ennemi et empêcherait à l’avenir toute arrestation
pour ce motif. Il y a à côté de la question de droit, une question
de principe qui se pose… Les frères Djara et les nommés Gounaris
et Moula doivent être considérés, à son avis, comme sujets d’une
puissance ou d’un etat allié. Les uns ayant adhéré au
Gouvernement Provisoire, les autres à la République de Koritza, ilq
n’ont plus le droit, dans ce cas, de fournir à l’ennemi des
secours en argent… Le chef de la sûreté de l’A.F.O… i,siste
particulèrement pour une suite judiciaire dans cette affaire
renvoyée devant le CG de la 11è DIC, tout paraissant mis en œuvre,
même le chantage [la sûreté française aurait peut-être pour
justifier l’arrestation des désignés coupables, fait disparaître
une somme de 7000 couronnes dont ils demandent l’emploi aux
suspects] pour arriver à un non-lieu. »
Un rapport de
l’adjudant Paoli, tend à montrer que l’affaire a été sinon
montée de toutes pièces, du moins exagérée, sans autre preuve que
la rumeur, par la sûreté, fort vexée que quelques cas précédent
lui ait échappé, raison de la promulgation hâtive des ordonnances
du 4 et 13 mars interdisant le commerce de l’or et des monnaies
« ennemies » dans la zone : « Il est de notoriété
publique que les frères Gounaris et bien d’autres commerçants de
la ville, aujourd’hui vénizélistes de circonstances, ont, avant
la constitution du front actuel, fait une propagande et une
contrebande intense en faveur des Bulgares qu’ils ont favorisés de
tous les moyens en leur pouvoir lors de l’occupation par l’ennemi
de la ville de Florina. En outre, les frères Gounaris faisaient
partie du club fondé à Florina par l’ancien préfet royaliste
Vanvetsos et le directeur de l’hôpital grec, le nommé Karavitis,
[lesquels] avaient créé à Florina un centre de renseignements et
d’espionnage fonctionnant en faveur du service d’espionnage
dirigé à Monastir par l’ancien consul autrichien de Salonique. »
« Faits
reprochés à Thomas et Sotirios Djara : le 20-12-1916, première
dénonciation signalant les frères Djara comme se livrant à
l’échange de l’or contre du papier autrichien ; 15 janvier,
signalés comme effectuant des transactions financières à Korytza
au profit du neveu de Sali-Bukta ; _ février, comme ayant
échangé 23 000 couronnes contre de l’or à un envoyé de Kiazim
Panarité, chef ennemi… comme se rendant clandestinement à
Bobostica sis à ce moment dans les lignes ennemies ; le 11
février comme ayant effectué un achat de 3500 livres turques, somme
échangé à Bobostica contre papier-couronnes autrichien
[intermédiaire Poléna]. Ces faits se passaient à une époque où
pour des raisons politiques, il ne pouvait être procédé à
l’arrestation des frères Djaro ». Commentaire marginal du
chef de la sûreté : « Il serait temps de mettre fin à
ce commerce. L’arrestation de ces individus s’imposerait ne
fût-ce que pour l’exemple. Qui dit contrebande dit espionnage. »
Le 26 juin 1917, 20
jours après avoir été écroué à la prison du QG de l’A.F.O.,
Sotir Djara meurt des suites de la typhoïde à l’hôpital de
Florina.
Le 1er
novembre 1917 à 8h Thomas Djara, arrivé au lieu de son exécution,
au champ de tir de Kanina, désigne comme légataire universel son
frère Pandeli.
Germendji
Themistokli, né en 1870 à Koritza.
Arrêté le 1er
novembre, il est mis en jugement le 7 devant le CG de Salonique.
Prisme 1418 :
Descoins menait à Korytza une existence de satrape. Il avait un
Konak, un harem, une garde indigène, un drapeau spécial à la hampe
duquel pendaient des queues de cheval. Il émettait des timbres
spéciaux (avec fautes et erreurs volontaires) dont le commerce fut
assez florissant pour lui. Descoins avait comme
pourvoyeur-entremetteur et conseiller militaire un certain
Thémistokli, nommé par lui, Préfet de Police de Korytza à qui, un
jour, en grande pompe, toute la population étant réunie sur la
place, il remit personnellement la croix de guerre afin de le
récompenser de ses bons, de ses très bons offices. (source : lettre
adressée après-guerre à l’ancien rédacteur du communiqué du
GQG, devenu journaliste, Fonds privé Jean de Pierrefeu, SHD, 1K 120)
Ce Thémistokli avait quitté le service des Bulgaro-Autrichiens en
décembre 1916, avec sa bande dont les membres avaient été
titularisés gendarmes albanais, toujours aux ordres de leur chef,
pour assurer l’ordre dans une population bigarrée, lourde
d’hostilité entre communautés aux aspirations différentes.
Le déroulement des
événements judiciaires montre que les autorités militaires avaient
hâte de ce débarrasser de cet agent double.
Condamné à mort le
7 novembre, Themistokli se pourvoit en révision dans les délais
prévus.
Note du substitut du
Commissaire du Gouvernement près le Conseil de révision de l’A.O.
le 10 novembre 1917 : « le 8 novembre 1917 le Commissaire
rapporteur près le conseil de guerre m’a remis le pouvoir du nommé
Germendji (sic)… J’ai immédiatement déposé ce pourvoi au
greffe du Conseil de révision. Le commandant (bureau de la justice
militaire) qui s’est réservé le droit de convoquer le Conseil de
révision, prévenu de l’existence du pourvoi a fait connaître par
message téléphoné reçu le 8/11/17 à 17h10 que la séance du
Conseil de révision aurait lieu le 9 novembre à 16 heures. Par
téléphone, le Commandement faisait connaître le même jour à 18
heures que le précédent message était annulé. Le 9/11 à 8h30 le
Commissaire rapporteur de la Base me donnait connaissance, comme
suite au pourvoi, du procès verbal d’exécution de la sentence,
dressé par l’adjudant greffier Maglioli, agissant en vertu des
ordres du général Chef d’État Major de l’arrière ;
l’exécution avait eu lieu le même jour à 7h30. Le Commandement
n’a plus donné aucune suite au pourvoi, qui, pour cette raison n’a
pu être vidé et le dossier a été retourné au Commissaire
rapporteur près le Conseil de guerre. »
(Prisme
1418) « Le 26 novembre 1917, une autre longue
enquête de notre Commissaire de Police Benoist livrait au Conseil de
Guerre de la 76e DI un réseau d’espions, cette fois-ci au profit
de la Bulgarie, tous condamnés à mort à l’issue du procès. Le
général de Vassart n’a pas demandé cette fois confirmation de
l’exécution immédiate, et l’a ordonnée pour le lendemain 27
novembre, à grand spectacle, près de la petite bourgade serbe de
Holeven, la population tenue à distance, assistant à la fusillade,
à 6h30, des 18 condamnés à mort, record des exécutions
collectives par l’armée française dans la grande guerre. »
Des exécution
avouées et attestées par jugement, s’entend...
Vassil Bojin
Doneff Christo
Kosta nelia
Pandofsky
Troyan Foti
Anastassoff
Naydo Stoyan
Anastassoff
Mihaïl Stefo
Kotcheff
Illia Traïcoff
Ralefsky
Sfecto Dimoff
Spiro Sterio
Tarpoff
Machoula Iovan
Liahofsky
Spiro Nake
Merko Sterio
Mihaïl Netcho
Palla
Vassil Stavro
Boïkofsky
Sotir Yancoff
Sotir Yane Tomo
(alias Sotir Yoche)
Thanas Petré
Papavassiloff
Trane Yaneff
Gustave Mathias
Michelson, né le 27 novembre 1878 à Wiborg (Russie)
ingénieur à Paris
2è CG permanent du
gouvernement militaire de Paris (25 juillet 1917)
Arrêté le 22
novembre 1916, Michelson est accusé d’avoir par une lettre en
« écriture secrète » fourni des renseignements à un
agent de l’espionnage allemand à Barcelone sur des améliorations
d’un modèle d’aéroplane devant être construit pour l’armée
française. Ses relations avec la cellule de Barcelone auraient pris
place entre avril et juillet 1916. C’est à peu près tout ce qu’on
peut en savoir, le dossier de procédure n’étant pas parvenu
jusqu’à nous.
Pourvoi en révision
rejeté le 17 août, pourvoi en cassation rejeté le 27 septembre
1917
Michelson est
fusillé le 19 novembre 1917 à Vincennes à 7h10.
Léon
Wecsler, né le 20 mai 1865 à Jassy (Roumanie) employé de
commerce, célibataire, résidant avant son arrestation à Paris,
hôtel Crillon.
Cette fois encore,
on ne dispose que des minutes du 3è CG permanent du Gvt Militaire de
Paris (20 juillet 1917). Le défenseur tente habilement d’obtenir
que le Conseil se déclare incompétent, mettant en cause la
régularité de l’arrestation, et le fait que trois des quatre
chefs d’inculpation visent des faits qui se sont produits à
l’étranger. Ce quatrième crime concerne l’introduction de
l’inculpé dans le camp retranché de Paris pour s’y procurer des
documents dans l’intérêt de l’Allemagne. Les trois autres chef
d’inculpation portent sur les relation entretenus par Wecsler à
Charlottenburg en 1916 avec le Docteur Grüber, et en novembre 1916 à
Constance avec le Lieutenant Steiner. « Le meême est-il
coupable d’avoir en Suisse et notamment à Genève, d’octobre
1916 à février 1917 inclus, entretenu des intelligences avec
l’Allemagne, puissance ennemie, notamment en la personne du docteur
Grüber ? »
Recours en révision
rejeté le 17 août 1917, pourvoi en cassation rejeté le 27
septembre.
Wecsler est fusillé
à Vincennes le 29 novembre 1917.
Féhim Banouch,
né en 1882 à Kensbethiquer (Albanie), agriculteur, marié, sans
enfant, musulman
CG du groupement de
Malik, jugé avec Assim Vessel (10 ans de TF) :
Accusé d’avoir,
en se rendant de Béras à Vastomi sur l’ordre de son patron Hassan
Chakir recueilli des renseignement sur les troupes françaises (à
Koritza, nombre de militaires, emplacement de l’aérodrome, nombre
d’avions etc.) transmis à l’ennemi. Assim Vessel, pêcheur, est
accusé d’avoir, sur les ordres du lieutenant bulgare Ilio
Kotcharof transporté (sur le lac Malik) aux mois de mars et avril
1917 en barque de Soviani aux lignes françaises Félim Banouch,
Haïdar Lozé et Arif Daout, touchant pour ces trois voyages des
rémunérations des Bulgares. Le voyage de retour de Lazé fut
commencé par
Vani Spiro,
né en 1880 à Soviani (Albanie), agriculteur, pêcheur, marié, 4
enfants, chrétien orthodoxe
Spiro est accusé de
recel d’espion pour avoir en 1917 à Koritza, logé chez lui Haïdar
Lazé qu’il savait être un agent de l’ennemi, et l’avoir aidé
à traverser le avant-postes français pour retourner chez les
Bulgares, faits qu’il aurait avoués.
CG du groupement de
Malik (30 octobre 1917). On constate que l’exécution a suivi
immédiatement le procès puisque Vani Spiro et Féhim Banouch sont
exécutés à Koritza Ferme du Haricot le 1er décembre
1917 à 7 heures.
Ben Cheikh
Guettaf, né vers 1893 dans la tribu des Mekhali Djorb,
berger
CG de la 20è DI,
jugé avec quatre autres « indigènes civils de l’Annexe de
Laghouat »
Accusé d’avoir le
14 novembre 1916 à Berrian, territoire militaire de Gardaïa tué
Salah Bahmed El Takleur, emportant dans sa fuite un burnous, une
gandoura, et une paire de souliers ; le 14 décembre à l’Oued
Benbrik, d’avoir volé à un berger cinq chameaux, un fusil, un
burnous, un couteau : le 26 décembre à l’Oued Madagh, tenté
de voler à un autre berger un troupeau de moutons ; et enfin le
20 mars 1917 d’avoir volé un fusil au berger Mihoub ben Ramdam.
Recours en révision
rejeté le 5 septembre 1917
Alger Fort
l'Empereur le 1er décembre à 6 heures
L’Affaire
des Tamarins comme l’appellera la justice est un épisode
des « troubles du sud constantinois » , mouvement
insurrectionnel surveni en novembre 1916 dans les Aurès, par la
suite du décret disposant de la possibilité pour l’armée
française d’incorporer toutes les classes d’âges algériennes
et de prélever des ouvriers destinés aux usines d’armement en
France métropolitaine. Le 11 novembre, un conseil de révision est
réuni dans la commune de Mac-Mahon sous la présidence du
sous-préfet de Batna, Casinelli.
Prisme
1418 : « Selon le rapport envoyé au gouvernement «
Dans la nuit du 11 au 12, un millier d’indigènes du douar Aouf
se portent sur Mac Mahon, envahissent le bordj, incendient les
appartements, font feu sur M. Cassinelli, sur M. Marseille,
administrateur et sur l’une de ses filles, pillent le village,
coupent la voie ferrée et la ligne télégraphique. M. Marseille est
tué sur le coup et son enfant grièvement blessée. M. Cassinelli
est mort des suites de ses blessures. Les émeutiers sont alors
dispersés par les Zouaves du peloton de protection, au prix de 12
tués »
Au petit matin du 12, à 9 kilomètres de là, les quelques Européens présents autour de la maison forestière des Tamarins, implantée près du carrefour de la route Biskra-Batna et de la voie ferrée, découvraient un attroupement inhabituel « d’indigènes » suivi de l’envahissement par force de leurs demeures. « Dans la même nuit du 11 au 12 novembre, aux Tamarins, la gare était pillée et un garde forestier tué ».
Au petit matin du 12, à 9 kilomètres de là, les quelques Européens présents autour de la maison forestière des Tamarins, implantée près du carrefour de la route Biskra-Batna et de la voie ferrée, découvraient un attroupement inhabituel « d’indigènes » suivi de l’envahissement par force de leurs demeures. « Dans la même nuit du 11 au 12 novembre, aux Tamarins, la gare était pillée et un garde forestier tué ».
M. Terrazano avait
été abattu par traîtrise. Blessé, il avait été achevé par un
petit groupe qui s’était acharné sur lui. Les trois femmes
présentes avaient été brutalisées, dévalisées, tandis que le
dépôt de la voie ferrée était pillé… »
L’historien
Gilbert Meynier estime que, sur 5 mois, de 18 à 38 Européens et de
200 à 300 «indigènes » y perdirent la vie. Il ajoute : «
Plusieurs centaines de personnes sont parquées en plein hiver
dans un camp sans abri à Corneille ; beaucoup meurent à la prison
de Constantine et à celle de Batna. Sur 147 prisonniers du
Sud-Constantinois transférés à Taadmit, une centaine meurent du
typhus »
Mme Veuve Massip,
chef d’arrêt aux Tamarins, entend la première des cris d’appel
des indigènes habitant la mechta voisine de la gare. Pendant que Mme
Rost, garde-barrière est agressée, Mme Massip avertit par le poseur
Galibardi que les Chaouia se révoltent, se ditige avec sa fille et
un brigadier résidant à la gare, vers la maison forestière
située à 150m. A la nouvelle de l’agression de Mme Rost
(communiquée par un complice des émeutiers), Terazzano envoie deux
des hommes présents pour la chercher. Kaddouri, ouvrier du train
bien connu des européens qui lui faisaient confiance pousse
Terazzano vers Boumédiane qui s’est caché à l’abri de la
tonnelle, et tire à bout portant un coup de fusil sur le garde
forestier. Trois autres rebelles l’entourent et l’exécute,
donnant le signal du sac de l’appartement. Les agresseurs
s’enfuient alors pour piller la gare et le dépôt, renonçant à
éliminer les autres témoins gênants.
Messaoud Ben
Abdallah Boumédiane, présumé né en 1867, doaur
Tilatou, journalier, marié 6 enfants, condamné en 1915, 10 francs
de dommages pour pacage
Messaoud Ben
Sakker Hamaza, présumé né en 1897 au douar Briket,
berger, célibataire
Mosbah Ben Sakker
Hamaza, présumé né en 1894, douar Briket,
cultivateur, célibataire
Salah Ben El
Haouès Hamaza, né le 4 juin 1898, douar Briket,
berger, célibataire
Zitouni Ben El
Haouès Hamaza, né en 1884, douar Briket, cultivateur,
marié sans enfant
Mouï Ben
Messaoud Kaddouri, présumé né en 1871 au douar Tilatou,
journalier, marié, 2 enfants, condamné en 1914 pour achat d’arme
de guerre sans autorisation
CG de la division
militaire de Constantine (27 août 1917) : exemple de fiches
individuelles
Zerghini : au
cours d’un mouvement insurrectionnel le 12 novembre 1916 aux
Tamarins, arrdt de Batna, a d’abord cherché à dissuader les
victimes de prendre des dispositions de défense en les rassurant à
l’aide de nouvelles qu’il savait pertinemment fausses. A donné à
l’un des assassins le signal de l’assassinat du brigadier
forestier Terezzano.
Khelalfa : a
pénétré avec violence chez Mme Rost garde-barrière, tentant de la
voler, l’a frappé de 2 coups de bâton, et d’un coup de poing
pour lui faire lâcher le fusil dont elle s’était armée.
L’action
judiciaire est éteinte contre Mohanmed ben Sakhli Hamaza, décédé
le 1er novembre 1917 avant l’exécution (pendu dans sa
cellule) et contre Aissa ben Belkacem Rouabah, décédé à l’hôpital
le 17 août 1917 (ce dernier voleur des volailles de Mme Rost, la
menaçant de mort)
2 familles
particulièrement actives, les Mahdi et les Hamaza figurent parmi les
35 prévenus ; 98 questions sont posées aux juges, dont il
résulte, 15 non-lieu (charges insuffisamment établies) et 7
condamnations à mort : six survivants sont fusillés le 20
décembre 1917, à Mac-Mahon, 8 heures, après le rejet du recours en
grâce en date du 12 décembre.